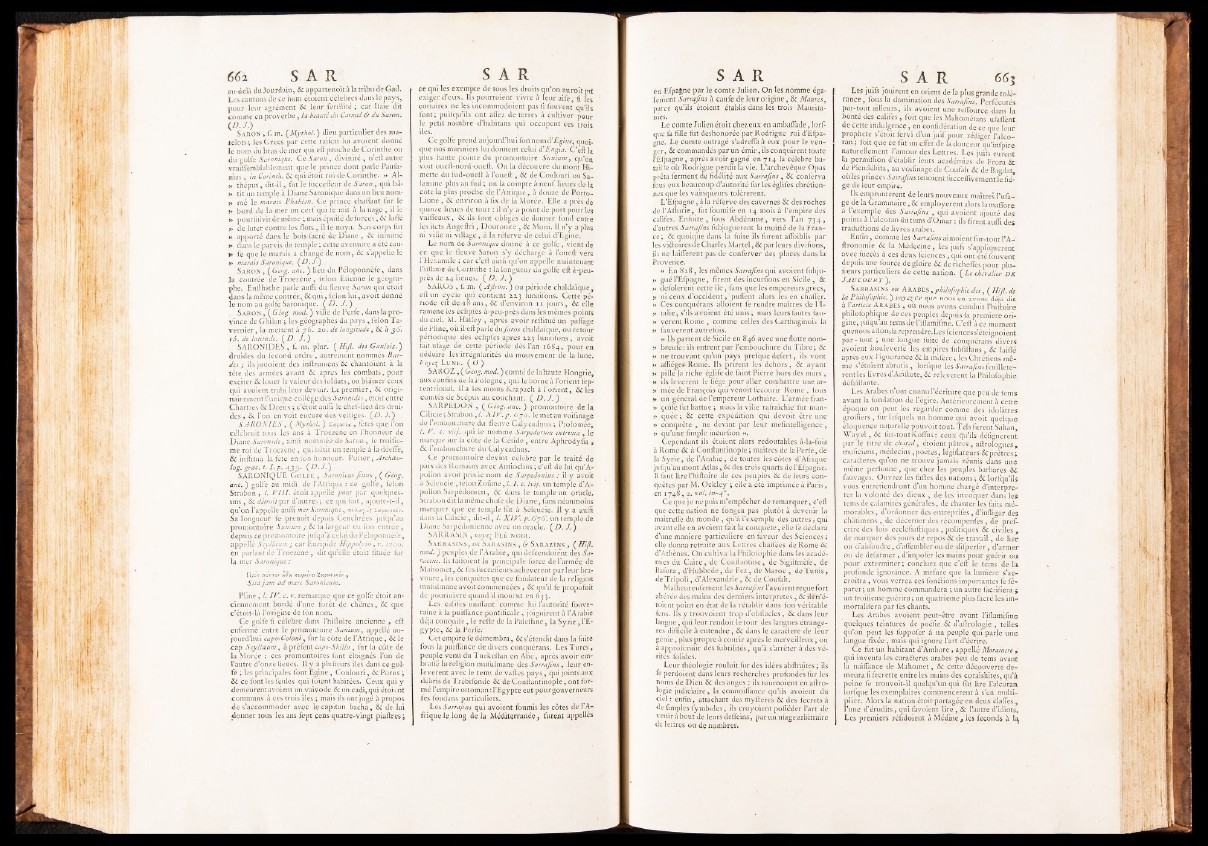
au-delà du Jourdain, 6c appartenoitàlatribu de Gad.
Les cantons de ce hom étoient célébrés dans le pays,
pour leur agrément 6c leur fertilité ; car Haïe dit
comme en proverbe, la beauté du Carmel & du Saron. (z>. fü H Saron , f. m. ( Mythol. ) dieu particulier des matelots;
les Grecs par cette raifon lui avoient donné
le nom du bras de mer qui eft proche de Corinthe ou
du golfe Saronique. Ce Saron , divinité , n’eft autre
.vraiflèmblablement que le prince dont parle Paufa-
nias, in Corinth. 6c qui étoit roi de Corinthe. » Al-
» thépus, dit-il, fut le fuccefleur de Saron, qui bâ-
» tit un temple à Diane Saronique dans un lieu nom-
» mé le marais Phabcen. Ce prince chafl'ant fur le
» bord de.la mer un cerf qui le mit à la nage , il le
» pourfuivit de même ; mais épuilé deforces, ik lafle
» de luter contre les flots, il le noya. S^/n corps fut
» apporté dans le bois facré de Diane , & inhumé
» dans le parvis du temple ; cette aventure a été cau-
» fe que le marais a changé de nom, 6c s’appelle le
» marais Saronique. (D . J ,
Saron , ( Géog. anc. ) lieu du Péloponnèfe, dans
la contrée de Troezène , lelon Etienne le géographe.
Eufthathe parle auffi du fleuve Saron qui étoit
dans la même contrée, 6c qui, lelon lui, avoit donne
le nom au golfe Saronique. ( D. J.')
• Saron , ( (réo£ mod, ) ville dé Perfe, dans la province
de Ghilan ; les géographes du pays, félon Ta-
Vernier, la mettent à 76'. 20. de longitude, & à 36Y
là. de latitude. ( D . J.')
SARONIDES , f. m. plur. ( Hiß. des Gaulois. )
druides du fécond ordre , autrement ç.ommés Bardes
; ils jpuoient des inflrumens 6c chantoient à la
tête des armées avant 6c apres les combats, pour
exciter Se louer la valeur des loldats, ou blâmer ceux
qui avoient trahi leur devoir. Le premier, 6c originairement
l’unique collége.des Sarànides, étoit entre
Chartres 6c Dreux ; c’étoit aulîi le chef-lieu des druides
, & l’on en voit encore des veftiges. (D. J.')
S I R O N I E S , ( Mythol. ) Sccpuri* , fêtes que l’on
célébroit tous lps ans à Troezène en l’honneur de
Diane Saronide, ainfi nommée de Saron-, le troifie-
me roi de Troezène, qui bâtit un temple à la déefle,
& inftituä la fête en Ion honneur. Potier, Archceo-
log.groec. t. l .p . 4 3 9 - ( J * . ! . )
SARONIQUE Golfe , Saronicus finus, ( Géog.
anc. ) golfe au midi de l’Attique : ce golfe, félon
Strabon , l. VIII. étoit appelle pont par quelques-
uns , 6c décroit par d’autres ; ce qui fait, ajoute-t-il,
qu’on l’appelle auffi mer Saronique, mixa.yoç T-ctpaunov.
Sa longueur fe prenoit depuis Cenchrées jufqu’au
promontoire Sunium ; 6c fa largeur ou fon entrée ,
depuis ce promontoire jufqu’à celui du Péloponnèfe,
appelle Scylloeum ; car Euripide Hippolyto, v. 1200.
en parlant de Troezène , dit qu’elle étoit fituée fur
la mer Saronique :
npGi TTOVTCy »iJ'h UtipiV» ZctpaVlKOV ,
S ica jam ad mare Saronicum.
Pline , l. IV. c. v. remarque que ce golfe étoit anciennement
bordé d’une forêt de chênes, 6c que
c’étoit-là l’origine de fon nom.
Ce golfe fi célébré dans l’hiftoire ancienne , eft
enfermé entre le promontoire Sunium, appelle aujourd’hui
capo-Coloni, fur la côte de l’Attique, & le
cap Scyllaum, à préfent capo-Skillo , fur la côte de
la Morée : ces promontoires font éloignés l’un de
l’autre d’onze lieues. Il y a plufieurs îles dans ce golfe
; les principales font Egine , Coulouri, 6c Porus ;
& ce font les feules qui foient habitées. Ceux qui y
demeurent avoient un vaivode &un cadi,qui étoient
communs à ces trois îles ; mais ils ont juge à propos
de s’accommoder avec le capitan bacha, & de lui
donner tous les ans fept cens quatre-vingt piaftres ;
ce qui-les exempte de tous les droits qu’on auroit ptt
exiger d’eux. Ils pourroient vivre à leur aife fi les
coriaires ne les incommodoient pas fifo.uvent qu’ils
font ; puifqu’ils ont affez de terres à cultiver pour
le petit nombre d’habitans qui occupent ces trois
îles. '
.Ce golfe prend aujourd’hui fon nom à*Egine, quoique
nos mariniers lui donnent celui à’Engia. C’eft la
plus haute pointe du promontoire Sunium, qu’on
voit oueft-nord-oueft. On la découvre du mont Hi-
mette du fud-oueft à l’ouefl, 6c de Coulouri ou Sa-
lamine plus au fud ; on la compte à neuf lieues de la
côte la plus proche de l’Attique, à douze de Porto-
Lione , 6c environ à fix de la Morée. Elle a près de
quinze lieues de tour : il n’y a point de port pour les
vaifîeaux, 6c ils font obligés de donner fond entre
les îlets Angeftri, Douronite ', 6c Moni. Il n’y a plus
ni ville ni village, à la réferve de celui d’Egine.
Le nom de Saronique donné à ce golfe, vient de
ce que le fleuve Saron s’y décharge à l’oüefi vers
1 Hexamile ; car c’eft ainfi qu’on appelle maintenant
l’ilUime de Corinthe : la longueur du golfe eft à-peu-
près de 24 lieues. ( D. J. y
SAROS , f. m. ( Aflron. ) ou période chaldaïque,
eft un cycle qui contient 223 lunaifons. Cette période
eft de ^ 8 ans, 6c d’environ 11 jours, 6c elle
ramene les éclipfes à-peu-près dans les mêmes points
du ciel. M. Halley, après avoir reftitué un paffage
de Pline, où il eft parlé du far os chaldaïque, ou retour
périodique des éclipfes après 223 lunaifons , avoit
riait ulage de cette période dès l’an 1684, pour en
déduire les irrégularités du mouvement de la lune.
Voye^ L u n e . ;( O )
SAROZ, (Géog. mod. y comté de la haute Hongrie,
aux confins de la Pologne, qui le borne à l’orient fep-
tentrional. lia les monts K-rapach à l’orient, & les
comtés de Scépus au couchant. ( D . J. )
Sa RPEDON , ( Géog. anc. ) promontoire de la
Cilicie ; Strabon , /. X IV . p. 670. le met au voifinage
de l’embouchure du fleuve Calycadnus ; Ptolomée,
L. V. c.\ vuj. qui l.e nomme Sarpedorum extrema , le
marque fur la côte de la Cétide , entre Aphrodyfia ,
6c l’embouchure du Calycadnus.
. Ce promontoire devint célèbre par le traité de
paix des Romains avec Antiochus ; e’eft de Iuïqu’A*
pollon avoit pris, le nom de Sarpedonius : il y avoit
à Séleucie , feion Zofime, 1.1. c. Ivij. un temple d’Apollon
Sarpédonien, 6c dans le temple un oracle.
Strabon dit la même chofe de Diane, f ans néanmoins
marquer que ce temple fut à Séleucie. Il y a auffi
dans la C ilicie, dit-il, l. X IV . p. 67 C un temple de
Diane Sarpédonienne avec un oracle. (D .J .y .
SARRASIN, voyc£ Blé noir.
Sarrasins, ou Sarasins , & Sarazins , ( Hiß.
mod. y peuples de l’Arabie, quidefcendoie'nt des Sa-
raceni. Ils fàifoient la principale forcé de l’armée de
Mahomet, 6c fes fucceffeurs achevèrent par leur bravoure
, les conquêtes que ce fondateur de la religion
mululmane avoit commencées , 6c qu’il fe propofoit
de pouriuivre quand il mourut en 633.
Les califes unifiant comme lui l’autorité fouve-
raine à la puiflànce pontificale, joignirent à l’Arabie
déjà conquife, le refte de la Paleftine, la Syrie, l’Egypte,
6c la Perfe/
Cet empiré fe démembra, & s’étendit dans la fuite
fous la puiflànce de divers conquérans. Les Turcs,
peuple venu du Turkeftan en Afie, après avoir em-
brafl’é la religion mufulmane des Sarrafins, leur enlevèrent
avec le tems de vafteç pays, qui joints aux
débris de Trébifonde & de Conftantinople, ont formé
l’empire ottoman : l’Egypte eut pour gouverneurs
fes foudans particuliers.
Les Sarrafins qui avoient fournis les côtes de l’Afrique
le long de la Méditerranée, furent appellés
èn Efpagne par le comte Julien. On les nomme également
Sarrafins à caufe de leur origine, 6c Maures,
parce qu’ils étoient établis dans les trois Maurita-
nies.
Le comte Julien étoit chez eux en ambaflade, lorf-
que fa fille fut deshonorée par Rodrigue roi d’Efpa-
gne. Le comte outragé s’adrefîa à eux pour le venger,
& commandés par un émir, ils conquirent toute
l’Efpagne, après avoir gagné en 714 la célébré bataille
oit Rodrigue perdit la vie. L’archevêque Opas
prêta ferment de fidélité aux Sarrafins , 6c conferva
fous eux beaucoup d’autorité fur les églifes chrétiennes
que les vainqueurs tolérèrent.
L’Efpagne, à la réferve des cavernes & des roches
d e l’Afturie, fut fouraife en 14 mois à l’empire des
califes. Enfuite , fous Abdérame, vers l’an 7 3 4 ,
d’autres Sarrafins fubjuguerent la moitié de la France;
& quoique dans la fuite ils furent affoiblis par
les viéfoires de Charles Martel, 6c par leurs divifions,
ils ne laiflerent pas de conferver des places dans la
Provence.
« En 828, les mêmes Sarrafins qui avoient fubju-
» guél’Efpagne, firent des incurfions en Sicile , &
>> defolerent cette î le , fans que les empereurs grecs,
» ni ceux d’occident ^puflent alors les en enafl'er.
» Ces conquérans alloient fe rendre maîtres de 11-
» talie, s’ils avoient été unis ; mais leurs fautes fau-
» verent Rome , comme celles des Carthaginois la
« fauverent autrefois.
» Ils partent de Sicile en 846 avec une flotte nom-
» breufe: ils entrent par l’embouchure du Tibre; 6c
» ne trouvant qu’un pays prefque defert, ils vont
» affiégej^Rome. Ils prirent les-dehors, 6c ayant
» pillé la riche églife de faint Pierre hors des murs ,
» ils levèrent le fiége pour aller combattre une ar-
» mée de François qui venoit fecourir Rome, fous
» un général de l’empereur Lothaire. L’armée fran-
» çoile fut battue ; mais la ville rafraîchie-fut man-
» quée ; 6c cette expédition qui devoit être une
» conquête , ne devint par leur mefintelligence,
» qu’une fimple incurfion ».
Cependant ils etoient alors redoutables à-la-fois
à Rome 6c à Conftantinople ; maîtres de la Perfe, de
la Syrie, de l’Arabie, de toutes les côtes d’Afrique
juf qu’au mont Atlas, 6c des trois quarts de l’Efpagne.
Il faut lire l’hiftoire de ces peuples 6c de leurs conquêtes
par M. Ockley ; elle a été imprimée à Paris,
en 1748,2. vol. in-40.
Ce que je ne puis m’empêcher de remarquer, c’eft
que cette nation ne fôngea pas plutôt à devenir la
maîtrefle du monde, qu’à l’exemple des autres , qui
avant elle en avoient fait la conquête, elle fe déclara
d’une maniéré particulière en faveur des Sciences ;
elle donna retraite aux Lettres chaflées de Rome 6c
d’Athènes. On cultiva la Philofophie dans les académies
du Caire, de Conftantine, de Sigilfmèfe, de
Bafora, d’Hubbede, de F ez, de Maroc , de Tunis,
,de Tripoli, d’Alexandrie , 6c de Coufah.
Malheureufement les Sarrafins l’avoient reçue fort
altérée des-mains des derniers interprètes, &il^h’é-
toient point en état de la rétablir dans fon véritable
fens. Ils y trouvoient trop d’obftacles, 6c dans leur
langue, qui leur rendoit le tour des langues étrangères
difficile à entendre, 6c dans le caraélere de leur
génie, plus propre à courir après le merveilleux, ou
à approfondir des fubtilités, qu’à s’arrêter à des vérités
folides.
Leur théologie rouloit fur des idées abftraites ; ils
fe perdoient dans leurs recherches profondes fiir les
noms de Dieu 6c des anges : ils tournoient en aftro-
logie judiciaire, la connoifl'ance qu’ils avoient du
ciel: enfin, attachant des myfteres & des fecrets à
de fimples fymboles, ils croyoient pofleder l’art de
venir à bout de leurs defl'eins, par un ufage arbitraire
de lettres ou de nombres.
Les juifs jouirent en orient de la plus grande tolérance,
fous la domination des Sarrafins. Perfécutés
par-tout ailleurs, ils avoient une reflource dans la
bonté des califes, foit que les Mahômétans ufaflent
de cette indulgence, en confidération de ce que leur
prophète s’étoit fervi d’un juif pour rédiger l’alco-
ran; foit que ce fût un effet de la douceur qu’infpire
naturellement J’amour des Lettres. Les juifs eurent
la permiffion d’établir leurs académies de Frora &
de Piendébita, au voifinage de Coufah 6c de Bagdat,
où les princes Sarrafins tenoient fucceffivementle fiége
de leur empire.
Ils empruntèrent de leurs nouveaux maîtres l’ufa-
ge de la Grammaire, 6c employèrent alors lamaflore
à l’exemple des Sarrafins , qui avoient ajouté des
points à i’alcoran du tems d’Omar : ils firent auffi des
traductions de livres arabes.
Enfin, comme les Sarrafins aimoient fur-tout l’A-'
ftronomie 6c la Medecine, les juifs s’appliquèrent
aveç-fuccès à ces deux fciences, qui ont été fouvent
depuis une fource de gloire 6c de richeffes pour plufieurs
particuliers de cette nation. (Le chevalier DE
J A U CO U R T
Sarrasins ou A rabes , philofophie des, ( Hift. de
la Philofophie: ) voye^ ce que nous en avons déjà dit
à Xarticle Arabes , où nous avons.conduit l’hiftoire
philofophique de ces peuples depuis fa première origine,
jufqu’au tems de l’iflamifme. C’eft à ce moment
quenous allonsla reprendre.Les fciencess’éteignoient
par - tout ; une longue- fuite de conquérans divers
avoient bouleverfé les empires fubfiftans, 6c laifle
après eux l’ignorance 6c la mifere ; les Chrétiens même
s’étoient abrutis, lorfque les Sarrafins feuilletèrent
les livres d’Ariftote, 6c relevèrent la Philofophie
défaillante.
Les Arabes n’ont, connu l’écriture que peu de tems
avant la fondation de l’égire. Antérieurement à cette
époque on peut les regarder comme des idolâtres
grofîiers , fur lefquels un homme qui avoit quelque
éloquence naturelle pou voit tout. Tels furent Sahan,
‘W ay e l, 6c fur-tout Kofliis : ceux qu’ils défignerent
par le titre de chated, étoient pâtres , aftrologueS,
muficiens, médecins, poètes, légiflateurs 6c prêtres ;
caractères qu’on ne trouve jamais réunis dans une
même perfonne, que chez les peuples barbares &:
fauvages. Ouvrez les faites des nations; 6c lorfqu’ils
vous entretiendront d’un homme chargé d’interpre-
ter la volonté des dieux , de les invoquer dans les
tems de calamités générales, de chanter les faits mémorables
, d’ordonner des entreprifes, d’infliger des
châtimens , de décerner des récoinpenfes , de pref-
crire des lois eccléfiaftiques , politiques 6c civiles ,
de marquer des jours de repos 6c de travail, de lier
ou d’abloudre, d’afîembler ou de difperfer, d’armer
ou de defàfmer , d’impofer les mains pour guérir ou
pour exterminer; concluez que c’eft le tems de la
profonde ignorance. A mefure que la lumière s’accroîtra
, vous verrez ces fondions importantes fe fé-
parer; un homme commandera ; un autre facrifiera ;
un troifieme guérira ; un quatrième plus facré les im-
mortalifera par fes chants.
Les Arabes avoient peut-être avant l’iflamifme
quelques teintures de poéfie 6c d’aftrologie , telles
qu’on peut les fuppofer à un peuple qui parle une
langue fixée, mais qui ignore l’art d’écrire.
Ce fut un habitant d’Ambare, appellé Moramere
qui inventa les caraderes arabes peu de tems avant
la naiflance de Mahomet, 6c cette découverte demeura
fi fecrette enfre les mains des coraishites, qu’à
peine fe trouvoit-il quelqu’un qui fut lire l’alcoran
lorfque les exemplaires commencèrent à s’en multiplier.
Alors la nation étoit partagée en deux clafles,
l’une d’érudits, qui favoient lire , & l’autre d’idiots.
Les premiers réfidoient à Médine ? les féconds à la