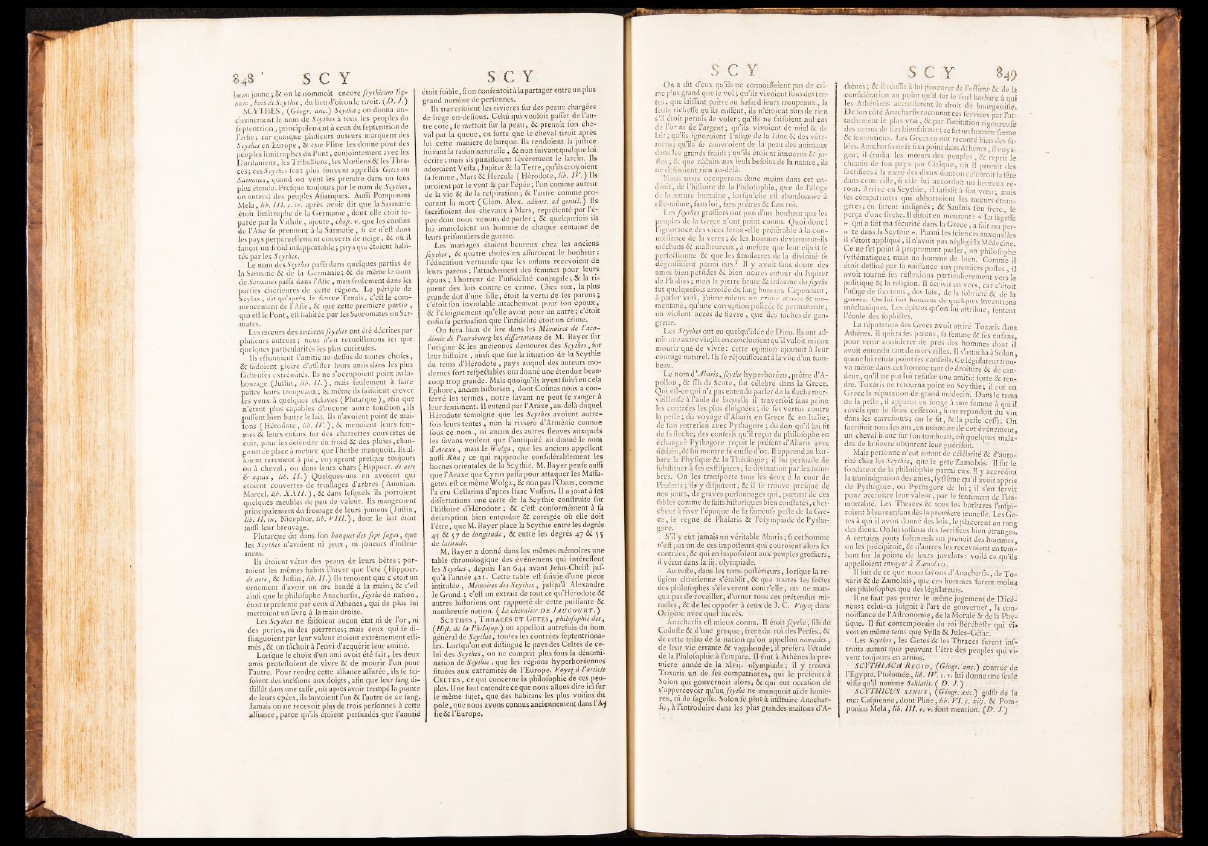
M ' S C Y
?æaiî jaunie ; Sc o n lç nommoit encore fcythicvm hg-
num, bois.deScyihie, du lieu d’où on le tirp.it. (ZL J•)
.SCYTHES, (Géogr. ««c.) Scythes.; on donna anciennement
le nom de Scythes à tous les peuples du
Septentrion principalement à ceux du Septentrion de
J’Afie ; car quoique plufieurs auteurs marquent des
Scythes en Europe, & que Pline les donne pour des
peuples limitrophes du Pont, conjointement avec les
Dardaniens, les Tribaüiens, les Moefiens 6c les Thra-
çes', ces Scythes font plus fouvent appelles G eus ou
Spniuius, quand on veut les prendre dans un fens
plus étendu. Prefque toujours par le nom de Scythes ,
on entend des peuples Asiatiques. Au®. Pomponius
Mêla, iib. I II. c. jv. après avoir dit .que la Sarmatie
étoit limitrophe de la Germanie, dont elle étoit le-
paré.e par la Vilîule, ajoute, chap. v. que les confins
de l’Afie fe prennent à la Sarmatie, fi ce n’eû.daos
les pays perpéniellement couverts de neige , 6c OÙ H
faiioit un froid infupportable ; pays qui étoient habites
par les Scythes.
Le nom des Scythes paffa dans quelques parties de
•la Sarmatie 6c de la .Germanie; 6c de même le nom
■ d.e S arma tes paffa dans l’Afie, mais feulement dans les
parties citérieures de cette région. Le périple de
-Scylax, dit qu’après le fleuve Tamais, c’eft le commencement
de l’Afie, & que cette première partie ,
•qui eft le Pont, eft habitée par les Sauromat.es o.u Sar-
ma,tes. .■
Les moeurs des anciçfts fcythes ont .été décrites par
niuiicurs auteurs ; nous n’en recueillerons ici que
quelques particularités les plus çurieufes.
Ils eftii noient l’amitié au-deffus de toutes chofes,
& faifoient gloire d’affiller leurs amis dans les plus
fâcheufes extrémités. Ils ne s’occupoient point au labourage
(Juftin, ûp. I I .) y mais feulement à faire
paître leurs troupeaux; 6c même ils faifoient crever .
les yeux à quelques eiclaves (Plutarque) , afin que
n’étant plus capables .d’aucune autre fon.£lion , ils
puffentbien battre le lait. Ils n’avoient point de mai-
îons (Hérodote, lib. I F . ) , & menoient leurs femmes
& leurs enfans fur des charrettes couvertes de
cuir, pour les défendre du froid & des pluies, changeant
de place à mefure que l'herbe manquoit. Ilsal-
loient rarement à p ié , voyageant prefque toujours
nu à cheval, ou dans leurs chars (Hippoer. de acre
.& aquis, lib. II. ) Quelques-uns en avoient qui
étoient couvertes de feuillages d’arbres (Ammian.
Marcel, lib. X X I I . ) , 6c dans lefquels ils portoient
quelques meubles de peu de valeur. Ils mangepient
principalement du fromage de leurs jumens .( Juftin,
iib. IL ix. Nicephor. lib. RIII. ) , dont le lait étoit
•au® leur breuvage.
Plutarque dit dans fon banquet des fept fages, que
les Scythes n’avoient ni jeux, ni joueurs d’inftru-
mens.
Ils étoient vêtus des peaux de leurs bêtes ; portoient
les mêmes habits l’hiver que l’été (Hippoçr.
de aere, & Juftin, lib. II.) fis tenoient que c’étoit un
ornement d’avoir un arc bandé à la main ; 6c c’eft
ainfi que le philofophe Anacharfis ,fcythe de nati.on ,
étoit repréfenté par ceux d’Athènes , qui de plus lui
mettoient un livre à la main droite.
Les Scythes ne faifoient aucun état ni de l’o r , ni
des perles, ni des pierreries; mais ceux qui fe di-
Üinguoi.ent par leur valeur étpient extrêmement efti-
més, & on tâchoit à l’enyi d’acquérir leur amitié.
Lorfque le choix d’un ami avoit été fait, les deux
amis proteftoient de vivre 6c de mourir l’un pour
l’autre. Pour rendre cette alliance affurée, ils fe faifoient
des incifions aux doigts, afin que leur fang di-
ftillât dans une taffe, où après avoir trempé la pointe
de leurs épées, ils buvoient l’un & l’autt'e de .ce fang.
Jamais on ne recevoit plus de trois p.crfonnes à cette
alliance, parce qu’ils etoient perfuadés que l’aniitié
S C Y
étoit foîble, h oc confentoit à la partager entre un plus
grand nombre de perfonnes.
Ils tra versent les rivières fur des peaux chargées
d.e liège en-deflous. Celui qui vouloit paffer de l’autre
côté, fe roettoit fur la peau, 6c prenoit fon cheval
par la queue, en forte que le cheval .droit après
lui cette maniéré de barque. Ils rendoient la juftice
fuivant la raifon naturelle , & non fuivan'tquelque loi
écrite;mais ilspuniffoient févèrementle larcin. Ils
adoroient Vefta, Jupiter & la Terre, qu’ils çroyoient
fa femme, Mars 6c Hercule ( Hérodote, lib. IP .) Ils
juroientpar lèvent St par l’epee; l’un comme auteur
de la vie 6c de la refpiration ; & l'autre comme pro-j
curant la mort (Clém. Alex, adhort. ad gentil:) II»
facrifioient des chevaux à Mars, repréfenté par l’é*
pée dont pous venons de parler ; 6c quelquefois ils,
Lui immoloient un homme de chaque centaine de
leurs prifonniers de guerre. . ;
Les mariages étoient heureux chez les anciens
feythes, 6c quatre chofes en affûtaient le bonheur :
l’éducation vertueufe que les enfans recevoient dè.
leurs parens ; l’attachement des femmes pour leurs
époux ; 1 horreur de l’infidélité conjugale ; & la ri-*
gueur des lois contre ce crime. Chez eux, la plus
grande dot d’une fille, étoit la vertu de fes parens ;
c’étoit fon inviolable attachement pour fon époux ,
& l’éloignement qu’elle avoit pour un autre ; c’étoit
enfin fa perlùafion que l’infidélité étoit un crime.
On fera bien de lire dans les Mémoires de Vaca.s
démit de Petersbourg Les dijfsnations de M. Bayer fur
l’origine & les anciennes demeures des Sçythts, fur
leur hiûoire , ainfi que fur la fituation de ia Scythie
du tems d’Hérodote, pays auquel des auteurs modernes
fort refpeûables ont donné une étendue beau»
coup trop grande. Mais quoiqu’ils ayentfuiviencela
Ephore, ancien hiftorien , dont Cofmas nous a con^
fervé les termes , notre favant ne peut fe ranger à
leur fentiment. Il entend par l’Araxe, au-delà duquel
Hérodote témoigne que les Scythes avoient autrefois
leurs tentes, non là riviere d’Arménie connue
fous ce nom , ni aucun des autres fleuves auxquels
les favans veulent que l’antiquité ait donné le nom
d’Araxe, mais le Wolga, que les anciens appellent
au® Rha ; ce qui rapproche confidérablement les
bornes orientale? de la Scythie. M. Bayer penfe au®
que l’Araxe queCyrus paffa pour attaquer les Maffa-
getes eft ce même Wolga, .& non pas l’Ôxus, comme
l’a cru Cellarius d’après Ifaac Volfius. Il a joint à fes
differtations une carte de la Scythie conftruite fur
l’hiftoire d’Hérodote ; & ‘ c’eft conformément à fa
defeription bien entendue 6c corrigée où elle doit
l’être, que M. Bayer place la Scythie entre les degrés
45 & ,57 de longitude , & entre les degrés 47 & 55
de latitude.
M. Bayer a donné dans les mêmes mémoires une
table chronologique des événemens qui intéreffent
les Scythes , depuis l ’an 644 avant Jelus-Çhrift juf-
qu’à l’année 4 11. Cette table eft fuivie d’une piece
intitulée , Mémoires des Scythes , jufqu’à Alexandre
le Grand ; c’eft un extrait de tout ce qu’Hérodote &
autres hiftoriens ont rapporté de cette puifl'ante 6c
nombreufe nation. ( Le chevalier d e J a u c o u r t .)
S c y t h e s , T h r a c e s e t G e t e s , philofophie des9
(Hijl. de la Philojop.) on appelloit autrefois du fiom
général de Scythie, toutes les contrées feptentriona-
les. Lorl’qu’on eut diftingué le pays des Celtes de celui
des Scythes, on ne comprit plus fous la dénomination
de Scythie , que les régions hyperboréennes
fituées aux extrémités de l ’Europe. Foye^à l'article
C e l t e s , ce qui concerne la philofophie de ces peuples.
11 ne faut entendre ce que nous allons dire ici fur
le même fujet, que des habitans les plus voifins du
pôle, que nous avons connus anciennement dans I’Aj|
lie 6c l’Europe.
S C Y
Ôn a dit d’eux qu’ils ue connoiffoient pas de crime
plus grand que le vol ; qu’ils vivoient fous des ten-
tes ; {que laiffant paître au hafard leurs troupeaux, la
feule richeffe qu’ils euffent, ils ïi’étoient sûrs de rien
s’il étoit permis de voler; qu’ils ne faifoient nul cas
de l’or ni de l’argent ; qu’ils vivoient de miel & de
Tait ; qu’ils ignoroient l’ufage de la laine & des vête-
meos ; qu’ils fe couvroient de la peau des animaux
dans les grands froids; qu’ils étoient innocens & ju-
ftes ; & qu.e réduits aux feuls hefoins de la nature, ils
ne clefiroient rien au-delà^
Nous no.us occuperons donc moins dans cet endroit,
de l ’hiftoire de la Philofophie, que de l’éloge
de la nature humaine, lorlqu’elie eft abandonnée à
elle-même, fans lo i, fans pretres 6c fans roi.
Les feythes greffiers ont joui d’un bonheur que les
peuples de la Grece n’ont point connu. Quoi donc i
l’ignorance des vices feroit-elle préférable à la conn.
oiffance de la vertu ; 6c les hommes deviennent-ils
médians ^ malheureux, à mefure que leur efprit fe
perfe&ionne & que les jimulacres de la divinité fe
dégroffiffenf parmi eux ? Il y avoit fans doute des
âmes bienpprfides 6c bien noires autour du Jupiter
de Phidias ; mais la pierre brute 6c informe du feythe
fut quelquefois arrofée du fang humain. Cependant ,
à parler vrai, j’aime mieux un crime atroce 6c rao-.
mentané, qu’une corruption policé? & permanente;
un violent accès de fievré , que 'des taches de gan-
greiîe-
Les Scythes ptlt eu quelqu’idée de Dieu. Ils ont admis
u ne autre vie;ils en concluoient qu’il valoit mieux
mourir qué de vivre : cette opinion ajoutoit à leur
courage naturel. Ils fe réjouiffoient à la vue d’un tombeau.
Le'nOm d'Abaris y feythe hyperboréen, prêtre d’A»
pollon, & fils dë Scute, fut célèbre dans la Grece.
Qui eft-cè' qui n’a pas entendu parler de la fléché mer-
vêilleufe à l’aide de laquelle il traverfoit fans peine
les contrées lës plus éloigriées.; de fes vertus contre
la pefte; du voyage d’Abaris.en Grece 6c en Italie;
de fon entretien avec Pythâgore ; du don qu’il,lui fit
de.fa fléché; .des çonfeils qu’il reçut du philofophe en
échange ? Py tliagore reçoit le préfent d’Abaris âVec
dédain,& lui montre fa cuiffe d’or. Il apprend au barbare
la Phyfîqiie 6c la Théologie; il lui perfuade de
fubftituer à fes éxftifpices, la divination par lés. nôm-
brési Gri lés tranfporte tous les deux à la cour dë
Phalaris ;. ils y difpuîent ; & il fe trciuve préfaùè de’
nos jours, de’gràvés-perfonnages qui, partant de ces
fables comme défaits hiftoriques bien conftatés, cherchent
à fixer l’époque dé- làfamétife pefte de là Grèce
, le régné-' de Phàlaris & l’olympiade de'Pytha-
g°re* ....................
. S’il y eut jamais un véritable Abaris ; fi cet homme
n’eft pas. ùrt de ces im.pofteurs,q«i èouroient alors les
contrées, & qui en impofoient aux peuples groffiërs,
il vécut dans la iij. olympiade.
Au refte^ dans les teins poftérieurs, lorfque la re-
hgiôni chrétienne s’établit,& que toutes les feéïes
des philofophes s’élevèrent contr’elle, Ôn ne manqua
pas de revoilier, «l’orner tous ces prétendus miracles
,& -d é lés oppofër à ceiix de J. C. Foye^ dans1
Origèri? avec queî'fiiieeès. -'•-•
Anacharfis eft mieux connu. Il étoit- fcythé\P\ls déi
Gadufte &,d: ’uné greque j -frërè chu rôi dés Per fes,. 6c
de cette tribu de. la nation .qu’ÔO appelloit nomades
de leur vie errante & vagaho!ade:>'ft préféra l’étiidë
de, la Philofophie à l’empirei il Vint à Athènes la-pre-
mi,erei aun.éë jde la; xlvij. olympiade,; i l y .troiivà
ToxariS) uu de fesi compatriojtesj. qui le: préfenta à
$ôlon q® gouvernoit àlorsh Oi qui ; eut oçeàfion cfâ
s’appercevoir qu’ut\fcytke nebmanquoit uide lumië-
res, nide.fageffe.- Solon fe .plut à infthuire Anachaf-
Lü, à l’introduire dans les plus grahdes.maifpns d’A^
S C Y 849
thènes,; & il réunit à lui#octirerde l’eftimê i t Ai là
.coofidération au point:qn’il fut ie feul barbare à triii
les Athéniens accordèrent le droit dë boitrèebififi
De Ion côté Anacharfis reconnut ccs fcrviccs par l’ap
tach'ement le plu? v rai, & par l’imitatiôn rigôureufê
des vertus de fon bienfaiteur ; ce fuutn homme fermd
■ & fenteïitieux. Les Grecs eu ont raconté bien des fa=
bles. Anacharfis nefe fixa prantdahs Athènes, ilVoyàt
gea; il étudia les nuenrs des peuples., =& reprit lé
chemin rie fon pays par Oizique, -où il: promit des
-facnficès à la meredes.dieux donton-eélébroit'lafêtci
dans cette v ille, fi elle lui accorci oit Un héurëux ré~
rôtir. Arrivé en Scythie, i l fatisfit à fon voeu ; mais
fes compatriotes qui abhorroient les moeurs êtran-
gëros, en. forent indigiiés>; & Saülnis fêta ïrerè lé
perça d’une fléché.-Ibdifoit en niou.’ er.t : « La fageffé
» qui a fait ma féairité dans la (,re ce, a fair ma per-
» le dans la Scythie. », Parmi les f'ciences auxquelles
rl s’étoit applique, il n'avoit pas négligé la Médecine.
Ce n;e ta: point à proprement parler,'un philbfophé
lytiématique ; mais un homme de bien. Connue il
étoit defiàné par fa naiffance aux premiers boftes, il
avoit tourné fes réflexions, pal'ticuiiefëhléiffé'érslà
politiquei& la religion. Il écrivit en vers, car c’étoit
Pillage de fon tems, des lois ; de la fobriété & de là
guerre. -Qu lui faü .honneur de quélquesimyélitions
méchaniques. Les épîtres qu’on lui attribue, lentcnt
l’école des fophiftes.
Le réputation des Grecs avoit attire Toxàri's dans
Athènes. Il quitta fes parens, fa femme 6c fes enfans
pour venir éonfiderer cfe près des hommes d'orit il
avoit entendu tant de merveilles. Il s’attacha à Sôlonj
qui ne lui réfuta point fes êonfeils. Ce légiflateiir trouva
même dans cet.homme tant de.droiture & de candeur,
qu’iln e put lui refufer une amitié forte & tendre.
Toxàris ne retourûa point en Scythie; il eut en
Grece la réputation, deegrand médecirt1. Dans le tems
de la pefte, il apparut en fonge à une femme à qui il
révéla que le fléau cefféroit, fi on reparidôit du vin
dans lès carrefours;'ipn le fit, 6c la pefte ceffa. On
facrifioit tous les ans, en mémoire dé'cet événement*
un cheval b anc fiir ton tômboaii, oit quëlqiiés' iïiala—
dés de la fièvre obtinrent leur giiérifod. :
Mais perfonne n’eut àùtarit de c é lé b r i t é f f ’âütô^
rité chez 1 es Scythes9 que le gete Zamo'Ixis. Il fut le
fondateur de: la philofophie parmi eux. Il y accrédita
la tranfnïigration des âmes, fyftême qu’il àvBft appris
de Pythâgore;;ou Pythâgore de lui; il s’en'fervif
pour accroître leur valeur, par lé fentiment de l’iôï-
mortalitë; Les Thracés 'c? tous lës balbâré? finfpi-
roient à'ieursèufans dès la preihiere jeuneffe. Les Getes
à qui il avoit donné des lois, le placèrent au rari®-
des dieux. Op lui inftitua des facrifices bien étranges*
A certai^^Qip,.fqî?®neL,,ctfi. prenoit des hommes
on res'p:récipitoit, & d-aiitres,lés recevoient en tombant
fui; la poihte de (eurs javelots : voilà ce qu’ils
appelloient envoyer à Zajnôlxis.
Il fuit de ce que nous favqns d’Anaçhàrfis, de T o-
xaris & d e Zamolxis , qtie ëës liömnies furent moins
des philofophes que dés légiflàt-eUrs.
Il ne faut-pas porter le toêttië jugemerif dè- Dfeé^
neus ; cèlui-ci joignit :à-Tairt' :dè gouverne^ j l‘à: éon-
noiffance dëTAftrOnomie’^iîë la Mçftalé‘& dé:lâ Phy-
fique. Il fût contéiiipôraiô dit roi ’Bërébè'fîe qui Vi^
voit en mëme'tëms qü'ë Sylîà & Jules-Géfar.
• Les Scythes f ù s Getès & les Thràces furent îrif-
truits -autant que’ péivVeht 1 etrè des peuplés'-ÿp.vivent
touj ours en armes1.-« 1
- SCYTfHACÀ R eg io-, '£(3éój£r,l 'ttricff cj3ttfréë*'de
l’Egyptë; Ptoioméeij lib. IF. c. v. lui- ddniïe. une feulé
SCŸTHICUS s in u s y (Gébgr. artcf golfe, de là
mer Câfpiënfië ,••dont Pline , lib. FI. p. xiij. 6c Pôm-'
ponius Mêla , libt ///, Vrfôhï-rnentioxi. (Z>. J.) r