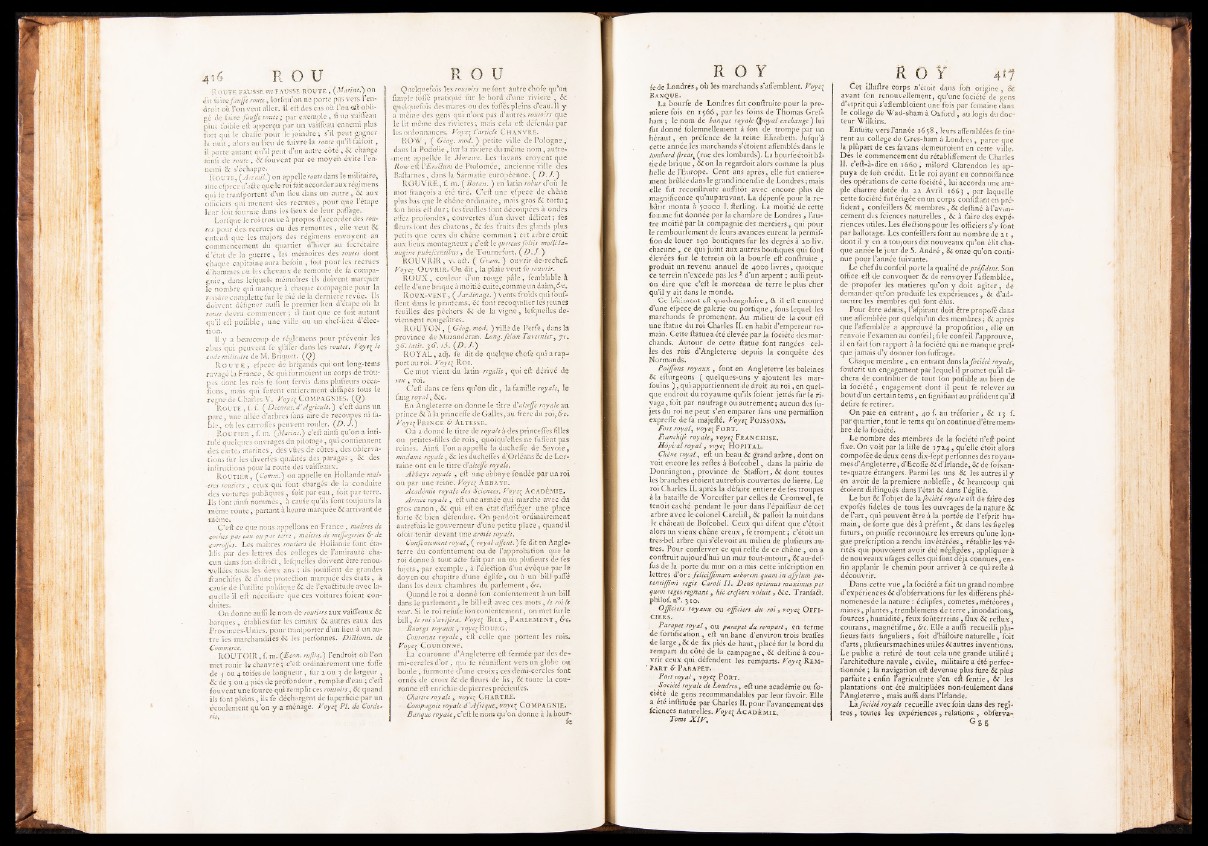
R O U
R oute fausse ou fausse route , {Marine.') ôn
«lit fairtfaujfc route, lorfqit’on. rie porte pas vers l'endroit
où l’on veut aller. 14 èlt des cas où l’on eft obli-
oé de faire f auj j£ route ; par exemple , fi un vaiffeau
plus foible eft apperçu par un vaiffeau ennemi plus
fort qui le chafle pour le joindre ; s’il peut gagner
la n u it, alors‘audieu de luivre la rouie qu’il faifoit ,
il porte autant qu’il peut d’un autre cote , & change
ainfi de route , 6c fouvent par ce moyen évite l’ennemi
& s’échappe.
R o ute, (Art mil.') on appelle route dans le militaire,
ifne efpcce d’afte quele roi fait-accorder aux régimens
qui le tranfportent d’un lieu dans un autre, 6c aux
officiers qui mènent des recrues, pour que l’étape
leur foit fournie dans les lieux de leur paffage.
•Lorfque le roi trouve à propos d’accorder des routes
pour des. recrues ou des remontes , elle veut 6c
entend que les majors des régimens envoyent au
commencement du quartier d’hiver au lecretaire
d ’état de la guerre, les mémoires des routa dont
chaque capitaine aura befoin , foit pour les recrues
d’hommes ou les chevaux de remonte de fa compagnie
, dans lefquels mémoires ils doivent marquer
le nombre qui manque à chaque compagnie pour la
rendre complette fur le pie de la derniere revue. Ils
doivent défigner auffi le premier lieu d’étape où la
route devra commencer ; il faut que ce foit autant
qu’il eft poffible, une ville ou un chef-lieu d élection.
U y a beaucoup de réglcmens pour prévenir les
abus qui peuvent fë glifler dans les routes. Foyc{ Le
-code militaire de M. Briquet. (Q)
R o u t e , efpece de brigands qui ont long-tems
ravagé la France, 6c qui formoient un corps de troupes
dont les rois fe font fervis dans plufieurs occa-
fions, mais qui furent entièrement diffipés lous le
régné de Charles V. Foye^ Compagnies. (Q)
Route , f. f. ( Décorât. d’AgricuU. ) c’eft dans un
parc, une allée d’arbres fans aire de recoupes ni fable,
où les carroffes peuvent rouler. (D . J.)
Routier f. m. (MarinèfiC eft ainii qu’on a intitulé
auelques ouvrages du pilotage, qui contiennent
des cartes marines, des vues de côtes, des obferva-
•tions fur les divèrfes qualités des parages^ 6c des
jnftruâions pour la route des vaiffeaux.
R outier , (Comm.) on appelle en Hollande maîtres
routiers , ceux qui font ehargés: de la conduite
des voitures publiques , foit par eau, foit par terre,
ils font ainfi nommés , à caufe qu’ils font toujours la
même route, partant à heure marquée 6c arrivant de
•même.
C’ eft ce que nous appelions en France , maîtres de
coches par eau ou par terre , maîtres de meffiageries & de
*arroffis. Les maîtres routiers de Hollande font établis
par des lettres des colleges de l’amirauté chacun
dans fon diftricl:, lefquelles doivent être renou-
’veliées tous les deux ans ; ils jouiffent de grandes
franchifes 6c d’une protettion marquée des états , à
caul'e de l’utilité publique 6c de l’exa&itude avec laquelle
il eff néceffaire que ces voitures foient conduites.
'
On donne auffi le nom de routiers aux vaiffeaux 6c
barques , établies fur les canaux 6c autres eaux des
Provinces-Unies, pour tranfporter d’un lieu à un autre
les marchandises 6c les perfonnes. Diclionn. de
Commerce.
ROUTOIR, f. m. (Écon. rujliq.') l’endroit où l’on
met rouir le chanvre ; c’eft ordinairement une foffe
de i ou 4 toifes de longueur, fur z ou 3 de largeur ,
& de 3 ou 4 piés de profondeur, remplie d’eau ; c’eft
fouvent une fource qui remplit ces routoirs, & quand
ils font pleins, ils fe déchargent de fuperficie par un
écoulement q u ’o n y a ménagé. Foye{ PI. de Corde
R O U
Quelquefois les routoirs ne font autre choie qu’un
fimple foffé pratiqué fur le bord d’une riviere , 6c
quelquefois des mares ou des foffés pleins d’eau. Il y
a même des gens qui n’ont pas d’autres routoirs que
le lit même des rivières ; mais Cela eft défendu par
les ordonnances. Foye\ Varticle C h anvre.
R OW , ( Géog. mod. ) petite ville de Pologne,
dans la Podolie, fur la riviere du même nom, autrement
appellée le Morawe. Les "favans croyent que
Row eft YEraclum de Ptolomée, ancienne ville des
Baftarnes , dans la Sarmatie européenne. ( D
ROUVRE, f. m. (Botan. ) en latin rôbur d’où le
mot françois a été tiré. C’eft une efpece de chêne
plus bas que le chêne ordinaire, mais gros 6c tortu ;
Ion bois eft dur; fesfeuilles font découpées à ondes
allez profondes, couvertes d’un duvet délicat ; les
fleurs font des chatons, 6c fes fruits des glands plus
petits que ceux du chêne commun ; cet arbre1 croît
aux lieux montagneux ; c’eft le quercus joliis molli la-
nugint pubefcentibus, de Tournefort. ( D .J . )
ROUVRIR, v\ aft. ( Gram. ) ouvrir de-rechefl
Foyer Ou vrir. On dit, la plaie veut fe rouvrir.
R O U X , couleur d’un rouge pâle, femblable à
celle d’une brique à moitié cuite,comme un daim, &c.
R oux-vent , ( Jardinage. ) vents froids quiSoufflent
dans le printems, 6c font recoquiller les jeunes
feuilles des pêchers 6c de la vigne, lefquelles deviennent
rougeâtres.
RO U YON , ( Géog. mod. ) ville de Perfe, dans la
province de Mazandéran. Long, félon Tavernier} y u H ■ - —, . . R O YA L , adj. fe dit de quelque chofe qui a rapport
au roi. Foye{ Roi.
Ce rfiot vient du latin rcgalis, qui eft dérivé de
rex, roi.
C’eft dans ce fens qu’on dit, la famille royale, le
fang royal, &c. '•
En Angleterre on donne le titre d'altejfe royale au
prince 6c à la princeffe de Galles, au frere du roi,&c*
Foye{Prin ce & Altesse.
On a donné le titre de royale à des princeffes filles
ou petites-filles de rois, quoiqu’elles ne fufl'ent pas
reines. Ainfi l’on a appelle la ducheffe de Savoie,
madame royale, 6c les ducheffes d’Orléans 6c de Lorraine
ont eu le titre d7alteffe royale.
Abbaye royale , eft une abbaye fondée par Un roi
ou par une reine. Voÿe^Ab b ay e .
Académie royale des Sciences. Fôye£ A CAD EM IE .
Armée royale , eft une armée qui marche avec dit
gros canon, 6c qui eft en état d’affiéger une place
forte 6c bien défendue. On pendoit ordinairement
autrefois le gouverneur d’une petite place, quand il
ofoit tenir devant une armée royale.
Confentement royal, ( royal ajjent. ) fe dit en Angleterre
du confentement ou de l’approbation que le
roi donne à tout a£!e fait par un ou plufieurs de fes
fujets, par exemple , à l’éle&ion d’un évêque par le
doyen ou chapitre d’une églife , ou à un bill-paffé
dans les deux chambres du parlement, &c.
Quand le roi a donné fon confentement à un bill
dans le parlement, le bill eft avec ces mots, le roi le
veut. Si le roi refufe ion confentement, on met fur ie
bill, le roi s'avifera. Foyt\ Bill , PARLEMENT, <S*c.-
Bourgs royaux , voyeç BOURG.
■ Couronne royale, eft; celle que portent les rois/
Foyef COURONN E.
La couronne d’Angleterre eft fermée par des demi
cercles d’o r , qui fé réunifient vers un globe ou
boule, furmonté d’une croix; ces demi-cercles font
ornés de croix 6c de fleurs dé lis , 6c toute la couronne
eft enrichie de pierres précieufes.
- Chartre royale , voye^ CHARTRE.
- Compagnie royale d7Afrique, voyeç COMPAGNIE.
Banque royale, c’eft le nom qu’on donne à la bourfe
R O Y
fede Londres, où les marchands s’affemblent. Foyè^
Banque.
La bourfe de Londres fut conftruite pour la première
fois en 1566, par les foins de Thomas Gref-
ham ; le nom de banque royale (\royal ex change ) lui
fut donné folemnellement à fon de trompe par un
héraut, en préfence de la reine Elizabeth. Jufqu’à
cette année les marchands s’étoient affemblés dans le
lombard /beatj. (rue des lombards). La bourfe étoit bâ-
tiede brique, 6c on la regardoit alors comme la plus
belle de l’Europe. Cent ans après, elle fut entièrement
brûlée dans le grand incendie de Londres ; mais
elle fut reconftruite auffitôt avec encore plus de
magnificence qu’auparavant. La dépenfe pour la rebâtir
monta à 50000 1. fterling. La moitié de cette
fomme fut donnée par la chambre de Londres, l’autre
moitié par la compagnie des merciers, qui pour
le rembourfement de leurs avances eurent la permif-
fion de louer 190 boutiques fur les degrés à zo liv<
chacune , ce qui joint aux autres boutiques qui font
élevées fur le terrein où la bourfe eft conftruite $
produit un revenu annuel de 4000 livres, quoique
ce terrein n’ excede pas les ~ d’un arpent ; auffi peut-1
on dire que c’eft le morceau de terre le plus cher
qu’il y ait dans le monde.
Ce bâtiment eft quadrangulaire, & il eft entoüré
d’une efpece de galerie ou portique, fous lequel les
marchands fe promènent. Au milieu'de la cour eft
une ftatue du roi Charles II; en habit d’empereur romain.
Cette ftatue a été élevée par la fociété des marchands.
Autour de cette ftatue font rangées celles
des rois d’Angleterre depuis la conquête des
Normands.
Poiffons royaux , font en Angleterre les baleines
6c efturgeons ( quelques-uns y ajoutent les mar-
fouins ) , qui appartiennent de droit au ro i, en quelque
endroit du royaume qu’ils foient jettés fur le rivage,
foit par naufrage ou autrement ; aucun des fujets
du roi ne peut s’en emparer fans une permiffion
expreffe de fa majefté. Voye^ P o i s s o n s »
Fort royal, voye{ FO R T .
Franchife royale, voye^ FRANCHISE.
Hôpital royal , voye\ H O P ITA L .
Chêne royal, eft un beau 6c grand arbre, dont on
voit encore les reftes à Bofcobel, dans la pairie de
Donnington , province de Staffort, & dont toutes
les branches étoient autrefois couvertes de lierre. Le
roi Charles IL après la défaite entière de fes troupes
à la bataille de Vorcefter par celles de Cromvel, fe
tenoit caché pendant le jour dans l’épaiffeur de cet
arbre avec le colonel Carelifl, 6c paffoit la nuit dans
le châteaü de Bofcobel. Ceux qui difent que c’étoit
alors un vieux chêne creux, fe trompent ; c’étoit un
très*bel arbre qui s’élevoit au milieu de plufieurs autres.
Pour Gonferver ce qui refte de ce chêne., on a
conftruit aujourd’hui un mur tout-autour, 6c au-def-
fus de la porte du mur on a mis cette infeription en
lettres d’or : feliciffimam arborem quant in afylum po-
tentifjimi regis Caroli II. Detis optimus maximus per
quern reges régnant, hîc crefcere voluit f &c. Tranfaéh
philof. np. 310.
Officiers royaux ou officiers du roi, voyeç O F F I CIERS.
Parapet royal, ou parapet du rempart, en terme
de fortification , eft un banc d’environ trois braffes
de large, 6c de fix. piés de haut, placé fur le bord du
rempart du côté de la campagne, 6c deftiné à couv
r ir ceux qui défendent les remparts. Foye^ Rem-
■ part & Parapet.
Port royal, voyeç P o r t .
. Çoriete royale de Londres, eft une académie ou fo-
g g | | .fie gens recommandables par leur favoir. Elle
a ete inftituee par Charles II. pour l’avancement des
fciences naturelles. Foyer A cad ém ie .
Tome X IF ,
R O Y 4*7
Cët îlliiftre corps n’étoit dans fofi origine, St
avant fon renouvellement, qli’une fociété de gens
d’eiprit qui s’aflèmbloient une fois par femaine dans
le college de 'Wad-sham à Oxford, au logis du docteur
Wilkins.
Enfuite vers l’année 1658, leurs affembléës fe tinrent
au college de Gres-ham à Londres, parce que
la plûpart de ces favans demeuroient en cette ville*
Dès le commencement du rétabliffement de Charles
II. c’eft-à-dire en 1660 i milord Clarendon les appuya
de fon crédit. Et le roi ayant eu connoiffance
des opérations de cette fociété, lui accorda une ample
chartre datée du n Avril 1663 , par laquelle
cette fociété fut érigée en un corps confiftant en pré^
fident, confeillers & membres, & deftiné à l’avancement
des fciences naturelles , 6c à faire des expé±
riences utiles. Les éleâions pour les officiers s’y font
par ballotage. Les confeillers font au nombre de z 1 ,
dont il y en a toujours dix nouveaux qu’on élit chaque
année le jour de S. André, 6c onze qu’on continue
pour l’année fuivante.
Le chef du confeil porte la qualité de prefident. Sort
office eft de convoquer & de renvoyer l’affemblée,
de propofer les matières qu’on y doit agiter, de
demander qu’on produife les expériences, & d’admettre
les membres qui font élus.
Pour être admis, l’afpirant doit êtrepropofé dans
une affemblée par quelqu’un des membres ; & après
que l’affemblée a approuvé la propofition , elle en
renvoie l’examen au confeil; fi le confeil l’approuve^
il en fait fon rapport à la fociété qui ne manque preP
que jamais d’y donner fon fiiffrage*
Chaque membre , en entrant dans la fociété royale,
fouferit un engagement par lequel il promet qu’il tâchera
de contribuer de tout fon poffible au bien de
la fociété, engagement dont il peut fe relever aü
bout d’un certain tems ,• en fignifiant au prefident qu’il
defire fe retirer.
On paie eri efitrânt, 40 f. au tréfôrier, & 13 f.
par quartier, tout le tems qu’on continue d’être membre
de la fociété.
Le nombre des nîefnbrés de la fociété rî’eft point
fixe. On voit par la lifte de 1724 , qu’elle étôit alors
compofée de deux cens dix-fept perfonnes dés royaumes
d’Angleterre, d’Ecoffe 6c d’Irlande, 6c de foixan-
te-quâtre étrangers. Parmi les uns 6c les autres il V
en avoit de la première nobleffe , 6c beaucoup qui
étoient diftingués dans l’état 6c dans l’églife.
Le but 6c l’objet de la fociété royale eft de faife des
expofés fideles de tous les ouvrages de la nature 6c
de l’art, qui peuvent être à la portée de l’efprit humain,
de forte que dès à préfent, 6c dans les fiecles
futurs, on puiffe reconnoitre les erreurs qu’une longue
prefGription a fendu invétérées, rétablir les vérités
qui pouvoierit avoir été négligées, appliquer à
de nouveaux ufages celles qui font déjà connues, enfin
applanir le chemin pour arriver à ce qui refte à
•découvrir.
Dans cette v u e , la fociété a fait ün grand nombre
d’expériences 6c d’obfervations fur les différens phé-*
nomenes de la nature : éclipfes, cpmetes,météores $
mines, plantes, tremblemens de terre, inondations,
foufees , humidité, feux foutefreins , flux 6c reflux ,
courans, magnétifme, &c. Elle a auffi recueilli plufieurs
faits finguliers, foit d’hiftoire naturelle , foit
d’arts, plufieurs machines utiles & autres inventions*
Le public a retiré de tout cela une grande utilité ;
l’architeélure navale, civile, militaire a été perfectionnée
; la navigation eft devenue plus fure & plus
parfaite ; enfin l’agricultute s’en eft fentie, & les
plantations ont été multipliées non-feulement dans
l’Angleterre, mais auffi dans l’Irlande;
La fociété royale recueille avec foin dans des regî-
tres, toutes les expériences y relations , obferva«
G g g