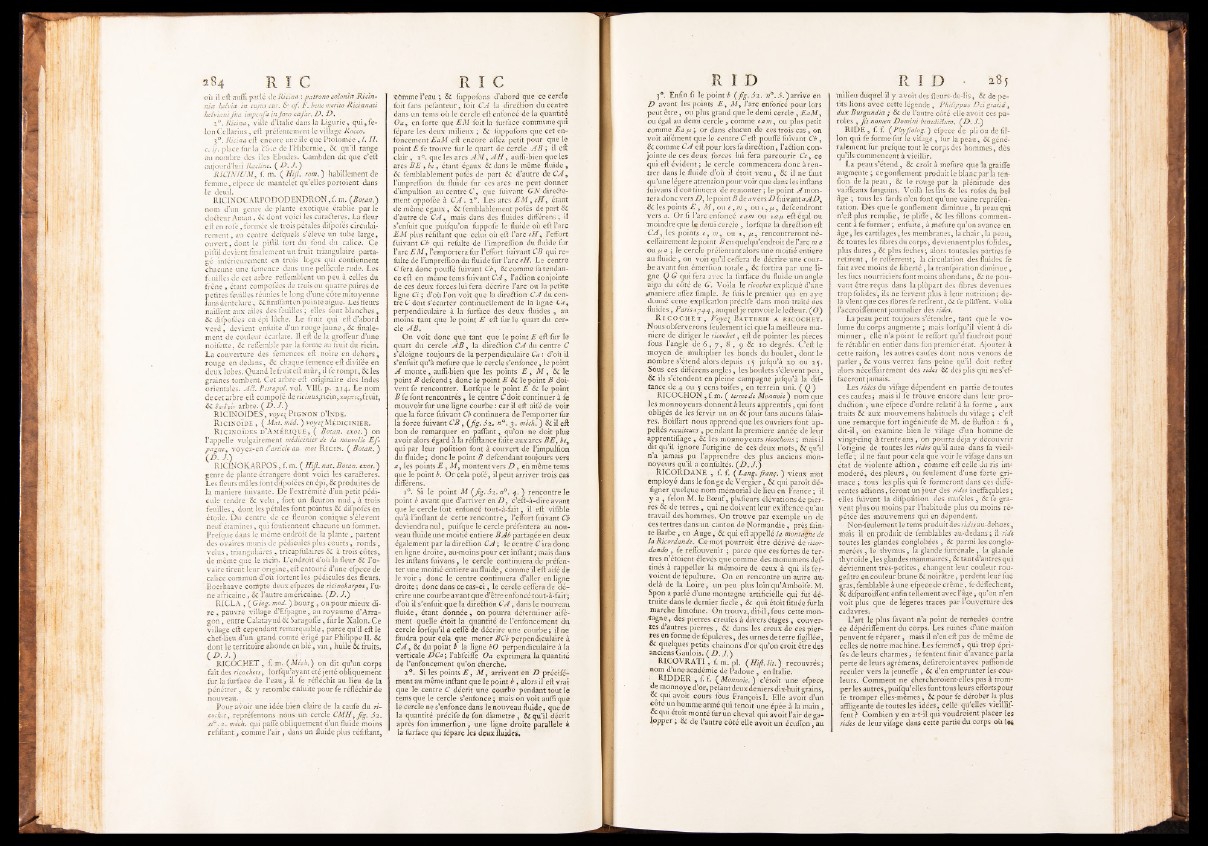
« t e s
où il eft auffi parle de Ricina : pattono colonne Ricin-
niæ helvice in cujus cur. & of. F. bene merito Ricinnati
helviani J'ua impenfa in foro ccej'ar. D . D .
i° . Ricina, ville d’ Italie dans la Ligurie, qui, félon
Cellarius, eft préfentement le village Rocco.
■ fi. Ricina eft encore une île que Ptolomée , 1. IL
c. ij. place fur la LiKe de l’Hibernie, 8c qu’il range
au nombre des îles Ebudes. Cambden dit que c’eft
aujourd’hui Rac/ine. ( D. J. j
RICINIUM, f. m. ( Hiß. rom. ) habillement de
femme, efpece de mantelet qu’elles portoient dans
le deuil.
RICINOCARPODODENDRON,f.m. (,Botan.)
nom d’un genre de plante exotique établie par le
doûeur Aman, 8c dont voici les caraûeres. La fleur
eft en rofe, formée de trois pétales difpofés circulai-
rement, au centre defquels s’élève un tube large,
ouvert, dont le piftil fort du fond du calice. Ce
piftil devient finalement un fruit triangulaire partagé
intérieurement en trois loges qui contiennent
chacune une lemence daus une pellicule rude. Les
Ruilles de cet arbre reffemblent un peu à celles du
frêne , étant compofées de trois ou quatre paires de
petites feuilles réunies le long d’une côte mitoyenne
fans dentelure, 8c Unifiant en pointe aiguë. Les fleurs
naiffent aux aîles des feuilles ; elles font blanches ,
8c difpolées en épi lâche. Le fruit qui eft d’abord
verd devient enfuite d’un rouge jaune, 8c finalement
de couleur écarlate. Il eft de la groffeur d’une
noifette, 8c refîemble par la forme au fruit du ricin.
La couverture des femences eft noire en dehors,
rouge en dedans, 8c chaque femence eft divifée en
deux lobes. Quand le fruit eft mûr, il fe rompt, 8c les
graines tombent. Cet arbre eft originaire des Indes
orientales. Acl. Petropol. vol. VIII. p. 214. Le nom
de cet arbre eft compofé de ricinus,ricin, Kapnoc,fruit,
8c S'tvS'fiv arbre. ( D . J. )
RICINOiîDES, voye{ Pign on d’Inde.
R ïCINOÏDE , ( Mat. méd. j voy^MÉDICINIER.
R icinoïdes d’Am ér iqu e , ( Botan. exot.j on
l’appelle vulgairement mcdicinier de la nouvelle Ef-
pagne, voyez-en L’article au mot Ric in . ( Botan. j
(-£>• A )
RICINOKARPOS , f. m. ( Hiß. nat. Botan. txot. )
genre de plante étrangère dont voici les carafteres.
Les fleurs mâles font difpofées en épi, 8c produites de
la maniéré fuivante. De l’extrémité d’un petit pédicule
tendre 8c v e lu , fort un fleuron nud, à trois
feuilles, dont les pétales font pointus & difpofés en
étoile. Du centre de ce fleuron conique s’élèvent
neuf étamines, qui foutiennent chacune un fommet.
Prefque dans le même endroit de la plante, partent
des ovaires munis de pédicules plus courts, ronds,
velus, triangulaires , tricapfulaires 8c à trois côtes,
de même que le ricin. L’endroit d’où la fleur 8c l’ovaire
tirent leur origine, eft entouré d’une efpece de
calice commun d’où fortent les pédicules des fleurs.
Boerhaave compte deux efpeces de ricinokarpos, l’une
africaine, 8c l’autre américaine. (Z>. J.j
RICLA , ( Géog. mod. j bourg , ou pour mieux dire
, pauvre village d’Efpagne, au royaume d’Arra-
gon, entre Calatayud8c Saragoffe, furie Xalon. Ce
village eft cependant remarquable, parce qu’il eft le
chef-lieu d’un grandcomté érigé par Philippe II. &
dont le territoire abonde en blé, v in , huile 8c fruits.
( D . J . )
RICOCHET, f. m. {Mich.j on dit qu’un corps
fait des ricochets, lorfqu’ayant été jetté obliquement
fur la furface de l’eau , il fe réfléchit au lieu de la
pénétrer, 8c y retombe enfuite pour fe réfléchir de
nouveau.
Pour avoir une idée bien claire de la caufe du ricocha
, repréfentons nous un cercle CMH,fig. Sx.
n°. 2. mich, qui paffe obliquement d’un fluide moins
réfiftant., comme l’a ir , dans un fluide plus réfiftant,
•comme l’eau ; 8c fuppofons d’abord que ce cercle
foit fans pefanteur, foit CA la direûion du centre
dans un tems où le cercle eft enfoncé de la quantité
Ou, en forte que EM foit la furface commune qui
fépare les deux milieux ; 8c fuppofons que cet enfoncement
ÈaM eft encore affez petit pour que le
point £ fe trouve fur le quart de cercle A B ; il eft
clair, 1 °, que les arcs AM , A H , aufîi-bien que les
arcs B E , be , étant égaux 8c dans le même fluide ,
8c femblablement pofés de part 8c d’autre de C A ,
l’impreffion du fluide fur ces arcs ne peut donner
d’impulfion au centre C , que fuivant G N dire élément
oppofée à C A . z°. Les arcs E M , eH, étant
de même égaux, 8c femblablement pofés de part 8c
d’autre de C A , mais dans des fluides différens ; il
s’enfuit que puifqu’on fuppofe le fluide où eft l’arc
EM plus réfiftant que celui où eft l’arc cH, l’effort
fuivant Cb qui refulte de l’impreflion du fluide fur
l’arc E M , l’emportera fur l’effort fuivant CB qui re-
fiilte de l’impreflion du fluide fur l’arc eH. Le centre
C fera donc pouffé fuivant Cb, 8c comme fa tendance
eft en meme tems fuivant C A , l’aélion conjointe
de ces deux forces lui fera décrire l’arc ou la petite
ligne Ci ; d’où l’on voit que la direélion CA du centre
C doit s’écarter continuellement de la ligne Ca,
perpendiculaire à la furface des deux fluides , au
moins tant que le point E eft fur le quart du cercle
A B . m Ê Ê m
On voit donc que tant que le point E eft fur le
quart du cercle A B , la direction CA du centre C
s’éloigne toujours de la perpendiculaire Ca : d’où il
s’enfuit qu’à mefure que le cercle s’enfonce, le point
A monte, aufli-bien que les points E , M , & le
point B defeend ; donc le point E 8c le point B doivent
fe rencontrer. Lorfque le point E 8c le point
B fe font rencontrés , lé centre C doit continuer à fe
mouvoir fur une ligne courbe : car il eft aifé de voir
que la force fuivant Cb continuera de l’emporter fur
la force fuivant C B , (fig. Sx. »°, j . méch. ) & il eft
bon de remarquer en paffant, qtt’on ne doit plus
avoir alors égard à la réfiftance faite aux arcs B E , be,
qui par leur pofition font à couvert de l’impulfion
du fluide ; donc le point B defeendant toujours vers
a, les points E , M, montent vers D , eh même tems
que le point b. Or cela pofé, il peut arriver trois cas
différens.
i°. Si le point M ( fig.Sx.n°. 4. ) rencontre le
point b avant que d’arriver en D , c’eft-à-dire avant
que le cercle foit enfoncé tout-à-fait, il eft vifiblë
qu’à l’inftant de cette rencontre, l’effort fuivant Cb
deviendra nul, puifque le cercle préfentera au nouveau
fluide une moitié entière B Ab partagée en deux
également par la direction CA ; le centre C ira donc
en ligne droite, au-moins pour cet inftant; mais dans
les inftans fuivans, le cercle continuera de préfen-
ter une moitié entière au fluide, comme il eft aifé de
le voir ; donc le centre continuera d’aller en ligne
droite ; donc dans ce cas-ci, le cercle ceffera de décrire
une courbe avant que d’être enfoncé tout-à-fait ;
d’où il s’enfuit que la direélion C A , dans le nouveau
fluide, étant donnée, on pourra déterminer aifé-
ment quelle étoit la quantité de l’enfoncement du
cercle forfqu’il a ceffé de décrire une courbe ; il ne
faudra pour cela que mener BCb perpendiculaire à
C A , 8c du point b la ligne bO perpendiculaire à la
verticale DCa\ l’abfcifle O a exprimera la quantité
de l’enfoncement qu’on cherche.
i ° . Si les points E , M , arrivent en D précifé-
ment au même inftant que le point b , alors il eft vrai
que le centre C décrit une courbe pendant tout le
tems que le cercle s’enfonce ; mais on voit auffi que
le cercle ne s’enfonce dans le nouyeau fluide, que de
la quantité précife de fon diamètre , 8c qu’il décrit
après fon immerfion, une ligne droite parallèle à
la furface qui fépare les deux fluides.
3®. Enfin fi le point b (fig. Sx. >2®. À )a r r iv e en
D avant les points E , M , l’arc enfonce pour lors
peut être, ou plus gtand que le demi cercle , EaM,
ou égal au demi cercle -, comme eam, ou plus petit
comme Ea p. ; or dans chacun de ces trois cas, on
voit aifément que le centre C eft pouffé fuivant Cb ,
8c comme CA eft pour lors fa direction, l’a&ion conjointe
de ces deux forces lui fera parcourir Ce, ce
qui eft évident ; le cercle commencera donc à rentrer
dans le fluide d’où il étoit venu , 8c il ne faut
qu’une légère attention pour voir que dans les inftans
fuivans il continuera de remonter ; le point A montera
donc vers D , le point B de avers D fuivant a A D ,
8c les points E , M , ou e , m , ou e -, p , defeendront
versa. Or fi l ’arc enfoncé eam ou t-ap eft égal ou
moindre que lç demi cercle, lorfque là difeftion eft
C A , les points e , m, ou 1, p , rencontreront né-
ceffairement le point B en quelqu’endroit de l’arc m a
ou p a ; le cercle préfentant alors une moitié entière
au fluide , on voit qu’il cefièra de décrire une courbe
avant fon émerfion totale, 8c fortira par une ligne
Q G qui fera avec la furface du fluide un angle
aigu du côté de G. Voila le ricochet expliqué d’une
»maniéré affez fimple. Je fuis le premier qui en aye
donné cette explication précife dans mon traité des
fluides, Paris-dj^q., auquel je renvoie le lefteur. (O)
R i c o c h e t , Voye1 Ba t t erie a r ico ch e t .
Nous obferverons feulement ici que la meilleure maniéré
de diriger le ricochet, eft de pointer les pièces
fous l’angle de 6 , y , 8 , 9 8c 10 degrés. C’eft le
moyen de multiplier les bonds du boulet, dont le
nombre s’étend alors depuis 15 jufqu’à 20 ou 25.
Sous ces différens angles, les boulets s’élèvent p eu,
& ils s’étendent en pleine campagne jufqu’à la distance
de 4 ou 5 cens toifes, en terrein uni. ( Q )
RICOCHON ,f.m . ( terme de Monnoie ) nom que
les monnoyeurs donnent à leurs apprentifs, qui font
obligés de les fervir un an 8c jour fans aucuns falai-
res. Boiffart nous apprend que les ouvriers font ap-
pellés recuiteurs , pendant la première année de leur
apprentiflage -, 8c les monnoyeurs ricochons ; mais il
dit qu’il ignore l’origine de cel deux mots, 8c qu’il
n’a jamais pu l’apprendre des plus anciens monnoyeurs
qu’il a confultés. (Z>. J .j
RICORDANE , f. f. ( Lang, franç. ) vieux mot
employé dans le fonge de Vergier, 8c qui paroît dé-
figner quelque nom mémorial de lieu en France ; il
y a , félon M. le Boeuf, plufieurs élévations de pierres
8c de terres , qui ne doivent leur exiftence qu’au
travail des hommes. On trouve pair exemple un de
ces tertres dans un canton de Normandie, près fain-
te Barbe, en Auge, 8c qui eft appelle la montagne de
la Ricordande. Ce mot pourroit être dérivé de ricor-
dando , fe reffouvenir ; parce qlie ces fortes de tertres
n’ étoient élevés que comme des monumens def-
tinés à rappeller la mémoire de ceux à qui ils fer-
voient de lépulture. On en rencontre un autre au-
delà de la Loire, un peu plus loin qu’Amboife. M.
Spon a parlé d’une montagne artificielle qui fut détruite
dans le dernier fiecle , 8c qui étoit fituée fur la
marche limofine. On trouva,dit-il,fous cette mon-
tagne, des pierres creufes à divers étages , couvertes
d’autres pierres , 8c dans les creux de ceis pierres
en forme de fépulcres,. des urnes de terre figillée,
8c quelques petits chaînons d’or qu’on croit être des
anciens Gaulois. ( D. J )
R ICO VR A T I, f. m. pi. ( Hifi. lit. ) recouvrés ;
nom d’une académie de Padoue , en Italie.
• RIDDER , f. f. ( Monnoie. ) c’étoit une efpece
de monnoye d’or, pefant deux deniers dix-huit grains,
& cjui avoir cours fous François I. Elle avoir d’un
cote un homme armé qui tenoit une épée à la m ain,
& qui étoit monté fur un cheval qui avoit l’air de ga-
Jopper j 8c de l’autre côté elle avoir un écuffon, au
milieu duquel il y avoit des fleurs-de-lis, 8c de petits
lions avec cette légende , Philippus Dci gratiâ,
dux Burgundioe ; 8c de l’autre côté elle avoit ces paroles
, f il nomen Domini benediclum. (D. J.j
R ID E , f. f. ( Phyfiolog..) efpece de pli ou de fil-
ion qui fe fçrme fur le vilage , fur la peau, 8c généralement
für prefque tout le corps des hommes, dès
qu’ils commencent à vieillir.
La peau s’étend, 8c croît à mefure que la gràiffè
augmente ; ce gonflement produit le blanc par la ten-
fion de la peau, 8c le rouge par la plénitude des
vaifîeaux fànguins. Voilà les lits 8c les rofes du bel
âge ; tous les fards n’en font qu’une vaine repréfen-
tation. Dès que le gonflement diminue, la peau qui
n’eft plus remplie, fe pliffe, 8c les filions commencent
à fe former ; enfuite, à mefure qü’on avance en
âge, les cartilages, les membranes, la chair ,1a péau,
8c toutes les fibres du corps-, deviennent plus folides>
plus dures, 8c plus feches ; alors toutes les parties fe
retirent, fe refferrent ; la circulation des fluides fé
fait avec moins de liberté, la tranfpiration diminue ,
les fucs nourriciers font moins abondans, 8c ne pouvant
être reçus dans la plupart des fibres devenues
trop folides, ils ne fervent plus à leur nutrition; delà
vient que ces fibres fe retirent, 8c fe pliflént. Voilà
l’accroiflement journalier des rides.
La peau peut toujours s’étendre, tant que le volume
du corps augmente ; mais lorfqu’il vient à diminuer
, elle n’a point le reffort qu’il faudroit pouf
fe rétablir en entier dans fon premier état. Ajoutez à
cette ràifon, les autres caufes dont nous venons de
parler, 8c vous verrez fans peine qu’il doit refter
alors néceffairement des rides 8c des plis qui ne s’e f faceront
jamais.
Les rides du vifage dépendent eh partie de toutes
ces caufes; mais il fe trouve encore dans leur production
, une efpece d’ordre relatif à la forme , aux
traits 8c aux mouvemens habituels du vifage ; c’eft
une remarque fort ingenieufe de M. de Buffon : fi ,
dit-il, on examine bien le vifage d’un homme de
vingt-cinq à trente ans, on pourra déjà y découvrir
l’origine de toutès les rides qu’il aura dans fa vieil-
leffe ; il xiè faut pour cela que voir le vifage dans un
état de violente aétion, comme eft celle du ris immodéré
, des pleurs, ou feulement d’une forte grimace
; tous les plis qui fe formeront dans ces différentes
aftions,fieront un jour des rides ineffaçables ;
elles fuivent la difpofition des mufeles , 8c fe gravent
plus ou moins par l’habitude plus ou moins répétée
des mouvemens qui en dépendent.
Non-feulement le tems produit des rides au-dehors,
mais il en produit de femblables au-dedans ; il ride
toutes les glandes eonglobées , 8c parmi les conglomérées
, le thymus, la glande furrénale , la glandé
thyroïde, les glandes mammaires, 8c tant d’autres qui
deviennent très-petites, changent leur couleur rougeâtre
en couleur brune 8c noirâtre, perdent leur fuc
gras, femblable à une efpece de crème, fe déffechent,
8c difparoiffent enfin tellement avec l’âge -, qu’on n’en
voit plus que de légères traces par l’ouyerture des
cadavres i
L’art le plus favant ri’a point de renledes contre
ce dépériffement du corps. Les ruines d’une maifoii
peuvent fe réparer, mais il n’en eft pas de même de
celles de notre machine. Les femmes, qui trop épri-
fes de leurs charmes, fe fentent finir d’avance parla
perte de leurs agrémens, defireroientavec paffionde
reculer vers la jeuneffe , 8c d’en emprunter les couleurs.
Comment n e chercheroient-elles pas à tromper
les autres, puifqu’elles font tous leurs effortspoùr
fe tromper elles-memes ; 8c pour fe dérober la plus
affligeante de toutes les idées, celle qu’elles vieillif-
fent ? Combien y en a-t-il qui voüdroient placer les
rides de leur vifage dans cette partie du corps où les