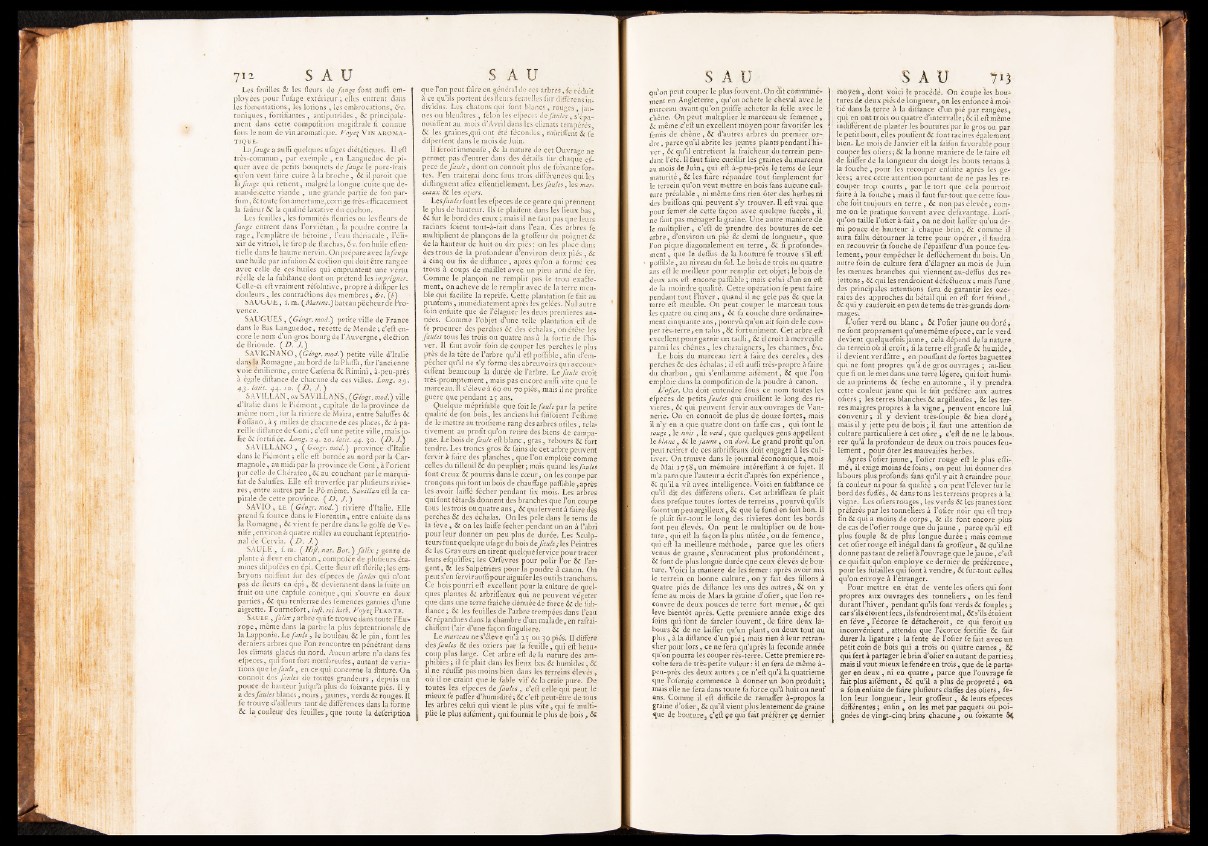
Les feuilles & les fleurs de Jauge font auffi employées
pour l’ufage extérieur ; elles entrent dans
les fomentations, les lotions , les embrocations, &c.
toniques, fortifiantes , antiputrides, & principalement
dans cette compolition magiftrale fi connue
fous le nom de vin aromatique. Voye^ Vin aromatique.
La fauge a aufli quelques ufages diététiques. II eft
très-commun, par exemple , en Languedoc de piquer
avec de petits bouquets de Jauge le porc-frais
qu’on veut faire cuire à la broche, Sc il paroît que
la fauge qui retient, malgré la longue -cuite que de-
mandeàcette viande , une grande partie de fon parfum
, & toute fon amertume,corrige très-efficacement
la fadeur & la qualité laxative du cochon.
Les feuilles, les fommités fleuries ou les fleurs de
fauge entrent dans l’orviétan , la poudre contre la
rage, l’emplâtre de bétoine , l’eau thériacale , l’élixir
de vitriol, le lirop de ftæchas, &c. fon huile effen-
tielle dans le baume nervin. On prépare avec lafauge
une huile par infufion & coétion qui doit être rangée
avec celle de ces huiles qui empruntent une vertu
réelle de la fubfiance dont on prétend les imprégner.
Celle-ci eft vraiment réfolutive, propre à diffiper les
douleurs, les contractions des membres, &c. (b)
. SAUGUE, f. m. (Marine.') bateau pêcheur de Provence.
SAUGUES , ( Géogr. rnod.') petite ville de France
dans le Bas Languedoc, recette de Mende ; c’eft encore
le nom d’un gros bourg de l’Auvergne, élection
de Brioude. ( D . J. )
SAVIGNANO, (Géogr. mod.) petite ville d’Italie
dan§,|a Romagne, au bord de la Pluffa, fur l’ancienne
voie émilienne, entre Cæfena & Rimini, à-peu-près
à égale diftance de chacune de ces villes. :Long. zc).
4 g . lata. 44. 10. ( D . J . )
SAVILLAN, ou SAVILLANS, (Géogr. mod.') ville
d’Italie dans le Piémont, capitale de la province de
même nom, fur la riviere de Maira, entre Saluffes &
Foffano, à 5 milles de chacune de ces places, & à pareille
diftance de Coni ; c’eft une petite ville, mais jolie
& fortifiée. Long. 24. 10. latit. 44. 30. (D . J .)
SAVILLANO , ( Géogr. mod.) province d’Italie
dans le Piémont ; elle eft bornée au nord par la Carmagnole
, au midi par la province de Coni, à l’orient
par celle de Chérafco, & au couchant par le marqui-
fat de Saluffes. Elle eft traverfée par plufieurs rivières
, entre autres par le Pô même. Saviltan eft la capitale
de cette province. ( D . J . )
SAVIO, le ( Géogr. mod. ) riviere d’Italie. Elle
prend fa fource dans le Florentin, entre enfuite dans
la Romagne, & vient fe perdre dans le golfe de Ve-
nife, environ,à quatre milles au couchant feptentrio-
nal de Cervia. ( D . /.-)
SAULE , f. m. ( H iß. nat. Bot. ) fa lix ; genre de
plante à fleur en chaton , compofée de plufieurs étamines
difpofées en épi. Cette fleur eft ftérile ; les embryons
naiffent fur des efpeces de fautes qui n’ont
pas de fleurs en épi, & deviennent dans la fuite un
fruit ou une capfule conique, qui s’ouvre en deux
parties, & qui renferme des femences garnies d’une
aigrette. Tournefort, infi. rei herb. Voyeç Plante.
Saule , f d i x ; arbre qui fe trouve dans toute l’Europe,
même dans la partie la plus feptentrionale de
la Lapponie. Le fa u te , le bouleau & le pin, font les
derniers arbres que l’on rencontre en pénétrant dans
les climats glaces du nord. Aucun arbre n’a dans fes
efpeces, qui font fort nombreufes, autant de variations
que le fa u te , en ce qui. concerne la ftature. On
connoit des fautes de toutes grandeurs , depuis un
pouce de nautéur jufqu’à plus-de foixante piés. Il y
a des fautes blancs, noirs, jaunes, verds & routes. Il
fe trouve d’ailleurs tant de différences dans la forme
& la couleur des feuilles, que toute la description
que l’on peut faire en général de ces arbres, fe réduit
à ce qu’ils portent des fleurs femelles fur différens individus.
Les chatons qui font blancs, roviges, jaunes
ou bleuâtres , félon les efpeces de fautes , s’epa-
no'uiffent au mois d’Avril dans les climats tempérés
& les graines.qui ont été fécondes, mûriflent & fe
difperfent dans le mois de Juin.
Il feroit immenfe , Sc la nature de cet Ouvrage ne
permet pas d’entrer dans des détails fur chaque ef-
pece de fa u te , dont on connoît plus de foixante fortes.
J’en traiterai donc fous trois différences qui les
diftinguent allez effentiellement. Les fautes, les marteaux
Sc les ofiers.
Lesjautes font les efpeces de ce genre qui prennent
le plus de hauteur. Ils fe plaifent dans les lieux bas
& fur le bord des eaux ; mais il ne faut pas que leurs
racines foient tout-à-fait dans l’eau. Ces arbres fe
multiplient de plançons de la groflèur du poignet Sc
de la hauteur de huit ou dix piés : on les place dans
des trous de la profondeur d’environ deux piés , Sc
à cinq ou fix de diftance , après qu’on a formé ces
trous à coups de maillet avec un pieu armé de fer.
Comme le plançon ne remplit pas le trou exafte-
ment, on achevé de le .remplir avec de la terre meuble
qui facilite la reprife. Cette plantation fe fait au
printems, immédiatement après les gelées. Nul autre
foin enluite que de l’élaguer les deux premières années.
Comme l’objet d’une telle plantation eft de
fe procurer des perches Sc des échalas, on étête les
fautes tous les trois ou quatre ans à la fortie de l’hiver.
Il faut avoir foin de couper les perches le plus
près de la tête de l’arbre qu’il eft poflîble, afin d’empêcher
qu’il ne s’y forme des abreuvoirs qui accour-
ciffent beaucoup la durée de l’arbre. Le faute croît
très-promptement, mais pas encore auffi vîte que le
mareeau. Il s’élève à 60 ou 70 piés, mais il ne profite
guere que pendant 2 5 ans.
Quelque méprifable que foit le faute par la petite
qualité de fon bois, les anciens lui faifoient l’eftime
de le mettre au troifieme rang des arbres utiles, relativement
au profit qu’on retire des biens de campagne.
Le bois de faute eft blanc, gras, rebours Sc fort
tendre. Les troncs gros Sc fains de cet arbre peuvent
fervir à faire des planches, que l’on emploie comme
celles du tilleuil & du peuplier; mais quand 1 es fautes
font creux Sc pourris dans le coeur, on les coupe par
tronçons qui font un bois de chauffage paffable,-après
les avoir laiffé féefier pendant fix mois. Les arbres
qui font têtards donnent des branches que l’on coupe
tous les trois ou quatre ans, Sc qui fervent à faire des
perches Sc des échalas. On les pele dans le tems de
la feve, & on les laiflé fecher pendant un an à l’abri
pour leur donner un peu plus de durée. Les Sculpteurs
font quelque ufage du bois de faute; les Peintres
& les Graveurs en tirent quelque fervice pour tracer
leurs efquiffes ; les Orfèvres pour polir For Sc l’argent
, & les Salpétriers pour la poudre à canon. On
peut s’en fervirauffipour aiguifer les outils tranchans.
Ce bois pourri eft excellent pour la culture de quelques
plantes & arbriffeaiix qui ne peuvent végéter
que dans une terre fraiche dénuée de force Sc de fub-
ftance ; Sc les feuilles de l’arbre trempées dans l’eau
& répandues dans la chambre d’un malade, en rafrai-
chiffent l’air d’une façon finguliere.
Le mareeau ne s’élevé qu’à 2 5 ou 30 piés. Il différé
d es fautes Sc des ozi ers par fa feuille, qui eft beaucoup
plus large. Cet arbre eft de la nature des amphibies
; il fe plait dans les lieux bas Sc humides , Sc
il ne réuffit pas moins bien dans les terreins élevés,
oîi il ne craint que le fable vif Sc la craie pure. De
toutes les efpeces de fautes , c’eft celle qui peut le
mieux fe paffer d’humidité ; Sc c’eft peut-être de tous
les arbres celui qui vient le plus vîte, qui fe multiplie
le plus aifément, qui fournit le plus de bois, Sc
S A U
ôu*on petit couper le plus fouvent. On dit communément
en Angleterre , qu’on acheté le cheval avec le
mareeau avant qu’on pùiffe acheter la feile avec le
chêne. On peut multiplier le mareeau de femence ,
Sc même c’eft un excellent moyen pour favorifer les
femis dé chêne , Sc d’autres arbres du premieror-
dre, parce qu’il abrite les jeunes, plants pendant l’hiver
, de qu’il entretient là fraîcheur du terrein pendant
l’éte. Il faut faire cueillir lés graines du,mareeau
au mois de Juin, qui eft à-peu-près le tems de leur,
maturité, Sc les faire répandre tout Amplement fur
le terrein qu’on veut mettre en bois fans âucune culture
préalable, ni même dans rien ôter des herbes ni
des buiffons qui peuvent s’y trouver. Il eft vrai;que;
pour ferner de cette façon avec quelque fiiccès , il,
ne faut pas ménager la graine. Une autre maniéré de
le multiplier , c’eft de prendre desboutures de cet
arbre, d’environ un pié Sc demi de longueur , que
l’on pique diagonalement en terre, Sc fi profonde-,
ment, que le deflus de la bouture le trouve s’il eft
poflîble, au niveau du fol. Le bois dé trois p.u quatre
ans eft le meilleur pour remplir cet objet ; le bois de
deux ans eft encore paffable ; mais celui d’un an eft
de la moindre qualité. Cette opération fe peut faire
pendant tout l’hiver , quand il ne gele pas Sc que la
terre eft meuble. On peut couper le mareeau tous
les quatre ou cinq ans, Sc fa couche dure ordinairement
cinquante ans, pourvu qu’on ait foin de le couper
rès-terrê, en talus, Sc fort uniment. Cet arbre eft
excellent pour garnir un tailli, Sc il croît à merveille
parmi les chênes , les çhataigners, les charmes, &c-.
Le bois du mareeau fert à faire des cercles, des
perches Sc des échalas ; il eft auffi très-propre à faire
du charbon , qui s’enflamme aifément, Sc que l’on
emploie dans la compofitio.n de la poudre à canon. ,
Üofier. On doit entendre fous, ce nom toutes les
efpeces de petits fautes qui croiflent le long des rivières
, Sc qui peuvent fervir aux ouvrages de Vannerie.
On en connoît de plus de douze fortes, mais
il n’y en a que quatre dont on faffe cas , qui font le
rouge y le noir , le verd, que quelques gens appellent
le blanc, & le ja u n e , ou doré. Le grand profit qu’pn
peut retirer de ces arbriffeaux doit engager à les cultiver.
On trouve dans le journal économique, mois
de Mai 1758;un mémoire intéreffant à ce fujet. Il
m’a paru que l’auteur a écrit d’après fon expérience ,
Sc qu’il a vu avec intelligence. Voici en fubftance ce
qu’il dit des différens öfters. Cet arbriffeau fe plaît
dans prefque toutes fortes de terreins, pourvu qu’ils
foient un peu argilleux, Sc que le fond en foit bon. Il
fe plaît fur-tout le long des rivières dont les bords
font peu élevés. On peut le multiplier ou de bouture
, qui eft la façon la plus ufitée, ou de femence,
qui eft la meilleure méthode, parce que les ofiers
venus de graine, s’enracinent plus profondément,
& font de plus longue durée que ceux élevés de bouture.
Voici la maniéré de les ferner : après avoir mis
le terrein en bonne culture , on y fait des filions à
quatre piés de diftance les uns des autres, & on ÿ
lerne au mois de Mars la graine d’ofier, que l’on recouvre
de deux pouces de terre fort menue, Sc qui
leve bientôt apres^ Cette première année exige des
foins qui font de farder fouvent, de faire deux labours
Sc de ne laiffer qu’un plant, ou deux tout au
plus , à la diftance d’un pié ; mais rien à leur retrancher
pour lors, ce ne fera qu’après la fécondé année
qu’on pourra les couper rès-terre. Cette première récolté
fera de très-petite valeur : il en fera de même à-
peu-près des deux autres ; ce n’eft qu’à la quatrième
que l’oferaie commence à donner un bon produit ;
mais elle ne fera dans toute fa force qu’à huit ou neuf
ans. Comme il eft difficile de ramaffer à-propos la
graine d’ofier, Sc qu’il vient plus lentement de graine
que de bouture, c’eft çe qui fait préférer çç dernier
S A U
moyen,. dortt voici le procédé. On coupe les boit2-
turcs de deux piés de longueur, on les enfonce à moitié
dans la terre à la diftance d’un pié par rangées,
qui en ont trois ou quatre d’intervalle ; & il eft même
indifférent de planter les boutures par le gros où par
le petit bout , elles pouffent Sc font racines également
bien. Le mois de Janvier eft la faifon favorable pour
couper les ofiers; & la bonne maniéré de le faire eft
de laiffer de la longueur du doigt les bouts tenans à
la fou ehe , pour les recouper enfiute après les gelées;
avec cette attention pourtant de ne pas les recouper
trop courts 9 par le tort que cela pourroit
faire à la fpuçhe ; mais il faut fur-tout que cette fou-
che foit toujours en terre , Sc non pas élevée 9 corn*
me on le pratique fouvent avec defavantage. Lorf- .
qu’on taille l’ofier à-fait, on ne doit laifîèr qu’un demi
pouce de hauteur à chaque brin ; Sc comme il
aura fallu détourner la terre pour opérer, il faudra
en recouvrir fa fouche de I’épaiffeur d’un pouce feulement
, pour empêcher le defféchement du bois. Un
autre foin de culture fera d’élaguer au mois de juin
les menues branches qui viennent au-deffus des re-
jettons, & qui les rendroient défeftueux ; mais l’une ,
des principales attentions fera de garantir les oze-
raies des approches du bétail qui en ëft fort friand,
& qui y.cauferoit en peu de tems de très-grands dom-
magesi '
L’ofier verd ou blanc , & l’ofier jaune ou doré ,
ne font proprement qu’une même efpece, car le verd
devient quelquefois jaune, cela dépend de la nature.
du terrein oîi il croît; fi la terre eft graffe & humide,
il devient verdâtre , en pouffant de fortes baguettes
qui ne font propres qu’à de gros ouvrages ; au-lieu
que fi on le met dans unerterre légère, qui fort humide
au printems & feche en automne., il y prendra
cette couleur jaune qui le fait préférer aux autres
ofiefs ; les terres blanches & argilleufes, & les terres
maigres propres à la vigne, peuvent encore lui
convenir; il y devient tres-fouple & bien doré,
mais il.y jette peu de bois; il faut une attention de
culture particulière à cet ofier., c’eft de ne le labou-..
rer qu’à la profondeur de deux ou trois pouces feulement
, pour ôter les mauvaifes herbes.
Après l’ofier jaune, l’ofier rouge eft le plus efti-
mé, il exige moins de foins, on peut lui donner des
labours plus profonds fans qu’il y ait à craindre pour
fa couleur ni pour fa qualité ; on peut l’élever lur le
bord des foffes, & dans tous les terreins propres à la
vigne. Les ofiers roUges, les verds & les jaunes font
préférés par les tonneliers à l’ofier noir qui eft trop
fin & qui a moins de corps , & ils font encore plus
de cas de l’ofier roitge que du jaune , parce qu’il eft
plus, fouple & de plus longue durée ; mais comme
cet ofier rouge eft inégal dans fa groffeur, & qu’il ne
donne pas tant de reliefàl’ouvrage que le jaune, c’eft
ce qui fait qu’on employé ce dernier de préférence,
pour les futailles qui font à vendre, & fur-tout celles
qu’on envoyé à l’étranger.
Pour me t tre e n é ta t d e v e n te ie s o fie r s q u i fo n t
p ro p r e s a u x o u v r a g e s d e s to n n e lie r s , o n le s fe n d
d u ran t l ’h i v e r , p en d a n t qu ’ ils font v e rd s & fo u p le s ;
c a r s’ ils é to ie n t f e c s , ils fen d ro ien t m a l, & s’ils é ta ie n t
e n f è v e , le C o r c e f e d é ta c h e r o it , c e q u i f e r o it u n
in c o n v é n ie n t , a t ten d u q u e l’ é c o r c e fo r t if ie Sc fa i t
d u r e r la lig a tu r e ; la fe n te d e l’ o f ie r fe fe it a v e c u n
p e t it c o in d e b o is q u i a t ro is o u q u a t re c a rn e s , Sc
q u i f e r t à p a r ta g e r le b r in d ’o fie r en a u tan t d e p a r t i e s ; .
ma is i l v a u t m ie u x le fen d r e e n t r o i s , q u e d e le p artag
e r en d e u x , n i en q u a t r e , p a r c e q u e l ’o u v r a g e fe
fa i t p lu s a i fém e n t , & q u ’ il a p lu s d e p ro p r e té ; ô n
a fo in en fu ite d e fa ir e plu fieu rs c la ffe s d e s o f ie r s , fe * '
Ion le u r lo n g u e u r , le u r g r o ffeu r , Sc leu rs e fp e c e s
d iffé ren te s ; e n fin , o n le s m e t p a r p aq u ets o ù p o ig
n é e s de v in g t - c in q b r in s c h a c u n e , o u fo ix an te