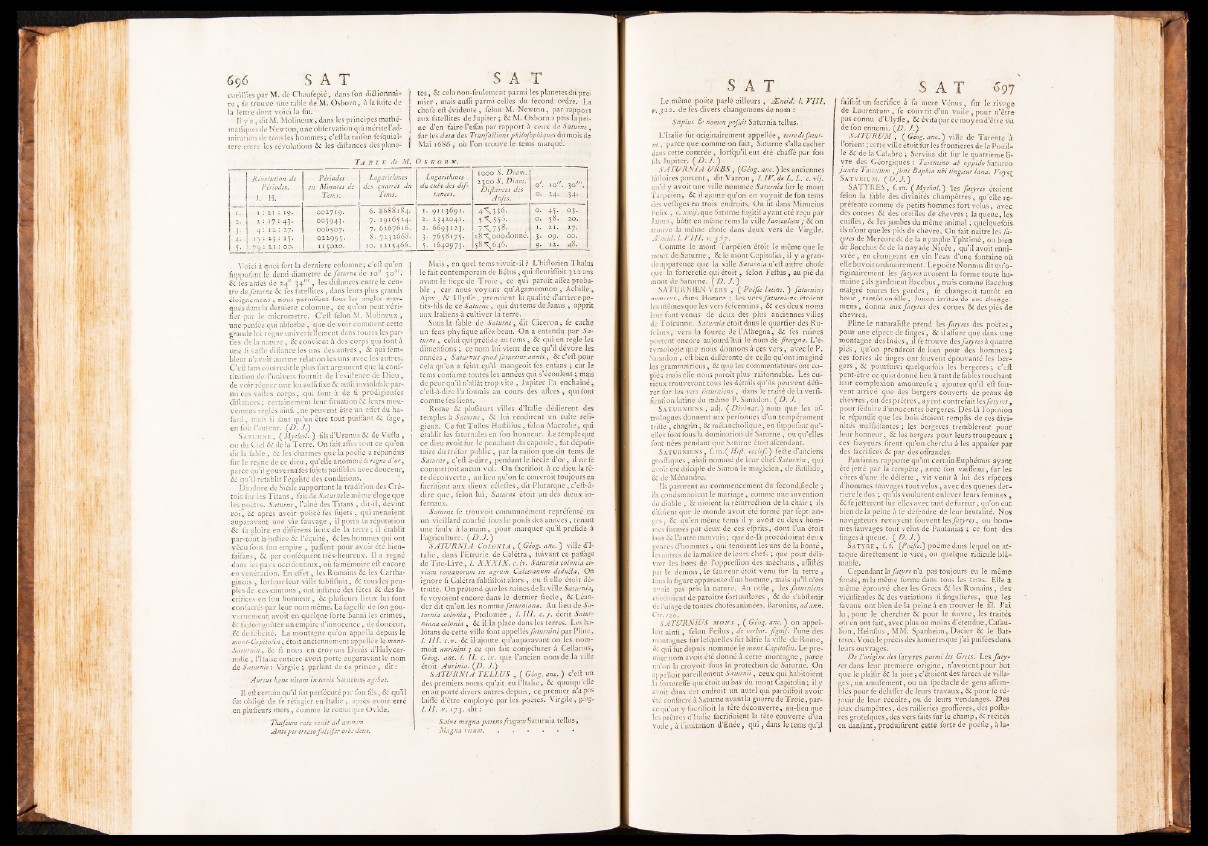
696 S A T
cueillies par M. de Chaufepié, dans fon di&iortnâi-
re , le trouve une table de M. Osborn, à la fuite de
la lettre dont voici la fin.
Il y a, ditM. Molineux, dans les principes mathématiques
de Newton,une obfervation qui mérite l’ad-
miration de tous les hommes;-c’eft la raifon fefquial-
tere entre les révolutions 8c les diftances des plaiie- *&Il
S A T
| tes, 8c cela non-feulement parmi lés planètes dii pre*
I mier , mais auffi parmi celles du fécond ordre. La
[ chofe eft évidente, fçlon M. Newton, par rapport
1 aux fatellites de Jupiter ; 8c M. Osborn a pris.la pei-
] ne d’en faire l’effai par rapport à ceux de Saturne ,
1 fur les data des Transactions philofophiques du mois do
j Mai 1686 , oit l’on trouve le tems marqué.
T a b l e de M. O s b o r n .
Révolution de
Périodes.
J. H.
Périodes
en Minutes de
Tems-. . .
Logarithmes
des quarrés. du
Tems.
Logarithmes .
du cube des dif-
tançes.
IOOO S. Dtam.
2300 S. Diarn.
Dißances des
Anfes. -
o'. 10".
0. 24.
30'".
•34-
1 : 21 : 19. •002719. 6. 8688184. i n — 1 4 '\ 3 3!5- ... P- 45 v 9,3-
,4:, 12 : 27. 006507. 7. 6267616. 2. 6693133. HHH . 1. 21. 27. •
15 : 23 : 15. • 022995, 8. 7232668. 3- 74:1foTVr.- 18 ^000 donne. 3. 09.;. 00.1
2. 2 ; 17 : 43. .003943. 7.191653.4-. 2. 234204,1. 0. 58. 20.
5- .79 .: 2,* :■ 00. xi 5020. 10. 1215466. 5- " " ""■ ™- 58^646. . 9. 12. 48.
j Voici à quoi fert la derniere colomne; c’eft qu’en
fiippofant le demi diamètre de faturne de 10" yo1!'*
8c fes anfes de 24" 34'" , les diftances entre le centre
de faturne 8c fes fatellites , dans leurs plus grands
éloignemens , nous paroiffent fous les angles marqués
dans la derniere colomne, ce qu’on peut vérifier
par le miçrometre. C’eft félon M. Molinevix ,
une penféequi abforbe , que devoir comment cette
grande loi régné universellement dans toutes les parties
de la nature , & convient à des corps qui font à
une fi vafte diftance les uns des autres , & qui fem-
blent n’avoir aucune relation les uns avec les autres.
C’eft fans contredit le plus fort argument que la conf-
titution de l’univers fournit de l’exiftence de Dieu,
de voir régner une loi auffi fixe 8c auffi inviolable parmi
ces, vaftes-corps, qui font à de fi prodigieufes
diftances ; certainement leur fituation 8c leurs mou-
vemens réglés ainfi ,ne peuvent être un effet'du ha-
fard, mais il faut qu’un être tout puiffant 8c fage,
en foit l’auteur. (D . J .)
Saturne , (Mytkol. ) fils d’Uranus 8c de Vefta,
ou du Ciel &delâ Terre. On fait affez tout ce qu’en
dit la fable , 8c lés charmes- que la poéfie a répandus
fur le régné de ce dieu, qu’elle anommé Le régné d'or,
parce qu’il gouvernâmes fujets paifibles avec douceur,
8c qu’il rétablit l’égalité des conditions.
Diodore de Sicile rapportant la tradition des Cré-
tois fur lés Titans, fait de Saturne le même éloge que
les poètes. Saturne, l’ainé des Titans , dit-il, devint
roi, 8c après avoir policé fes fujets , qui menoient
auparavant une vie fauvage , il porta la réputation
& fa gloire en différens lieux de la terre ; il établit
par-tout lajuftice 8c l’équité, &les hommes qui ont
•vécu fous fon empire , paffent pour avoir été bienfaifans,
8c par conféquent très-heureux. Il a régné
dans les pays occidentaux, où fa mémoire eft encore
.en vénération. En effet, les Romains 8c les Carthaginois
, lorfqueleur ville fubfiftoit, 8c tous les peuples
de ces cantons , ont inftitué des fêtes 8c desfa-
çrifices en fon honneur, 8c plufieurs lieux lui font
confacrés par leur nom même. La fageffe de fon gouvernement!
avoit en quelque forte banni les crimes,
8c faifoit goûter un empire d’innocence, de douceur,
.& de félicité. La montagne qu’on appeila depuis le
mont-Capitoün, étoit anciennement appellée le mont-
Saturnin, 8c fi nous en croyons Denis d’Halycar-
.naflê , l’Italie entière avoit porté auparavant le nom
de Saturnie : Virgile ; parlant de ce prince , dit:
Aureus hanc yitam in terris Saturnus agebat.
Il eft certain qu’il fut perfécutépar fon fils, 8c qu’il
fut obligé de fe réfugier en Italie , après avoir erré
.en plufieurs mers, comme le remarque Ovide.
Mais , en quel tems vivoit-il ? L’hiftdrien Thalus
le fait contemporain de Bélus, qui fleuriffoit 322 ans
avant le fiege de Troie , ce qui paroît affez probar
ble , car nous voyons qu’Agamemnon, Achille,
Ajax, 8c Ulyffe , prenoient la qualité d’arriere-pe-
tits-fils de. ce Saturne , qui du tems de Janus , apprit
aux Italiens à cultiver la terre.
Sous la fable de Saturne, dit Cicéron, fe cache
un fens phyfique affez beau. On a entendu par Saturne
, celui qui préfide au tems, 8c qui en réglé les
dimenfions ; ce nom lui vient de ce qu’il-dévore les
années, Saturnus quodfaturetur annis , 8c c’eft pour
cela qu’on a . feint qu’il mangeoit fes enfans ; car le
tems confume toutes les années qui s’écoulent ; mais
de peur qu’il n’allât trop vite , Jupiter l’a enchaîné,
c’eft-à-dire l’a fournis au cours des aftres , qui font
comme fes liens.
Rome 8c plufieurs villes d’Italie dédièrent des
temples à Saturne, 8c lui rendirent un culte relif
gieux. CefutTullus Hoftilius , félon Macrobe, qui
établit les faturnales en fon honneur. Le temple que
ce dieu avoit fur le penchant du capitole, fut dépofi-
taire du tréfor public, par la raifon que du tems de
Saturne t c’eft-à-dire, pendant le fiecle d’or, ilnefe
commettoit aucun vol. On facrifioit à ce dieu la tête
découverte , au lieu qu’on fe couvroit toujours en
facrifiant aux dieux céleftes,dit Plutarque, c’eft-à-
dire que, félon lui, Saturne étoit pn des dieux in-'
fernaux.
Saturne fe trouvoit communément repréfenté en
un vieillard courbé fous le poids des années , tenant
une faulx à la main, pour marquer qu’il préfide à
l’agriculture. ( D . J . )
S A T U R N IA Co l o n ia , ( Géog. anc. ) ville d’Italie,
dans l’Etrurie de Calétraj, fuivant ce. paffage
de Tite-Live , /. X X X I X . c. Iv. Saturnia colonia cij|
vium romanorum in agrum Calctranum deducla. On
ignore fi Calétra fubfiftoit alors^ou fi elle étoit détruite.
On prétend que les ruines de la ville Saturnint
fevoyoient encore dans le dernier fiecle, 8c Léan-
der dit qu’on les nomme faturniana. Au lieu de Saturnia
colonia , Ptolomée , /. I I I . c. j . écrit Satur-
niana colonia , & il la place dans les terres. Les ha-
bitans de cette ville font appellés faturnini par Pline,
l. I I I . c.v. 8c il ajoute qu’auparavant on les nom-
moit aurinini ; ce qui fait conjeûurer à Cellarius,
Géog. ant. l. I I . c .ix , que l’ancien nom de la ville
étoit Aurinia. (D . 7 .)
S A T U R N IA T E L L U S , ( Géog. anc. ) c’eft un
des premiers noms qu’ait eu l’Italie, 8c quoiqu’elle
en ait porté divers autres depuis, ce premier n’a pas
laiffé d’être employé par les poètes. Virgile, géog.
I. I I . y. jy y . dit :
Tkufcum rate venit ad amncm
Ante per errato falcifer orbe deus.
Salve magna parens frugum Saturnia tellus,
Magna virum, » . « • * *
S A T
Le même poète parle ailleurs , Æneid. I. V I I I ,
y, 3 2 2 . de fes divers changemens de nom :
Scepius & rtomen pofu'u Saturnia tellus.
L’Italie fut originairement appellée , terre de fatur-
ne , parce que comme on fait, Saturne s’alla cacher
dans cette contrée , lorfqu’il eut été chaffé par fon
fils Jupiter. ( D . J. )
S A T U R N IA U R S S , (Géog. anc. ) les anciennes
hiftoires portent, dit Varron, l. IV . de L. L. c. vij.
qu’il y avoit une ville nommée Saturnia fur le mont
Tarpéïen, 8c il ajoute qu’on en voyoit de fon tems
des veftiges en trois endroits. On lit dans Minucius
Félix , c. x x i j . que Saturne fugitif ayant été reçu par
Janus , bâtit en même tems la ville Janiculiim ; 8c on
trouve la même chofe dans deux vers de Virgile.
Æneid. I. V I I I . v. $5J .
Comme le mont Tarpéïen étoit le même que le
mont de.Saturne , 8c le mont Capitolin, il y a grande
apparence que la ville Saturnia n’eft autre chofe
que la fortereffe qui étoit , félon Feftus, au pié du
mont de Saturne. ( D .
SATURNIEN V ers , ( Poéfie latine. ) faturnius
numtrus, dans Horace ; les vers fatumien sétoient
les îîiêmes que les vers fefeennins, 8c ces deux noms
leur font venus de deux des plus anciennes villes
de Tofcanne. Saturnia étoit dans le quartier des Ru-
felansy* vers la fource de l’Albegna, 8c fes ruines
portent encore aujourd’hui le nom de fitergna. L’étymologie,
que nous donnons à ces vers, avec le P.
Sanadon , eft bien différente de cejle qu’ont imaginé
les grammairiens, &que les commentateurs ont copié;
mais elle nous paroît plus 'raifonnabl'e. Les curieux
trouveront tous les détails qu’ils peuvent délirer
fur les vers Çatumiens , dans lé traité de la verfi-
fication latine du même P. Sanadon, (D . J .)
Satu rn ien s , adj. (D iv in a t.) nom que les af-
trologues donnent aux perfonnes d’un tempérament
trifte , chagrin, 8c mélancholique, en fuppofant qu’elles
font fous la domination de Saturne, ou qu’elles
font nées pendant que Saturne étoit afeendant.
Saturniens, eccLfi') fefte d’anciens
gnoftiques , ainfi nommé de leur chef Saturnin , qui
avoit étédifciple de Simon le magicien, de Bafilide,
8c de Ménandre.
Ils parurent au commencement du fecondffiecle ;
ils coridamnoient le mariage, comme une invention
du diable , & nioient la réfurre&ion de la chair ; ils.
difoient que le monde avoit été formé par fept anges,
8c qu’en même tems il y avoit eu deux hommes
formés par deux de Ces efprits, dont l’un étoit
bon 8c l’autre mauvais ; que de-là procédoient deux
genres d’hommes , qui tenoient les uns de la bonté,
les autres de la malice de leurs chefs ; que pour délivrer
les bons de l’oppreffion des méchans , affiliés
par le démon , le fauveur étoit venu fur: la terre ,
fous la figure apparente d’un homme, mais qu’il n’en
avoit pas pris la nature. Au refte , les faturniens
affefroient de paraître fortaufter.es , 8c de s’abftenir
de l’ufage de toutes choies animées. Baronius, adann.
Clir.,20.
S A T U R N IU S m o n s , ( Géog. artc. •) on appel-
loit ainfi , félon Feftus , de verbor. fignif. l’une des
montagnes fur lefquelles fut bâtie la ville -de Rome,
8c qui fut depuis nommée le mont Capitolin. Le premier
nom avoit été donné à cette montagne, parce
qu’on la croyoit fous la protedion de Saturne. On
appelloit pareillement Saturnii, ceux qui habitoient
la fortereffe qui étoit au bas du mont Capitolin; il y
avoit dans cet endroit un autel qui paroiffoit avoir
été confacré à Saturne avant la guerre de Troie, parce
qu’on y facrifioit la tête découverte, au-lieu que
les prêtres d’Italie facrifibient la tête couverte, d’un
voile, à l’imitation d’Enée, qui, dans le tems qu’il
S A T »97
1 faifoit un, facrifice à fa mere Vénus, fur le rivage
de Laurentum , fe couvrit d’un voile , pour n’êtfe
pas connu d’Ulyffe , & évita par ce moyen d’être Vil
de fon ennemi. (D . /.)
^ S A T U R U M , ( Géog. anc. ) ville de Tarante à
l’orient ; cette ville étoit fur les frontières de la Pouil-»
le 8c de la Calabre ; Servius dit fqr le quatrième li*
vre des Géorgiques : Tarentino ab oppido Satureo
ju x ta Tarentxmi fj'unt Baphia ubi tinguur lana. Voye£
Sa t y r iu m . ( D . J . )
SATYRES, f. m. (Mythol.) ftes fatyres étoiertt
félon la fable des divinités champêtres , qu’elle repréfente
Comme de petits hommes fort velus, avec
dès cornes 8c des oreilles de chevres ; la queue, les
cuiffes, 8c lés jambes du même animal ; quelquefois
ils ri’ont que les piés de chevre. On fait naître les
tyres de Mercure 8c de la nymphe Yphtimé, ou bien
.de IJacchus 8c de la nayade Nicée, qu’il avoit enni-
vrée, en changeant en vin l’eau d’une fontaine où
elle buvoit ordinairement. Le poète Nonnus dit qu’o-
riginairement les fatyres avoient la forme toute humaine
; ils gardoient Bacchus , mais comme Bacchus
malgré toutes fes gardes, fe changeoit tantôt en
bouc, tantôt en fille, Junon irritée de ces changemens
, donna aux fatyres des cornes 8c des piés de
chevres.
Pline le naturalifte prend les fatyres des poètes-,
pour une efpece de finges , & il affure que dans une
montagne des Indes, il fe trouve des fatyres à quatre
pies, qu’on prendroit de loin pour des hommes ;
ces fortes de finges ont fouvent épouvanté les bergers
, 8c pourfuivi quelquefois les bergeres ; c*eft
peut-être ce quia donné lieu à tant de fables touchant
leur complexion amoureufe ; ajoutez qu’il eft fou-
vent arrivé que- des bergers Couverts de peaux de
chevres, ou des prêtres, ayent contrefait les fatyres ,
pour féduire d’innocentes bergeres. Dès-là l’opinion
fe répandit que les bois étoient remplis de ces divinités
malfaifàntes ; les bergeres tremblèrent pour
leur honneur, 8c les bergers pour leurs troupeaux ;
ces frayeurs firent qu’on chercha à les appaifer par
des facrifices 8c par des offrandes.
Paufanias rapporte qu’un certain Euphémus ayant
étéjetté par la tempête , avec fon vaiffeau, furies
côtes d’une île déferte , vit venir à lui des efpeces
d’hommes fauvages tout velus, avec des queues derrière
le dos ; qu’ils voulurent enlever leurs femmes ,
8c fe jetterent fur elles avec tant de fureur, qu’on eut
bien delà peine à fe défendre de leur brutalité. Nos
navigateurs revoyent fouvent les fatyres, ou hom-
mes lauvages tout velus de Paufanias ; ce font des
finges à queue. (D . J . )
S a t y r e , f. f. (Poéfie.) poème dans lequel on attaque
direftement le vice, ou quelque ridicule blâmable.
Cependant la fatyre n’a pas toujours eu le même
fonds, ni la même forme dans tous les tems. Elle â
même éprouvé chez les Grecs & les Romains, des
viciffitudes 8c des variations fi fingulieres, que les
favans ont bien de la peine à en trouver le fil. J’aî
lu,pour le chercher 8c pour le fuivre, les traités
offien ont fait, avec plus ou moins d’étendue, Cafau-
bon, Heinfius , M M. Spanheim, Dacier 8c le Batteux.
Voici le précis des lumières que j’ai puifées dans
leurs ouvrages.
De l'origine des fatyres parmi les Grecs. Les faty res
dans leur première origine, n’avoient. pour but
que le plaifir 8c la joie ; c’étoient des farces de villages
, un amufement, ou un fpe&acle de gens affem-
blés pour fe délaffer de leurs travaux, 8c pour fe réjouir
de leur récolte, ou de leurs vendanges. Des
jeux champêtres, des railleries groffieres, des poftu*
res grotefques, des vers faits fur le champ, 8c recités
en danfant, produifirent cette forte de poéfie, à la