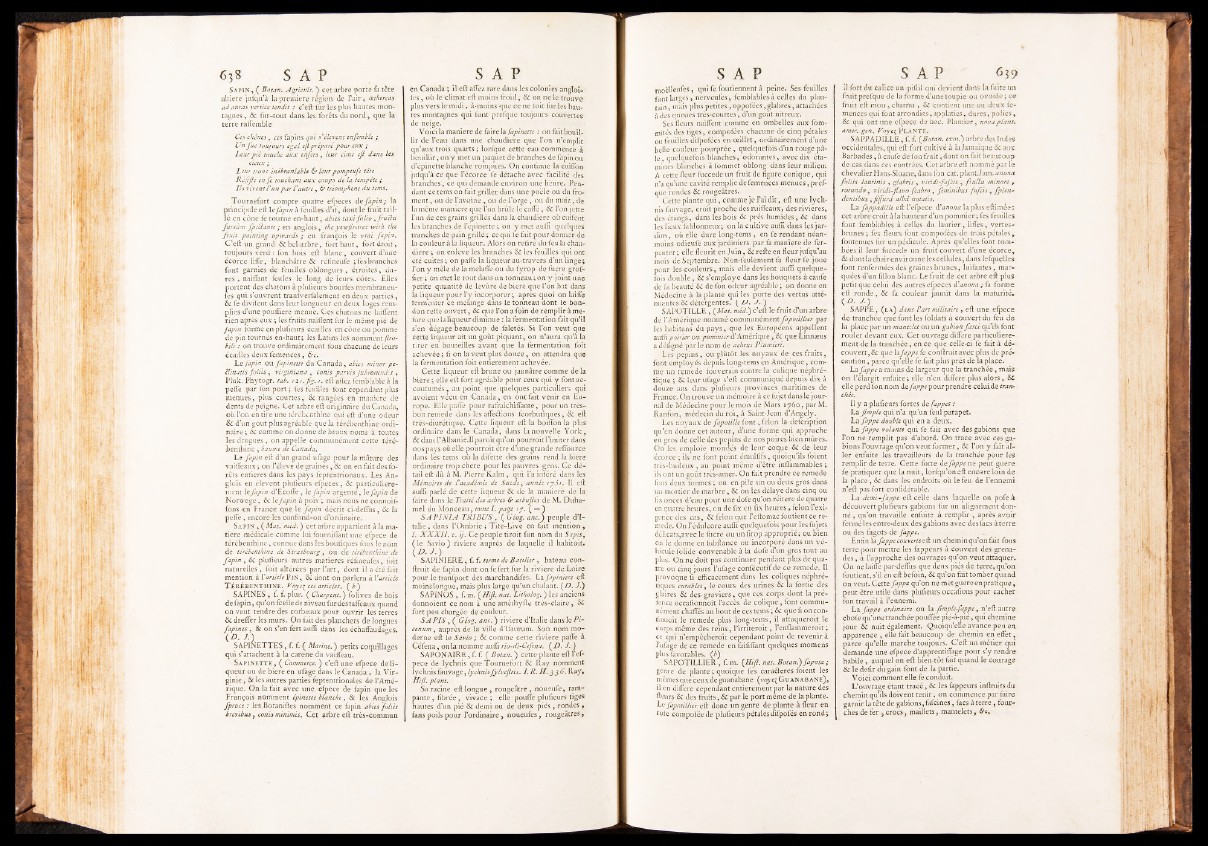
63s SAP
Sapin , ( Boum. Agrictilt. ) cet arbre porte fa tête
altiere jufqu’à la première région de l’a ir , oethereas
ad auras vercice tendit : c’eft fur les plus hautes montagnes
, 8c fur-tout dans les forêts du nord, que la
terre rafl’emble
Ces chênes, ces fapins qui s'élèvent enfemble ;
Un Juc toujours égal ejlpréparé pour eux ;
Leur pié touche aux enfers , leur cime efi dans les
deux ;
Leur tronc inébranlable 6* leur pompeufe tête
Réfifie en fe touchant aux coups de la tempête ;
Ils vivent l'un par l'autre, & triomphent du tems.
Tournefort compte quatre efpeces de fapin; la
principale eft le fapin à feuilles d’if, dont le fruit taillé
en cône fe tourne en-haut, abïes taxi fo lio , fruclu
fursum fpeclante ; en anglois, the yewfr-tree with the
fruit pointing upwards ; en françois le vrai fapin,
C ’eft un grand & bel arbre, fort haut, fort d roit,
toujours verd : fon bois eft blanc, couvert d’une
écorce lifte, blanchâtre 8c réfineufe ;fesbranches
font garnies de feuilles oblongues , étroites, dures
, naiffant feules le long de leurs côtes. Elles
portent des chatons à plufieurs bourfes membraneu-
ies qui s’ouvrent traniverfalement en deux parties,
8c fe divifent dans leur longueur en deux loges remplies
d’une poufliere menue. Ces chatons ne laiffent
rien après eux ; les fruits naiftent fur le même pié de
Japin formé en plufieurs écailles en cône ou pomme
de pin tournés en-haut; les Latins les nomment ftro-
bili : on trouve ordinairement fous chacune de leurs
écailles deux femences, &c.
Le fapin ou J'apinette du Canada, abies minor pe~
clinatis foliis , virginiana , conis parvis Jubrotundis ,
Pluk. Phytogr. tab. 1-.21.fig.-/. eft allez femblable à la
pelle par fon port ; les feuilles font cependant plus
menues, plus courtes, 8c rangées en maniéré de
dents de peigne. Cet arbre eft originaire du Canada,
oh-l’on en tire une térébenthine qui eft d’une odeur
& d’un goût plus agréable que la térébenthine ordinaire
; 8c comme on donne de beaux noms à toutes
les drogues , on appelle communément cette térébenthine
, baume de Canada.
Le fapin eft d'un grand ufage pour la mâture des
vaifleaux ; on l’éleve de graines, & on en fait des fo-‘
rets entières dans les pays feptentrionaux. Les Anglois
en élevent plufieurs efpeces, 8c particulièrement
le Japin d’Ecoffe , le fapin argenté, le fapin de
Norvège, & le Japin à poix ; mais nous ne connoil-
fons en France que le fapin décrit ci-defîiis, & la
peffe, encore les confond-on d’ordinaire.
Sapin , (Mat. mêd\ ) cet arbre appartient à la matière
médicale comme lui fourniflant une efpece de
térébenthine, connue dans les boutiques fous le nom
de térébenthine de Strasbourg, ou de térébenthine de
fapin, 8c plufieurs autres matières réfineufes, foit
naturelles , foit altérées par l’art, dont il a été fait
mention à Y article Pin, 8c dont on parlera à Y article
T érébenthine. Voye-^cesarticles. ( b)
SAPINES , f. f. plur. ( Charpent. ) folives de bois
de fapin, qu’on fcelle de niveau fur des taffeaux quand
on veut tendre des corbeaux pour ouvrir les terres
& drelfer les murs. On fait des planchers de longues
fapines, & on s’en fert aufli dans les échaffaudages.
(O . J .)
SAPINETTES, f. f.-( Marine.') petits coquillages
qui s’attachent à la caréné du vaiffeau.
Sapinette , ( Commerce. ) c’eft une efpece de liqueur
ou de biere en ufage dans le Canada , la Virginie
, & les autres parties feptentrionales de l’Amérique.
On la fait avec une efpece de fapin que les
François nomment êpinette blanche, & les Anglois
fpruct : les Botaniftes nomment ce fapin abus foliis
brevibus, conis minimis. Cet arbre eft très-commun
SAP
en Canada ; il eft affez rare dans les colonies anglox-'
le s , où le climat eft moins froid, 8c on ne le trouve
plus vers le m idi, à-moins que ce ne loit fur les hautes
montagnes qui font prelque toujours couvertes
de neige.
Voici la maniéré de faire la fapinttte : on fait bouillir
de l’eau dans une chaudière que l’on n’emplit
qu’aux trois quarts ; lorfque cette eau commence à
bouillir, on y met un paquet de branches de fapin ou
d’épinette blanche rompues. On continue la cuiflon
jufqu’à ce que l’écorce fe détache avec facilité des
branches, ce qui demande environ une heure. Pendant
ce tems on fait griller, dans une poele ou du froment
, ou de l’avoine , ou de l’orge, ou du maïz, de
la même maniéré que l’on brûle le caffé, 8c l’on jette
l’un de ces grains grillés dans la chaudière où cuifent
les branches de l’épinette ; on y met aufli quelques
tranches de pain grillé ; ce qui le fait pour donner de
la couleur à la liqueur. Alors on retire du feu la chaudière
; on enleve les branches 8c les feuilles qui ont
été cuites ; on pafle la liqueur au-travers d’un linge ;
l’on y mêle de la melaffe ou du fyrop de fucre grof-
fier ; on met le tout dans un tonneau ; on y joint une
petite quantité de levure de biere que l’on bat dans
la liqueur pour l’y incorporer ; après quoi on laifle
fermenter ce mélange dans le tonneau dont le bon-
don relie ouvert, 8c que l’on a foin de remplir à me-
lure que la liqueur diminue : la fermentation fait qu’il
s’en dégage beaucoup de faletés. Si l’on veut que
cette liqueur ait un goût piquant, on n’aura qu’à la
tirer en bouteilles avant que la fermentation foit
achevée ; fi on la veut plus douce, on attendra que
la fermentation foit entièrement achevée.
Cette liqueur eft brune ou jaunâtre comme de la
biere ; elle eft for,t agréable pour ceux qui y font accoutumés
, au point que quelques particuliers qui
avoient vécu en Canada, en ont fait venir en Europe.
Elle pafle pour rafraîchiffante, pour un très-
bon remede dans les affeûions feorbutiques, & eft
très-diurétique. Cette liqueur eft la boiflon la plus
ordinaire dans le Canada, dans la nouvelle Y o rk ,
8c dans 1’Albanie.il paroît qu’on pourroit l’imiter dans
nos pays où elle pourroit être d’une grande reflource
dans les tems où la difette des grains rend la biere
ordinaire trop chere pour les pauvres gens. Ce détail
eft dû à M. Pierre Kalm, qui Fa inféré dans les
Mémoires de Cacadémie de S ut de, année tySt. Il eft
aufli parlé de cette liqueur 8c de la maniéré de la
faire dans le Traité des arbres & arbufies de M. Duhamel
du Monceau, tome I. page iy . ( — )
S A P I N IA TRIBUS r (Géog. anc. ) peuple d’Italie
, dans l’Ombrie ; Tite-Live en fait mention ,
l. X X X I I . c. ij. Ce peuple tiroit fon nom du S apis y
( le Savio ) riviere auprès de laquelle il habitoit.
( . p - J )
SAPINIERE, f. f. terme de Batelier, bateau con-
ftruit de fapin dont on fe fert fur la riviere de Loire
pour le tranfport des marchandifes. La Japiniere eft
moins longue, mais plus large qu’un chalant. (D. /.)
SAPINOS, f. m. (Hiß. nat. Litholog. ) les anciens
donnoient ce nom à une améthyfte très-claire, 8c
fort peu chargée de couleur.
SA P IS , ( Géog. anc. ) riviere d’Italie dans le Pi-
cenum, auprès de la ville d’Ifaurum. Son nom moderne
eft le Savio ; 8c comme cette riviere pafle à
Céfena, onia nomme aufli rio-di-Ceftna. (D . J. )
SAPONAIRE, f. f. ( Botan. ) cette plante eft l’ef-
pece de lychnis que Tournefort 8c Ray nomment
lychnis fauvage, lychnisfylveflris. 1. R. H. G. Ray,
Hiß. plant.
Sa racine eft longue, rougeâtre, noueufe, rampante,
fibrée, vivace ; -elle pouffe plufieurs tiges
hautes d’un pié 8c demi ou de deux piés , rondes,
fans poils pour l’ordinaire, houeufes, rougeâtres ?
SAP
moëileufes, qui fe foutiennent à peine. Ses feuilles
font larges, nerveufes, femblables à celles du plantain,
mais plus petites, oppofées, glabres, attachées
à des queues très-courtes, d’un goût nitreux.
Ses fleurs naiffent comme en ombelles aux fom-
mités des tiges, compofées chacune de cinq pétales
ou feuilles difpofées en oeillet, ordinairement d’une
belle couleur pourprée , quelquefois d’un rouge pâle,
quelquefois blanches, odorantes,.avec dix étamines
blanches à fommet oblong dans leur milieiK
A cette fleur fuccede un fruit de figure conique, qui
n’a qu’une cavité remplie de femences menues ,pref-
que rondes 8c rougeâtres.
Cette plante qui, comme je l’ai dit, eft une lychnis
fauvage, croît proche des ruiffeaux, des rivières,
des étangs, dans les bois 8c prés humides, 8c dans
les lieux fablonneux; on la cultive aufli dans les jardins
, où elle dure long-tems, en fe rendant néanmoins
odieufe aux jardiniers par fa maniéré de fer-
penter ; elle fleurit en Juin, & refte en fleur jufqu’au
mois de Septembre. Non-feulement fa fleur fe joue
pour les couleurs, mais elle devient aufli quelquefois
double , 8c s’employe dans les bouquets à caufe
de fa beauté 8c de fon odeur agréable ; on donne en
Médecine à la plante qui les porte des vertus atténuantes
8c détergentes. ( D . J . )
SAPOTILLE , (Mat. méd.) c’eft le fruit d’un arbre
de l’Amérique nommé communément fapotillier par
les habitans du pays, que les Européens appellent
aufli poirier ou pommier d’Amerique, 8c que Linnæus
a défigné par le nom de achrus Plumieri.
Les pépins., ou plûtôt les noyaux de ces fruits,
font employés depuis long-tems en Amérique, comme
un remede fouverain contre la colique néphrétique
; 8c leur ufage s’eft communiqué depuis dix à
douze ans dans plufieurs provinces maritimes de
France. On trouve un mémoire à ce,fujet dans le journal
de Médecine pour le mois de Mars 1760, parM.
Ranfon, médecin du roi, à Saint-Jean d’Angely.
Les noyaux de fapotille font, félon la defeription
qu’en donne cet auteur , d’une forme qui approche
en gros dé celle des pépins de nos poires bien mûres.
On”les emploie mondés de leur coque 8c de leur
écorce ; ils ne font point émulfifs, quoiqu’ils foient
très-huileux, au point même d’être inflammables ;
ils ont un goût très-amer. On fait prendre ce remede
fous deux formes ; on en pile un ou deux gros dans
un mortier de marbre, & on les délaye dans cinq ou
fix onces d’eau pour une dofe qu’on, réitéré de quatre
en quatre heures, ou de fix en fix heures, félon l’exigence
des cas, 8c félon que l’eftomac foutient ce remede.
On l’édulcore aufli quelquefois pour les fujets
délicats,avec le fucre ouunfirop approprié; ou bien
on le donne en fubfiance ou incorporé dans un véhicule
folide convenable à la dofe d’un gros tout au
plus. On ne doit pas continuer pendant plus de quatre
ou cinq jours l’ufage çonfécutif de ce rémede. Il
provoque fi efficacement dans les coliques néphrétiques
curables, le cours des urines 8c la fortie des
glaires 8c des-graviers, que ces corps dont lapré-
lènce occafionnoit l’accès de colique, font communément
chaffés au bout de ces tems ; 8c que fi on con-
tinuoit le remede plus long-tems, il attaqueroit le
corps même des reins, l’irnteroit, l’enflammeroit ;
ce qui n’empêçheroit cependant point de revenir à
l’ufage de ce remede en failiffant quelques momens
plus favorables, (b)
SAPOTILLIER , f. m. (Hijl. nat^Botan.) fapota;
genre de plante ; quoique fes cara&eres foient les
mêmes que ceux de guanabane (voye^ Guan ab ane),
il en différé cependant entièrement par la nature des
fleurj & des fruits, & par le port même de la plante.
L c fapotillier eft donc un genre de plante à fleur en
rôle compoféede plufieurs pétalesdifpofés en rond;
SAP 639
îl fort du calice un piftil qui devient dans la fuite un
fruit prefque de la forme d’une toupie ou ovoide ; ce
fruit eft mou , charnu , & contient une ou deux femences
qui font arrondies,applaties, dures, polies,
& qui ont une efpece de bec. Plumier, nova plant*
amer. gen. Voyci PLANTE.
SAPPAD1LLE, f. f. (Botan. exot.) arbre des Indes
occidentales, qui eft fort cultivé à la Jamaïque &aux
Barbades, à caufe de fon fruit, dont on fait beaucoup
de cas dans ces contrées. Cet arbre eft nommé par le
chevalier Hans-Sloane, dans fon cat. plant.Jam. anona
foliis laurinis , glabris , viridi-fufeis , fruclu minore ,
rotundo, viridi-fiavo feabro , feminibus fufeis , fplen-
dentibus , fijfurd albâ notât:s.
La fappadille eft l’efpece d’anona la plus eftimée:
cet arbre croît à la hauteur d’un pommier; fes feuilles
font femblables à celles du laurier, liffes, vertes-
brunes ; fes fleurs font compofées de trois pétales,
foutenues fur un pédicule. Après qu’elles font tom-'
bées il leur fuccede un fruit couvert d’une écorce,
& dont la chair environne les cellules, dans lefquelles
font renfermées des graines brunes, luifantes, marquées
d’un fillon blanc. Le fruit de cet arbre eft plus
petit que celui des autres efpeces d'anona ; fa forme
eft ronde, & fa couleur jaunit dans la maturité.
SAPPE, (la) dans üart militaire, eft une efpece
de tranchée que font les foldats à couvert du feu de
la place par un mantelet ou un gabion farci qu’ils font
rouler devant eux. Cet ouvrage différé particulièrement
de la tranchée, en ce que celle-ci fe fait à découvert,
& que laJappe fe conftruit avec plus de précaution
, parce qu’elle fe fait plus près de la place.
La fappe a moins de largeur que la tranchée, mais
on l’élargit enfuite ; elle n’en différé plus alors, 8c
elle perd Ion nom de fappe pour prendre celui de tranchée.
Il y a plufieurs fortes de fappes :
La Jîmple qui n’a qu’un fetil parapet.
La fappe double qui en a deux.
La fappe volante qui fe fait avec des gabions que
l’on ne remplit pas d’abord. On trace avec ces gabions
l’ouvrage qu’on veut former, & l’on y fait aller
enfuite les travailleurs de la tranchée pour les
remplir de terre. Cette forte de fappe ne peut guere
fe pratiquer que la nuit, lorfqu’on eft encore loin de
la place, & dans les endroits où le feu de l’ennemi
n’eft pas fort confidérable.
La demi-fappe eft celle dans laquelle on pofe à
découvert plufieurs gabions fur un alignement donné,
qu’on travaille enfuite à remplir , après avoir
fermé les entre-deux des gabions avec desfacs àterre
ou des fagots de fappe.
Enfin la fappe couverte eft. un chemin qu’on fait fous
terre pour mettre les fappeurs à couvert des grenades
, à l’approche des ouvrages qu’on veut attaquer.
On ne laifle par-deffus que deux piés de terre, qu’on
foutient, s’il en eft befoin, & qu’on fait tomber quand
on veut. Cette fappe qu’on ne met guere en pratique,
peut être utile dans plufieurs occafions pour cacher
fon travail à l’ennemi.
La fappe ordinaire ou la Jimplefappe, n’eft autre
chofe qu’une tranchée pouflee pié-à-pié, qui chemine
jour & nuit également. Quoiqu’elle avance peu en
apparence , elle fait beaucoup de chemin en effet,
parce qu’elle marche toujours. C’eft un métier qui
demande une efpece d’apprentiffage pour s’y rendre
habile , auquel on. eft bien-tôt fait quand le courage
8c le defir du gain font de la partie.
Voici comment elle fe conduit.
L’ouvrage étant tracé, & les fappeurs inftruits du
chemin qu’ils doivent tenir, on commence par faire
garnir la tête de gabions, fafeines, facs à terre , fourches
de fer , crocs, maillets, mantelets, &c.