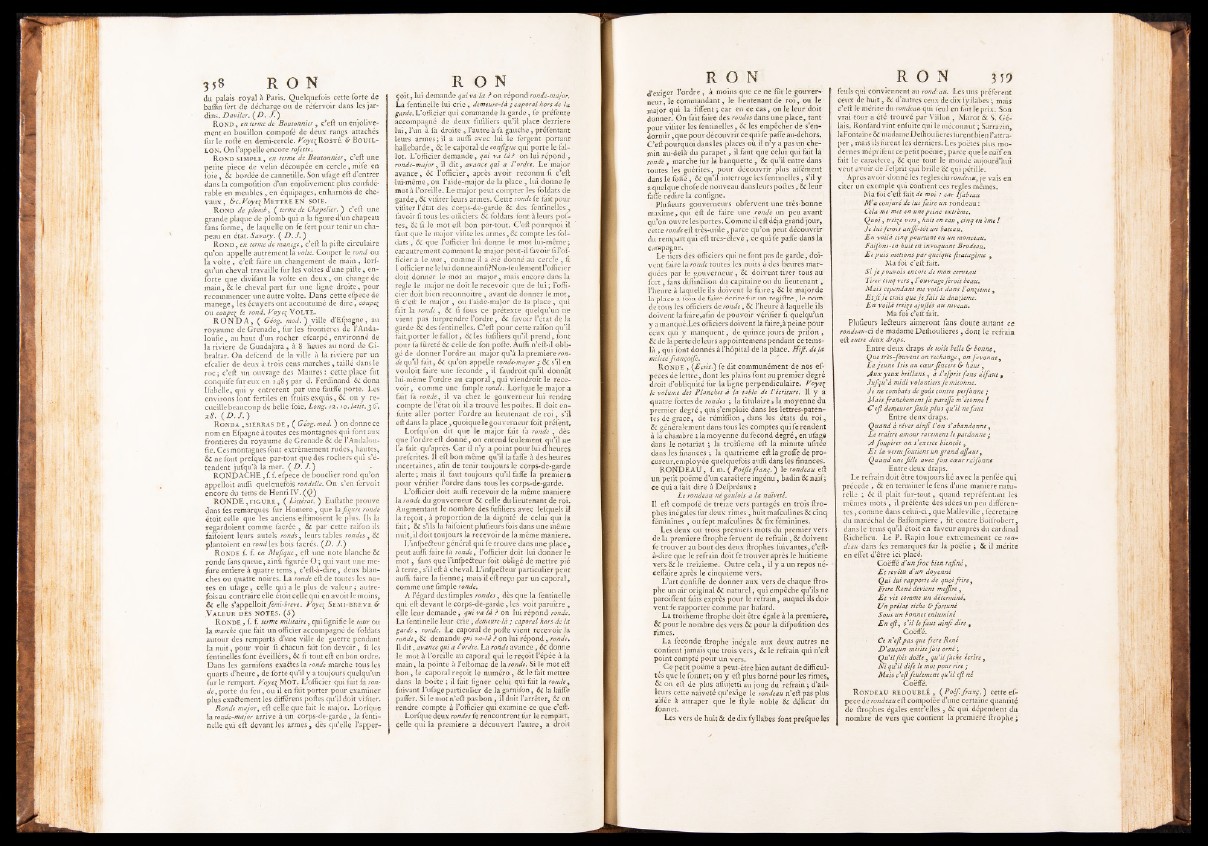
3 58 R ON
du palais royal à Paris. Quelquefois cette forte de
baffin fert de décharge ou de réfervoir dans les jardins.
Davilir. (H . J. )
Ro n d , en terme de Boutonnier, c’eft un enjolivement
en bouillon compofé de deux rangs attachés
furie rofté en demi-cercle. ^ôyeçRosTÉ & Bo uillo
n . On l’appelle encore rofette.
Rond sim p le , en terme de Boutonnier, c’eft une
petite piece de velin découpée en cercle, mife en
foie, 6c bordée de cannetille. Son ufage eft d’entrer
dans la compofition d’un enjolivement plus confidé-
rable en meubles , en équipages, enharnois de chevau
x, &c.Voyt{ Mettre en soie.
Rond de plomb, ( terme de Chapelier. ) c’eft une
grande plaque de plomb qui a la figure d’un chapeau
fans forme, de laquelle on fe fert pour tenir un chapeau
en état. Savary. ( D. J. )
R ond , eh terme de rnanege, c’eft: la pifte circulaire
qu’on appelle autrement la volte. Couper le rond ou
la volte , c’eft faire un changement de main , lorf-
qu’un cheval travaille fur les voltes d’une pifte, en-
forte que divifant la volte en deux, on change de
main, 6c le cheval part fur une ligne droite, pour
recommencer une autre volte. Dans cette efpece de
rnanege, les écuyers ont accoutumé de dire, couper
ou coupe[ le rond. Voye{ VOLTE.
R O N D A , ( Géog. mod.) ville d’Efpagne, au
royaume de Grenade, fur les frontières de l’Anda-
ïoufie, au haut d’un rocher efearpé, environné de
la riviere de Guadajara , à 8 lieues au nord de Gibraltar.
On defeend de la ville à la riviere par un
efcalier de deux à trois cens marches, taillé dans le
roc ; c’eft un ouvrage des Maures : cette place fut
conquife fur eux en 1485 par d. Ferdinand 6c dona
Ifabelle, qui y entrèrent par une fauffe porte. Les
.environs font fertiles en fruits exquis, & on y recueille
beaucoup de belle foie> Long. 12.10. latit. 3 6V
28. ( D . J . )
Ronda , SIERRAS de , ( Géog.mod. ) on donne ce
nom en Efpagne à toutes ces montagnes qui font aux
frontières du royaume de Grenade 6c de l’Andalou-
fie. Cesmontagnes font extrêmement rudes, hautes,
6c ne font prefque par-tout que des rochers qui s’étendent
jufqu’à la mer. (Z ) ./ .)
RONDACHE ,f.f. efpece de bouclier rond qu’on
appelloit aufli quelquefois rondelle. On s’en fervoit
encore du tems de Henri IV. (Q)
RO N D E , FIGURE, ( Littéral. ) Euftathe prouve
dans fes remarques fur Homere , que la figure ronde
étoit celle que les anciens èftimoient le plus. Ils la
regardoient comme facrée , 6c par cette raifon ils
faifoient leurs autels ronds, leurs tables rondes, 6c
plantoient en rond les bois facrés. (D. J.')
R onde f. f. en Mujîque, eft une note blanche 6c
ronde fans queue, ainfi figurée O ; qui vaut une me-
fure entière à quatre tems, c’eft-à-dire, deux blanches
ou quatre noires. La ronde eft de toutes les notes
en ufage, celle qui a le plus de valeur ; autrefois
au contraire elle etoit celle qui en avoit le moins,
6c elle s’appelloit femi-breve. Voyt{ Semi-breve &
.Valeur des no te s. (S)
R onde , f. f. terme militaire, qui fignifie le tour ou
la marche que fait un officier accompagné de foldats
autour des remparts d’une ville de guerre pendant
la nuit, pour voir fi chacun fait fon devoir, fi les
fentinelles font éveillées, 6c fi tout eft en bon ordre.
Dans les garnifons exa&es la ronde marche tous les
quarts d’heure, de forte qu’il y a toujours quelqu’un
fur le rempart. Voye{ Mo t , L’officier qui fait fa ronde
, porte du feu, ou il en fait porter pour examiner
plus exactement les différens poftes qu’il doit vifiter.
Ronde major, eft celle que fait le major. Lorfque
la ronde-major arrive à un corps-de-garde, la fentinelle
qui eft devant les armes, dès qu’elle l’apper-
R O N
çoit, lui demande qui va la ? on répond ronde-major.
La fentinelle lui crie, demeure-là ; caporal hors de la
garde. L’officier qui commande la garde, fe préfente
accompagné de deux fufiliers qu’il place derrière
lui, l’un à fa droite , l’autre à fa gauche, préfentant
leurs armes ; il a aufli avec lui le fergent portant
hallebarde, 6c le caporal de conjîgne qui porte le fallût.
L’officier demande, qui va là? on lui répond ,
ronde-major, il dit, avance qui a l'ordre. Le major
avance, 6c l’officier, après avoir reconnu fi c’ eft
-lui-même, ou l’aide-major de la place, lui donne le
mot à l’oreille. Le major peut compter les foldats de
garde, 6c vifiter leurs armes. Cette ronde fe fait pour
vifiter l’état des corps-de-garde 6c des fentinelles,
favoir fi tous les officiers 6c foldats font à leurs poftes,
6c fi le mot eft bon par-tout. C’eft pourquoi il
faut que le major vifite les armes, 6c compte les foldats
, 6c que l’officier lui donne le mot lui-même ;
car autrement comment le major peut-il favoir fi l’o fficier
a le mot, comme il a été donné au cercle , fi-
I officier ne le lui donne ainfi?Non-feulementl’officier
doit donner le mot au major, mais encore dans la
réglé le major ne doit le recevoir que de lui ; l’ofli-
cier doit bien reconnoitre, avant de donner le mot,
fi c’eft le major , ou l’aide-major de la place, qui
fait la ronde, 6c fi fous ce prétexte quelqu’un ne
vient pas furprendre l’ordre, 6c favoir l’état de la
garde 6c des fentinelles. C’eft pour cette raifon qu’il
fait.porter le,fallût, & le s fufiliers qu’il prend, font
pour fa lùreté 6c celle de fon pofte. Aufli n’eft-il obligé
de donner l’ordre au major qu’à la première ronde
qu’il fait, 6c qu’on appelle ronde-major y 6c s’il en
vouloit faire une fécondé , il faudroit qu’il donnât
lui-même l’ordre au caporal, qui viendroit le recevoir
, comme une fimple ronde. Lorfque le major a
fait fa ronde, il va chez le gouverneur lui rendre
compte de l’état oit il a trouve les poftes. Il doit en-
fuite aller porter l’ordre au lieutenant de r o i , s’il
eft dans la place, quoique le gouverneur foit préfent,
Lorfqu’on dit que le major fait fa ronde , dès
que l’ordre eft donné, on entend feulement qu’il ne
l’a fait qu’après. Car il n’y a point pour lui d’heures
preferites. Il eft bon même qu’il la fafle à des heures
incertaines, afin de tenir toujours le corps-de-garde
alerte ; mais il faut toujours qu’il fafle la premier©
pour vérifier l’ordre dans tous les corps-de-garde.
L’officier doit aufli recevoir de la même maniéré
la ronde du gouverneur 6c celle du lieutenant de roi.
Augmentant le nombre des fufiliers avec lefquels il
la reçoit, à proportion de la dignité de celui qui la
fait ; 6c s’ils la faifoient plufieurs fois dans une même
nuit, il doit toujours la recevoir de la même maniéré.
L’infpeéteur général qui fe trouve dans une place,
peut aufli faire fà ronde, l’officier doit lui donner le
mot, fans que l’infpe&eur foit obligé de mettre pié
à terre, s’il eft à cheval. L’infpe&eur particulier peut
aufli faire la fienne ; mais il eft reçu par un caporal,
comme une fimple ronde.
A l’égard des fimples rondes, dès que la fentinelle
qui eft devant le corps-de-garde, les voit paroître,
elle leur demande, qui va là ? on lui répond ronde.
La fentinelle leur crie, demeure-là ; caporal hors de la
garde, ronde. Le caporal de pofte vient recevoir la
ronde, 6c demande qui va-là ? on lui répond, ronde.
II dit, avance qui a P ordre. La ronde avance, 6c donne
le mot à l’oreille au caporal qui le reçoit l’épée à la
main, la pointe à l’eftomac de la ronde. Si le mot eft
bon, le caporal reçoit le numéro, & le fait mettre
dans la boëte ; il fait ligner celui qui fait la ronde,
fuivant l ’ufage particulier de la garnifon, 6c la laiffe
pafler. Si le mot n’eft pas bon , i f doit l’arrêter, 6c en
rendre compte à l’officier qui examine ce que c’eft.
Lorfque deux rondes fe rencontrent fur le rempart,
celle qui la première a découvert l’autre, a droit
R O N
d-exiger l’ordre , à moins que ce ne fut le gouv erneur,
le commandant, le lieutenant de roi:, ou le
major qui la fîffent ; car en ce cas, on le leur doit
donner. On fait faire des rondes dans une place, tant
pour vifiter les fentinelles, 6c les empêcher de s’endormir,
que pour découvrir ce quife pafle au-dehors.
C ’eft pourquoi dans les places où il n’y a pas un chemin
au-delà du parapet, il faut que celui qui fait la
ronde , marche fiir la banquette, & qu’il entre dans
toutes les guérites, pour découvrir plus aifément
dans le fofîe, 6c qu’il interroge les fentinelles, s’il y
a quelque chofe de nouveau dans leurs poftes, 6c leur
fafle redire la configne.
Plufieurs gouverneurs obfervent une très-bonne
maxime, qui eft de faire une ronde un peu avant
qu’on ouvre les portes. Comme il eft déjà grand jour,
cette ronde eft tres-utile, parce qu’on peut découvrir
du rempart qui eft très-élevé , ce qui fe pafle dans la
campagne.
Le tiers des officiers qui ne font pas de garde, doivent
faire la ronde toutes les nuits à des heures marquées
par le gouverneur, 6c doivent tirer tous au
fort, fans diftinction du capitaine ou du lieutenant,
l’heure à.laquelle ils doivent la faire; 6c le majorde
la place a foin de faire écrire fur un régiftre, le nom
de tous les officiers de ronde, 6c l’heure à laquelle ils
doivent la faire,afin de pouvoir vérifier fi quelqu’un
y a manqué.Les officiers doivent la faire,à peine pour
ceux qùi y manquent, de quinze jours de prilon ,
6c de la perte de leurs appointemens pendant ce tems-
là , qui font donnés à l’hôpital de la place. Hiß. de là
milice françoife.
R onde , (Ecrit!) fe dit communément'de nos ef-
peces de lettre, dont les plains font au premier degré
droit d’obliquité fur la ligne perpendiculaire. Voye^
le volume des Planches à la table de l'écriture. Il y a
quatre fortes de rondes ; la titulaire, la moyenne du
premier degré, qui s’emploie dans les lettres-patentes
de £race, de rémiffion, dans les états du ro i,
6c généralement dans tous les comptes quife rendent
à la chambre ; la moyenne du fécond degré, en ufage
dans le notariat ; la troifieme eft la minute ufiteé
dans les finances ; la quatrième eft la große de procureur,
employée quelquefois aufli dans les finances.
RONDEAU, f. m. ( Poéfie franç. ) le rondeau eft
lin petit poëme d’un caraûere ingénu, badin 6c naïf;
ce qui a fait dire à Defpréaux î
Le rondeau né gaulois a la nàiveté.
Il eft compofé de treize vers partagés en trois ftro-
phes inégales fur deux rimes, huit mafeulines 6c cinq
féminines , ou fept mafeulines 6c fix féminines.
Les deux ou trois premiers mots du premier vers
de la première ftrophe fervent de refrain, 6c doivent
fe trouver au bout des deux ftrophes fuivantes, c’eft-
à-dire que le refrain doit fe trouver après le huitième
vers 6c le treizième. Outre cela, il y a un repos né-
ceflaire après le cinquième vers.
L’art confifte de donner aux vers de chaque ftrophe
un air original 6c naturel, qui empêche qu’ils ne
paroiflent faits exprès pour le refrain, auquel ils doivent
fe rapporter comme par hafard.
La troifieme ftrophe doit être égale à la première,
6c pour le nombre des vers 6c pour la difpofition des
rimes.
La fécondé ftrophe inégale aux deux autres ne
contient jamais que trois vers, 6c le refrain qui n’eft
point compté pour un vers.
Ce petit poëme a peut-être bien autant de difficultés
que le fonnet; on y eft plus borné pour les rimes,
6c on eft de plus, aflujetti au joug du refrain ; d’ailleurs
cette naïveté qu’exige le rondeau n’ eft pas plus
aifée à attraper que le ftyle noble 6c délicat du
fonnet.
Les vers de huit 6c de dix fyllabes font prefque les
R O N 3 59
fouis qui conviennent au rond-au. Les uns préfèrent
ceux de huit, 6c d’autres ceux de dix fyllabes ; mais
c’eft le mérite du rondeau qui feul en fait le prix. Son
vrai tour a été trouvé par Villon , Maroc & S. Gé-
làis. Ronfard vint enfuitequi le méconnut ; Sarrazin,
laFontaine 6c madame Defliouiieresfurent bien l’attraper
, mais ils furent les derniers. Les poëtes plus modernes
méprifent ce petit poëme, parce que le naïf en
fait le caraftere, 6c que tout le monde aujourd’hui
veut avoir de Fefprit qui brille,& qui pétille.
Après avoir-donné les regles dû rondeau, je vais en
citer un exemple qui contient ces réglés mêmes.
Ma-foi c’en faille moi : car Ifabeau
M'a conjuré de lui faire un rondeau :
Cela nie met en une peine extrême.
Quoi, treize vers, huit en eau, cinq en ème !
Je luijerois aujji-tôt un bateau.
En voilà cinq pourtant en un monceau.
Faifons-en huit en invoquant Brodeaü. .
Et puis mettons par quelque firataghne ,
Ma foi c’eft fait.
Si je pouvois encore de mon cerveau
Tirer cinq vers, l'Ouvrage ferait beau.
Mais cependant me voilà dans l'onrieme,
E t f i j e crois que je fais le douzième.
En voilà treize ajuflés au niveau.
Ma foi c’eft fait.
Plufieurs lefreurs aimeront fans doute autant ce
rondeau-ci de madame Delhoulieres , dont le refrain
eft entre deux draps.
Entre deux draps de toile belle & bonne ,
Que très-fouvene on rechange, on Javonne.
La jeune Iris au coeur Jincere 6* haut,
Au x yeux brillans , à l'efprit fans défaut,
Jufqu'à midi volontiersfe mitonne.
Je ne combats de goût contre perfonne ;
Mais franchement fa pareffe m'étonne !
C' efi demeurer feule plus qu'il ne faut
Entre deux* draps.
Quand q rêver ainfi l'on s 'abandonne,
Le traitre amour rarement le pardonne y
A foupirer on s'exerce bientôt ,
E t la vertu foutient un grand affaut,
Quand une fille avec fon coeur raifonne
Entre deux draps.
Le refrain doit être toujours lié avec la penfée qui
précédé , & en terminer le fens d’une maniéré naturelle
; 6c il plaît fur-tout,. quand repréfentant les'
mêmes mots , il préfente des idées un peu différentes
, comme dans celui-ci, que Malleville, fecretaire
du maréchal de Baflompiere , fit contre Boifrobert,
dans le tems qu’il étoit en faveur auprès du cardinal
Richelieu. Le P. Rapin loue extrêmement ce rondeau
dans fes remarques fur la poëfie ; 6c il mérite
en effet d’être ici placé.
Coëffé d'un froc bien rafiné ,
Et revêtu d'un doyenné
Qui lui rapporte de quoi frire,
Frère René devient meffire,
Et vit comme un détermine.
Un prélat riche & fortuné
Sous un bonnet enluminé
En efi, s’il le faut ainfi dire ,
Coëffé.
Ce n'eftpas que frere Rene
D'aucun mérite foit orné;
Qu'ilfoit docte, qu'il fâche écrire ,
Ni qiiil dife le mut pour rire ;
Mais c'efi feulement qu'il efi né
Coëffé;
R ondeau r ed o u b l é , (Poéf. franç.) cette efpece
de rondeau eft compofée d’une certaine quantité
de ftrophes égales entr’elles , 6c qui dépendent du
nombre de vers que contient la première ftrophe ;