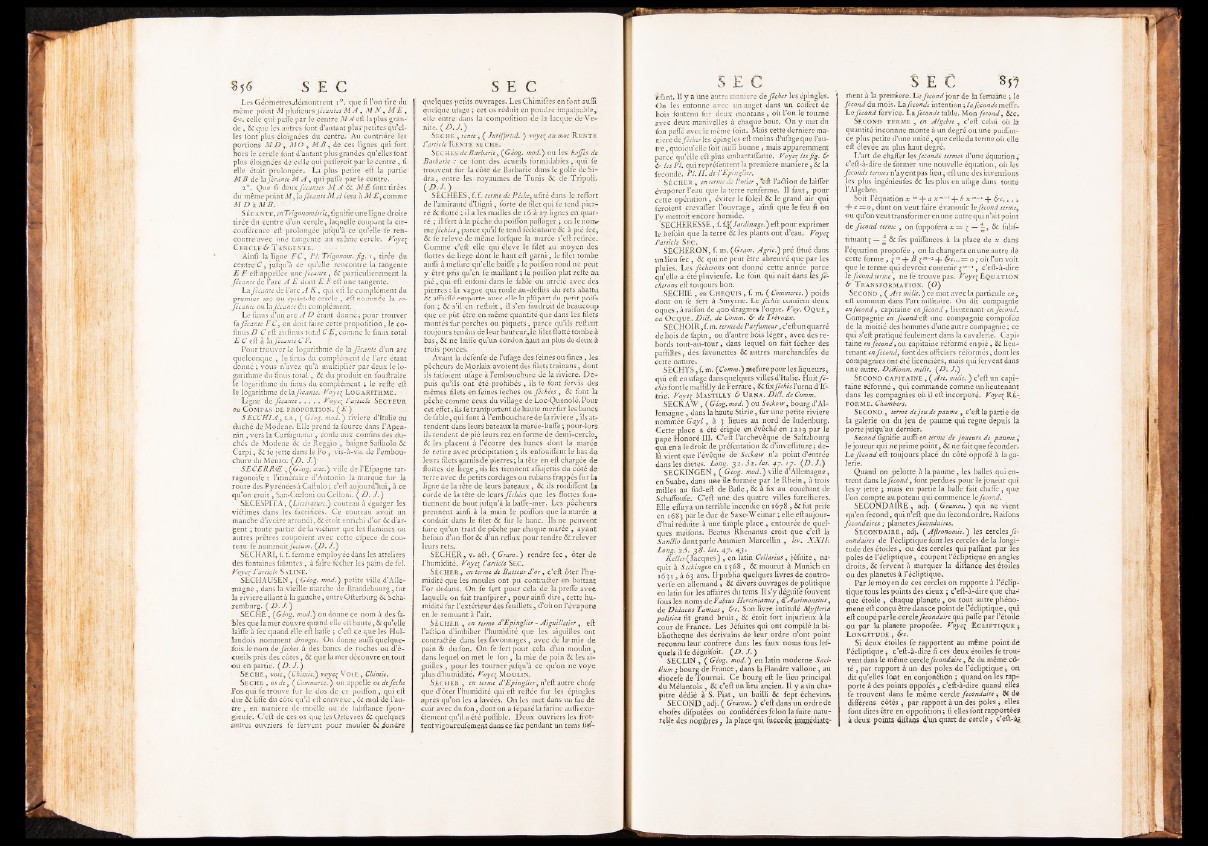
Les Géomètres.démontrent i 9-. que fi l’on tire du
même point M pluficurs'yé’cimtw M A , M N , M E ,
&c. celle quij paffé par le centre M A eft la plus grande
, & que les autres font d’autant plus'petites qu’elles
font plus"él'oi'gnées du centre. Au contraire les
portions M D , MO , M E , de ces lignes qui'fort 1
hors le cercle-font d’autant plus grandes qu’elles font'
plus éloignées de celle qui pafleroit par le centre , fi
elle étoit prolongée. La plus petite eft la partie
M B de la Jetante M A , qui pafle par le centre.
2°. Que fi deux fécantts MA-6c M E font tirées
du même point Af, la fécante M A fora à M E , comme
M D il M B.
S é c a n t e , cnTrigonoméirie, lignifie une ligne droite
tirée dit centre d’un cercle, laquelle'coupant la circonférence
eft prolongée jufqu’à ce '"qu’elle1• fè rencontre
avec une tangente au même cercle. Koye^
C e r c l e 6 * T a n g e n t e .
Ainfi• la ligne F C , PL Trigonom. fig. i , tirée du
centre'£ f jufqu’à ce qu’elle rencontre la tangente
E F eft appellee une fécante , 6c particulièrement la
fécante de l’arc A £ dont E F ei\ une tangente.
La fécantedel’arc A K , qui eft le complément du
premier arc ou quârt-de cercle , eft nommée la co-
fécante ou la /tVa/.’.'i du complément.
Le finus-d’un arc A D étant donné ; pour trouver
fa fécanu FC., on doit faire cette propofition, le co-
finus D C eft au finus total C E , comme le finus total
E C eft à" là fécante C F.
Pour trouver le logarithme de la fécante d’un arc
quelconque,, le finus du complément de l’arc étant
donné ; vous n’àvez qu’à multiplier par deux le logarithme
du -finus,total, 6c du produit en fouftraire
le logarithme du finus du complément ; le refte eft
l e logarithme de la fecame. Voye{ L o g a r i t h m e .
• Ligne de fécante...........Voyef C article SECTEUR
ou C o m p a s d e p r o p o r t i o n . ( E )
SECCHIA, l a , ( Géog. mod.) riviere d’Italie au
- duché d'e Modene. Elle prend fa lource dans l’Apennin
, vers la Carfaguana , coule aux confins des duchés
de Modene 6c de Reggio , baigne Safliiolo 6c
Carpi, 6c fe jette dans le P o , vis-à-vis de l’emboii-
chure du Menzo. (JD. J.')
SECERROE , (Géog. anc.j. ville de l’Efpagrie tar-
ragonoife : l’itinéraire d’Antonin la marque fur la
route des Pyrénées à Caftufo;; .c’eft aujourd’hui, à ce
qu’on croit, San-Coeloni ou Celloni. ( D . J. )
SECESPITA, (Littérature.) couteau à égorger les
viûimes-dans les facrifices. .Ce couteau avoit un
manche d’ivoire arrondi, 6c étoit enrichi d’or 6c d’argent
; toute partie de la victime que les flamines ou
autres prêtres coupoient avec cette efpece de couteau
fe nommoit Jecium. (D. J.)
SECHARI, f. f. femme employée dans les atteliers
des fontaines falantes, à faire fecher les pains de fel.
Voye^ l'article S a LINE.
SECHAUSEN, (Géog. mod.') petite ville d’Allemagne
, dans la vieille marche de Brandebourg, fur
•la riviere allant à la gauche, entre Ofterburg 6c Scha-
remburg. ( D . J. ) fc .
SECHE , (Géog. mod.) on donne ce nom à des fables
que la mer couvre quand elle eft haute, & qu’elle
-laifîe à fec quand elle eft baffe ; c’eft ce que les Hol-
landois nomment droogte. On donne aufli quelquefois
le nom de feches à, des bancs de roches ou d’écueils
près des côtes, 6c que la mer découvre en tout
■ ou en partie. (D . J. )
S E C H E , voie, (Chimie.) ÿoye^VOIE-, Chimie.
S ECH E , os de, (Commerce.) Qn appelle os de feche
l ’os qui fe trouve fur le dos de ce poiffon , qui eft
dur 6c liffe du côté qu’il eft convexe , & mol de l’autre
, en maniéré de moelle ou de fubftance fpon-
gieufe. C’eft de ces os que les Orfèvres & quelques
autres ouvriers fe fervent pour mouler, 6c /ondre
quelques petits ouvrages. Les Chimiftes en font aufli
quelque ufage ; cet os réduit en poudre impalpable,
elle entre dans la compofition de la lacque de Vende.
( D .J .)
Seghe , rente ) ( Jurifprud. ) voyeç au mot R ente
l'article Rente secre.
SECHES de Barbarie, (Géog. mod.') ou les baffes de
Barbarie c c e fo n t des écueils formidables , .qui'fe
trouvent fur la côte de Barbarie dans le golfe de Si-
dra, entre les royaumes de Tunis 6c de Tripoli.
■ ■ | •• ; I ■ ■
SÉCHÉES, f. f. terme de Pêche, ufitc dans le reffort
de l’amirauté d’Ifigni, forte de filet qui fe tend pier-
ré 6c ftotté ; il a les mailles de 16 à 17, lignes en quatre
; il fert à In pêche du poiffon pàffager ; on le nom*-
me féchées, parce qu’il fe tend fédéntaire & à pié fec,
& fe releve de même lorfque la marée s’eft retirée.
Comme c’eft elle qui éleve le filet au moyen des
flottes de liege dont le haut eft garni, le filet tombe
aufli à mefure qu’elle baiffe ; le poiffon rond ne peut
y être pris qu’en fe maillant ; le poiffon plat refte au
p ié , qui eft enfoui dans le fable ou arrêté avec des
pierres : la vague;qui roule au-deffus du rets abattu
6c affaiffé emporte avec elle la plûpart du petit poifir
fon ; 6c s’il en reftoit, il s’en faudroit de beaucoup
que ce pût être en même quantité que dans les filets
montés fur perches ou piquets, parce qu’ils relient
toujours tendus de leur hauteur ,1e, filet flotté tombe à
bas, 6c ne laiffe qu’un cordon haut au plus de deux à
trois pouces.
Avant la défenfe de l’ufage des feines ou fines , les
pêcheurs de Morlaix avoient des filets traînans, dont
ils faifoient ufage à l’embouchure de la riviere. Depuis
qu’ils ont été prohibés , ils fe font fervis des
mêmes filets en feines lçches ou féchées, 6c font la
pêche comme ceux du village de Loc-Quenolé. Pour
cet effet, ils fe transportent de haute mer fur les bancs
de fable, qui font à l’embouchure de la riviere , ils attendent
dans leurs bateaux la marée-baffe ; pour-lors
ils tendent de pié leurs rez en forme de demi-cercle,
6c les placent à l’écorre des bancs dont la. marée
fe retire avec précipitation ; ils enfouiffent le bas de
leurs filets garnis de pierres ; la tête en eft chargée de
flottes de liege, ils les tiennent affujettis du côté de
terre avec de petits cordages ou rubans frappés fur la
ligne de la tête de leurs bateaux, 6c ils roidiffent la
corde de la tête de leprs féchées que les flottes fou-
tiennent de bout jufqu’à la baffe-mer. Les pêcheurs
prennent ainfi à la main le poiffon que la marée a
conduit dans le filet & fur le banc. Ils ne peuvent
faire qu’un trait de pêche par chaque marée , ayant
befoin d’un flot 6c d’un reflux pour tendre & relever
leurs rets,
SÉCHER, v. aft. ( Gram. ) rendre fec , ôter de
l’humidité. Voye\ l'article Sec.
SÉCHER, en terme de Batteur d'or , c’eft ôter l’humidité
que les moules ont pu contracter en battant
l’or dedans. On fe fert pour cela de la preffe avec
laquelle on fait tranfpirer, pour ainfi dire, cette humidité
fur l’extérieur des feuillets, d’oii on l’évapore
en le remuant à l’air.
SÉCHER , en terme d'Epinglier:- Aiguilletier , eft:
l’action d’imbiber l’humidité que les aiguilles ont
contractée dans les favonnages, avec de la* mie de
pain & du fon. On fe, fert pour cela d’un moulin,
dans lequel on met le fon , la mie de pain 6c les aiguilles
, pour les tourner jufqu’à ce. qu’on ne voye
plus d’humidité. Voye^ Mo u lin .
Sécher , en terme d'Epinglier', n’eft autre chofe
que d’ôter l’humidité qui eft reftée fur les épingles
après qu’on les a lavées. On les met dans un fac de
cuir avec du fon, dont on a féparé la farine aufli exactement
qu’il.a été poflible. Deux ouvriers les frottent
vigoureufemeat dans ce fac pendant un tems fusf-
‘■ fifant. Il y a 'ùnè autre maniéré d e fécher lès épingles.
On les entonne avec un auget dans un coffret de
bois foutenu fur deux montans -, où l’on le tourné
avec deux manivelles à chaque bout. On y met du
fon paffé avec le même foin. Mais cette dernierema-
niere àefécherlcs épingles eft moins d’ufageque l’autre,
quoiqu’elle foit aufli bonne, mais apparemment
parce qu’elle eft plus embarraffante. Voye^ les fig. &
& les PI. qui repréfentent la première maniéré ,6c la
fecgnde. PL II. de l'Epinglier.
SÉCHER, en terme de Potier, *ëft l’aCtion de laiffer
évaporer l’eau que la terre renferme. Il faut , pour
cette opération, éviter le foleil 6c le grand air qui
feroient crevaffer l’ouvrage, ainfi que le feu fi on
l’y mettoit encore humide.
SÉCHERESSE, f. f-.\( Jardinage-.) eft pour exprimer
le bèfoin que la terre 6c les plants ont d’eau. Voye{
l'article S e c ,
SÉCHERON, f. m. (Gram. Âgric.) pré fitué dans
lin lieu fec , 6c qui ne peut être abreuvé que par les
pluies. Les ficherons ont donné cette année parce
qu’elle a été pluvieufe. Le foin qui naît dans les f i cherons
eft toujours bon.
SECHIE , où C h e q u i s , f. m. ( Commerce. ) poids
dont on fe fert à Smyrne. Le fechie contient deux
oques, à raifon de 400 dragmes l’oqtie. Voy. O q u e ,
■ pu O cQ U E . Dict. de Comm. & de Trévoux-,
SÉCHOIR, f. m. terme de Parfumeur, c’eft un quarré
de bois de fapin, ou d’autre bois léger, avec des rebords
tout-au-tour, dans lequel on fait fécher des
paftilles, des favonettes & autres marchandifes de
cette nature»
SÉCHYS, f. m. (Comm.) mefure pour les liqueurs,
qui eft en ufage dans quelques villes d’Italie. Huitfé-
cAri fonde maftilly de Ferrare, 6c fixféchis l’urna d’If-
trie. Voye{ M a s t i l l y & U r n a . Dicl. de Comm.
S E C K A V , (Géog.mod. ) ou Seckow, bourg d’Allemagne
, dans la haute Stirie, fur une petite riviere
nommée G a y l, à 3 lieues au nord de Iudenburg.
Cette place a été érigée en évêché en 1219 par le
pape Honoré III. C’eft l’archevêque de Saltzbourg
qui en a le droit de préfentation 6c d’inveftiture ; delà
vient que l’évêque de Seckaw n’a point d’entrée
dans les dietes. Long. 32. S i . lat. 47. ty. (D .J .)
SECKINGEN, ( Géog. mod. ) ville d’Allemagne *
en Suabe -, dans une île formée par le Rhein, à trois
milles au füd-eft de Bafle, & à fix au couchant de
Schaffoufe. C’eft une des quatre villes foreftieres.
Elle effuya un terrible incendie en 1678, & fut prife
en 1683 parle duc de Saxe-Weimar ; elle eft aujourd’hui
réduite à une fimple place , entourée de quelques
maifons. Beatus Rhenanus croit que c’eft la
Sanclio dont parle Ammien Marcellin , liv. X X Ih
Long. 26. 3 S. lat. 47' 43 \ ,
Kellér(Jacques) , en latin Cellarius * jéfuite, naquit
à Seckingen en 1568 -, & mourut à Munich en
16 3 1 , à 63 ans; Il publia quelques livres de contro-
verfe en allemand , 6c divers ouvrages de politique
en latin fur les affaires du tems. Il s’y déguife fouvent
fous les noms de Fabius Hercinianus, d'Aurimontius,
de Didacus Tamias, &c. Son livre intitulé Myfieria
politica fit grand bruit, 6c étoit fort injurieux à la
cour de France. Les Jéfuites qui ont compilé la bibliothèque
des écrivains de leur ordre n’ont point
reconnu leur confrère dans les faux noms fous lesquels
il fe déguifoit. (D . J . )
SECLIN , ( Géog. mod. ) en latin moderne Saci-
lium ; bourg de France, dans la Flandre vallone, au
diocefe de Tournai. Ce bourg eft le lieu principal
du Mélantois , 6c c’eft un lieu ancien. Il y a lin chapitre
dédié à S. Piat, un bailli 6c fept échevins.
SECOND, adj. ( Gramnu ) c’eft dans un ordre de
chofes difpolées ou confidérées félon la fuite natu-
t«Ue des »«pj)wes; la place (accédé pæédiâtement
à la première. Le fécond jour'de la fiemaille ; lè
fécond du mois. La fécondé intention ; lafécondé méfié-.
Le fécond fervice. La fécondé table. Mon fécond, & c .
Se c o n d t e r m e , en Algèbre , c ’ e ft c e lu i o ù là
q u a n t ité in c o n n u e m o n te à un d e g r é o u u n e p u iffan-
c e p lu s p e t ite d ’u n e u n i t é , q u e c e lle du t e rm e o ù e lle
e ft é le v é e a u p lu s h a u t degré»
L’art de chaffer les féconds termes d’une équation •,
c’eft-à-dire de former une nouvelle équation, où les
féconds termes n’ayent pas lieu , eft une des inventions
les plus ingénieufes 6c les plus en ufage dans toute
l’Algèbre.
Soit l’équation x -f- à x m~î -\-b x m~l + &c. ; . 5,
+ « = 0 , dont on veut faire évanouir lefécond terme-,
ou qu’on veut transformer en une autre qui n’ait point
de fécond terme , on ftippofera # = £ — - , & fubf-
tituant^ — ~6c fes puiffances à la place de x dans
l’equation propofée, on la changera en une autre dè
cette forme , [ m -J- B [ m~- -f- &c... = o ; où l’on voit
que le terme qui devroit contenir i m~l , c’eft-à-dirè
le fecondterme, ne fe trouve pas. Voye-^ É q u a t i o n
& T r a n s f o r m a t i o n . (O )
S e c o n d , ( Art milit.) ce mot avec la particule en,
eft commun dans l’art militaire. On dit compagnie
en fécond, capitaine en fécond, lieutenant en fécond.
Compagnie en fécond eft une compagnie contpoféè
de la moitié des hommes d’une autre compagnie ; ce
qui s’eft pratiqué feulement dans la cavalerie. Capitaine
en fécond, ou capitaine réformé en pié , 6c lieutenant
en fécond, font des officiers réformés, dont les
compagnies ont été licenciées, mais qui fervent dans
une autre. Diclionn. milit. (D. J.)
S e c o n d c a p i t a in e ,(A r t. milit. ) c’eft ün capitaine
déformé , qui commande comme un lieutenant
dans les compagnies où il eft incorporé. Voye{ RÉ-.
FORME. Chàmbers\
S e c o n d , terme de jeu de paume , c’eft la partie de
la galerie ou du jeu de paume qui régné depuis là
porte jufqu’au dernier.
Second fignifie aufli en terme de joueurs de paume ±
le joueur qui ne prime point, 6c ne fait que fecorider.
Le fécond eft toujours placé du côté oppofé a la galerie:
Quand on pelotte à la paume, les balles qui entrent
dans le fécond, font perdues pour le joueur qui
les y jette ; mais en partie la balle fait chaffe, qué
l’on compte au poteau qui commence le fécond.
SECONDAIRE , adj. ( Gramm. ) qui ne vient
qu’en fécond, qui n’eft que du fécond ordre: Raifons
fecondaires ; planètes fecôndaircs.
S e c o n d a ir e , ad j. ( Aftronomie. ) lëS c e r c le s fecondaires
d e l’ é c lip t iq u e fo n t le s c e r c le s d e la lo n g itu
d e des é to i le s >, o u d es c e r c le s q u i p a ffan t p a r le s
p ô le s de l’é c l ip t iq u e , c o u p e n t l ’é c lip t iq u e en an g le s
d r o i t s , 6c fe r v e n t à m a rq u e r la d iftan c e d e s é to i le s
o u d es p lan è te s à l’ é c lip t iq u e »
Par le moyen de ces cercles on rapporté à l'écliptique
tous les points des cieux ; e’eft-à-dire que chaJ
que étoile , chaque planete, ou tout autre phénomène
eft eonçii être dans ce point de l’écliptique, qui
eft coupé parle cerclefecondaire qui paffe par l’étoilé
ou par la planete propofée. Voye^ É c l i p t i q u e ;
L o n g i t u d e , &e.
Si deux étoiles fe rapportent au même point dé
l’écliptique ; c ’eft-à-dire fi ces deux étoiles fe trouvent
dans le même cercle fecondaire, 6c du même côté
, par rapport à un des pôles de l’écliptique j oit
dit qu’elles font en conjonction ; quand on les rapporte
à des points oppofés , c’eft-à-dire quand elles
le trouvent dans le même cercle fecondaire j & d«
différens côtés , par rapport à un des pôles $ elles
font dites être en oppofitiôn ; fi elles font rapportée^
à deux points diftaxis d’un quart de cercle, e’eft-à*