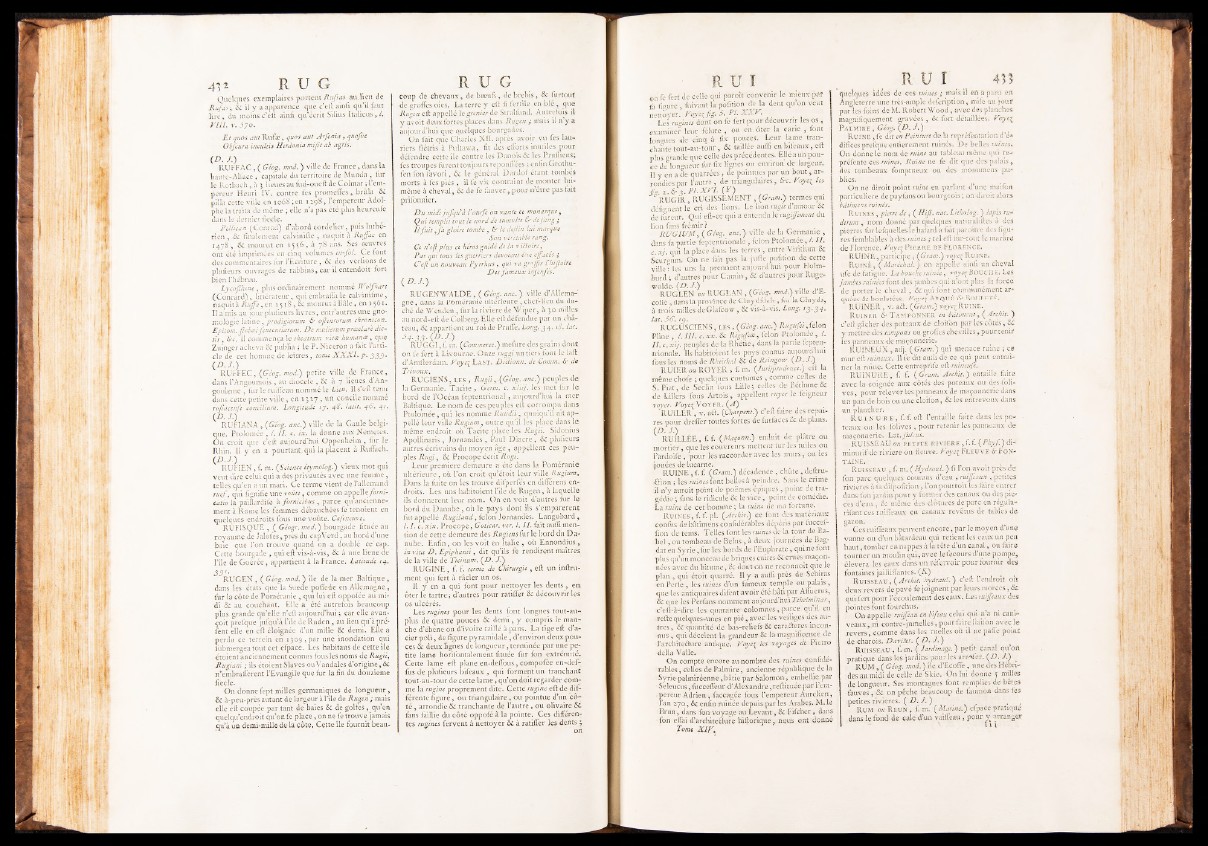
R U G
ltc. ai v.uiinii'. u v a iv --------? i —
no-er acheva & publia ; le P. Niceron a fait l’article
cet homme de lettres, tome X X X I . p. 339,
43 2
Quelques exemplaires portent Rufras au.lieu de
Rufas ; &c il y a apparence .que c’eft ainfi qu’il faut
lire, du moins c’eft ainfi qu’écrit Silius Italicus, /.
VUI. v. Syo.
E t quos Rufæ, quos aut Arfenia , quojve
Obfcura incultis Herdonia mijit ab agris.
(D . J.)
RUFFAC, ( Géog. mod. ) ville de France, dans la
haute-Aliace , capitale du territoire de Munda, fur
le Rotbach, à 3 lieues au fud-oueft de Colmar , l’empereur
Henri IV. contre fes promeffes, brûla &
pilla cette ville en 1068 ; en 1198, l’empereur Adolphe
la traita de même ; elle n’a pas ete plus heureufe
dans le dernier fiecle.
Pcllican (Conrad) d’abord cordelier, puis luthérien
, •& finalement cal vinifie , naquit à Ruffac en
1478 , &. mpurut en 1556 , à 78 ans. Ses oeuvres
ont été imprimées en cinq volumes in-fol. Ce font
des commentaires fur l’Ecriture , & des verfions de
plufieurs ouvrages de rabbins, car il entendoit fort
bien l'hébreu.
Lycof lient, plus ordinairement nommé Wojfhart
(Conrârd), littérateur, qui embrafîa le calvinifme,
naquit à Rujja, en 1518 , & mourut à Bâle, en 1561.
Il a mis au jour plufieurs livres, entr’autres une gno-
moloeie latine , prodigiorum <S* ofient orum chronicon.
Epitom.jlobcei fententiarum. De mulierumproeclarè dictés
, &c. 11 commença le theatrum vitæ humanoe, que
Zuin^
cle de
( D .J . ) I
RUFFEC, (Géog. mod.') petite ville de France,
dans l’Angoumois , au diocefe , & à 7 lieues d An-
gouleme , fur le ruifleau nommé le Lieu. Il s’eft tenu
dans cette petite ville , en 1317 , un concile nomme
rojiaccnfe concilium. Longitude //. 48. latit. 4G. 41.
(D . J.)
RUFIANA , (Géog. anc.) ville de la Gaule belgi-
que. Ptolomée , l. II. c. ix. la donne aux Nemetes.
On croit que c’eft aujourd’hui Oppenheim , fur le
Rhin. Il y en a pourtant, qui la placent à Ruffach.
(D .J .)
RUFIEN, f. m. (Science étymolog.) vieux mot qui
veut dire celui qui a des privautés avec une femme,
telles qu’en a un mari. Ce terme vient de l’allemand
ruef, qui lignifie une voûte, comme on appelle forni-
catio la paillardife à fornicibus , parce qu’ancienne-
ment à Rome les'femmes débauchées fe tenoient en
quelques endroits fous une voûte. Cafcneuve.
RUFISQUE , ( Géogr. mod.) bourgade fituée au
royaume de Jalofes, près du capVerd, au bord d’une
baie que l’on trouve quand on a doublé ce cap.
Cette bourgade , qui eft vis-à-vis, &: à une lieue de
n ie de Goérée, appartient à la France. Latitude 14.
3 S ) i.
RUGEN , ( Géog. mod. ) île de la mer Baltique ,
dans les états que la Suede poliede en Allemagne ,
fur la côte de Poméranie , qui lui eft oppolée au midi
&: au couchant. Elle a été autrefois beaucoup
plus grande qu’elle n’eft aujourd’hui ; car elle avan-
çoit prefque jufqu’à l’île de Ruden, au lieu qu’àpré-
fent elle en eft éloignée d’un mille & demi. Elle a
perdu ce terrein en 1309, par une inondation qui
fubmergea tout cet efpace. Les habitans de cette île
étoient anciennement connus fous les noms de Rugiiy
Rugiani ; ils étoient Slaves ou Vandales d’origine, &
n’embrafferent l’Evangile que fur la fin du douzième
fiecle.
On donne fept milles germaniques de longueur ,
& à-peu-près autant de largeur à l’île de Rugen ; mais
elle eft coupée par tant de baies & de golfes, qu’en
quelqu’endroit qu’on fe place, on ne fe trouve jamais
qu’à un demi-mille de la côte. Cette île fournit beau-
R U G
coup de chevaux, de boeufs, de brebis , & furtouf
de grofles oies. La terre y eft fi fertile en blé , que
Rugen eü appellé le grenier de Stralfund. Autrefois il
y avoit deux fortes places dans Rugen ,• mais il n’y a
aujourd’hui que quelques bourgades. ^
On fait que Charles XII. après avoir vu fes lauriers
flétris à Pultawa, fit des efforts inutiles pour
défendre cette île contre les Danois & les PrufîienS;
fes troupes furent toujours repouflées ; enfin Grothu-
fen fon favori, & le général Dardof étant tombes
morts à fes pies , il fe vit contraint de monter lui-
même à cheval, & de fe fauver, pour n’etre pas fait
prifonnier.
D u midi jufquà l'ourfe on vante ce monarque ,
Qui remplit tout le nord de tumulte & dej'ang ;
I l fuit yfa gloire tombe , & le defiin lui. marque
Son véritable rang.
Ce ne fi plus ce héros guidé de la victoire,
Par qui tous les guerriers dévoient être effaces ;
C,efi un nouveau Pyrrhus, qui va grojjîr Cht foire
Des fameux infenfés.
( D . J . )
RUGENWALDE, ( Géog. anc. ) ville d’Allemagne,
dans la Poméranie ultérieure , chef-lieu du duché
de V en d en , fur la riviere de W iper, à 30 milles
au nord-eft de Coiberg. Elle eft défendue par un château,
& appartient au roi de Pruffe. Long. 34.18. lat.
5 4 .3 j . (D .J .)
RUGGI, f. m. (Commerce.) mefure des grains dont
on fe fert à Livourne. Onze ruggi un tiers font le laft
d’Amfterdam. Voye^ L a st . Di'dionn. de Comrn. & de
Trévoux.
RUGIENS, LES , Rugiiy (Géog. anc.) peuples de
la Germanie. Tacite , Germ. c. xliij. les met fur le
bord de l’Océan feptentrional , aujourd’hui la mer
Baltique. Le nom de ces peuples eft corrompu dans
Ptolomée, qui les nomme Rutidii, quoiqu’il ait appellé
leur ville Rugium, outre qu’il les place dans le
même endroit oû Tacite place les Rugii. Sidonius
Apollinaris , Jôrnandès , Paul Diacre , & plufieurs
autres écrivains du moyen âge , appellent ces peuples
Rugi, & Procope écrit Rogi.
Leur première demeure a été dans la Poméranie
ultérieure, oû l’on croit qu’étoit leur ville Rugium.
Dans la fuite on les trouve difperfés en différens endroits.
Les uns habitoient l’île de Rugen, à laquelle
ils donnèrent leur nom. On en voit d’autres fur le
bord du Danube , où le pays dont ils s’emparèrent
fut appellé Rugilandj félon Jornandes. Langobard,
L I . c. x ix. Procopë, Goticar. ver. I. II. fait aufli mention
de cette demeure des Rugiens furie bord du Danube.
Enfin, on les voit en Italie , oû Ennondius.,
in vita D. Epiphanïi, dit qu’ils fe rendirent maîtres
de la ville de Ticinum. (D. J.)
RUGINE, f. f. terme de Chirurgie , eft un inftru-
ment qui fert à racler un os.
Il y en a qui font pour nettoyer les dents, en,
ôter le tartre ; d’autres pour ratifier & découvrir les
os ulcérés.
Les rugines pour les dents font longues tout-au-
plus de quatre pouces & demi, y compris le manche
d’ébene ou d’ivoire taillé à pans. La tige eft d’acier
poli, de figure py ramidale, d’environ deux pouces
& deux lignes de longueur, terminée par uiie petite
lame horifontalement fituée fur fon extrémité.
Cette lame eft plane en-deflous, compofée en-def-
fus de plufieurs bifeaux , qui forment un tranchant
tout-au-tour de cette lame, qu’on doit regarder comme
la rugine proprement dite. Cette rugine eft de différente
figure , ou triangulaire , ou pointue d’un côté
, arrondie & tranchante de l’autre , ou olivaire &
fans faillie du côté oppofé à la pointe. Ces différentes
rugines fervent à nettoyer &. à ratifier les dents ;
R U I
on fe fert de celle qui paraît convenir le mieux par
la doute , fuivnnt ’ a position de la dent qu’on veut
nettoyer, Poye^fig. i>. Pt. X X V .
Les mgmts dont on fe fert pour découvrir les Os » ;
examiner leur fêlure , ou en orer la carie , font
longues de cinq à fix pouces. Leur lame tranchante
tottt-'aù-tour , &: taillée âuffi en bifeaux, eft
plus grande que celle des précédentes. Elle a un pouce
de longueur fur fix lignes bu environ de largeur,
Il y en a de quarrées, 4%pointues par un bout , arrondies
par l’autre , de triangulaires H ■
RUGIR, RUGISSEMENT , (Grdni.) termes qui
défignënt le cri des lions. Ce lion;«-;, d’amour &
de fureur. Qui eft-ce qui afeiftendu^ lerugijfaneni du
lion fans frémir ?
RUGIUM, ( Géog. ont.) ville de la Germanie ,
dans fa partie feptentrionalê , lelon Ptolomée, /. II.
c.xj. qui la place dans les terres , entre Viritiunr &
Scumim. Gn ne fait pas la jolie poiiîion de cette
ville île s uns la prennent aujourd'hui pour Holm-
burd ; d’autres pour Gamin , &t d autres pour RUge-
W d c . {D. J.) , ■
RUGLEN 0/1 RUGI.AN , « c # v i ll e dE*
colfe, dans la pr ovince de Cluy dfdale, fur la Cluyds,
à trois milles deGlafcow , & vis-à-vis, Long. 13.34.
lat. SGi icf . . . . ...
RUGUSCIENS, les , (Géog. atic.) Rugufci, félon
Pline , 1. 111. c. xx. ôc Rigufca, félon Ptolomée, /.
II. c. xij. peuples de la Rhétie, dans la partie fepten-
trionale. Ils habitoient les pays connus aujourd’hui
fous les noms de Rheithal & de Rcingow. (D. J.)
RU 1ER. ou R O Y E R , f. m. (jurijprudence.) eft la
même chofe ; quelques coutumes , comme celles de
S. Piat, de Seclin fous Lille; celles de Béthune &
de Lîllers foüs Artois-,; appellent ruyer le feigneur
voyer. VoyefWOYER. (A)
RÜILER , v. aft. (Charpent.) c’eft faire des repaires
pour dreffer toutes fortes de furfaces & de plans,
(D .J .)
RU1LLÉE, f. f. (Maçonn.) enduit de plâtre ou
mortier , que les couvreurs mettent fur les tuiles ou
l’ardoife , pour tes raccorder avec les murs, ou les
jouées de lucarne.
RUINE, f. f. (Gram.) décadence , ehûte, deftru-
ôion ; les ruines f ont belles à peindre. Sans le crime
il n’y auroit point de poërnes épiques , point de tragédie
; fans le ridicule & le v ic e , point de comedie.
La ruine de cet homme ; la ruine de ma fortune.
Ruines , f. f. pi. (Arcku.) ce font des matériaux
confiis de bâtimens confidérables dépéris par fuccei-
fion de tems. Telles font les ruines de la tour de Babel
, ou tombeau de Belus , à deux journées de Bag-
dat en Syrie, fur les bords de l’Euphrate, qui ne iont
-plus qu’un monceau de briques cuites & crues maçonnées
avec du bitume, & dont on ne reconnoît que le
plan , qui étoit quarré. Il y a aufli près de Schiras
en Perle , les ruines d’un fameux temple ou palais ,
que les antiquaires difent avoir été bâti par Aflûerus,
& que les Perfans nomment aujourd’hui Tckelminar ,
c’eft-à-dire les quarante colomnes, parce qu’il en
relie quelques-unes en pié, avec les veftjges des autres
, & quantité de bas-reliefs & carafteres inconnus
,- qui décelent la grandeur & la magnificence de
l’architeâure antique. Voye{ les voyages de Pietro
délia Va lie . ; , • . i . •
On compte encore au-nombre des ruines çonfide-
rables, c’elles de Palmire, ancienne république de la
Syrie palmiréenne, bâtie par Salomon, embellie par
■ Seleucus, fuccefleur d’Alexandre,rellituéepar l’em-
rpereur Adrien, faccagée fous l’empereur Aurelien,
l’an 270, & enfin ruinée depuis par les Arabes. M-. le
Brun, dans fon voyage au Levant, & Fifcher, dans
-fon effai d’architecture hiftorique, nous ont donne
Tome Xir*À
R U I 433
quelques idees de ces ruina ; mais il êfl à parti ëft
Angleterre une très-ample defeription, mife au jour*
par les foins de M, Robert "Wood, avec des planches
magnifiquement gravées , & fort détaillées, V
Palmire , Géog. (D . J .) .
Ruine vfe dit en Peinture de lâ reptéfentatiofi d’é*
difices prefque entièrement ruinés. De belles ruines*
On donne le nom de ruine au tableau même qui repréfente
CeS ruines. Ruine rte fë dit que des palais ,
des tombeaux fomptueux ou des monumens pu* ,
blics.
On në diroit point riùnè en parlant d’une maifori
particulière de payfans ou bourgeois ; on diroit alors
bâtimens ruinés;
RUINES, pierre de i ( H i f . nat. Litholog. ) lapis ru-*
derum , nom donné par quelques naturaliflës à des
pierres fur lefquellesle hafard a fait paroître des fi gu*
res femblables à des-ruincs ; tel ëft fur-tout le marbre
de Florence. Voyei Pierre de Florence.
RUINÉ, participe, (Gram.) voyeç R uiné.
Ruiné , ( Maréchal. ) on appelle ainfi un cheval
ufé de fatigue. La bouche ruinée, voye^ Bouc H E. LeS
jambes ruinées {ont des jambes qui n’ont plus la force
' de porter le cheval, & qui font communément ar*
quées & bouletées. V.oye^ Arqué & Bouleté,
RUINER, v. aél. (Gram.)voye^Ruine.
Ruiner & T amponner en bâtiment, (Archit. )
c’eft gâcher des poteaux de cloifon jiar tes cotes, &G
y mettre des tampons ou groftes chevilles, pour tenû
les panneaux de maçonnerie»
RUINEUX, adj. ( Gram.) qui menacé ruine ; ce
mur eft ruineux. Il fe dit aufli de ce qui peut entrai*
ner la ruine. Cette entreprife eft ruineufe.
RUINURE, fi f. (Gram, Archit.) entaille faite
avec la coignée aux côtés des poteaux ou des-foli*
v e s, pour relever les panneaux de maçonnerie dans
un pan de bois ou une cloifon, & les entrevoux dans
un plancher.
R u i n u r e , fi fi eft l’entaille faite dans les po« -
teaux oïl' les folives , pour retenir les panneaux de
maçonnerie. Lat.fulcus.
RUISSEAU ou petite riviere , fi fi ( R/iy/) diminutif
de riviere ou fleuve. Voyei Fleuve & Fon-<
taine. s
Ruisséau , fi m. (Hydraul.j fi l’on avoit près de
fon parc- quelques courans d’eau , ruijfeaux , petites
rivières à la difpofition ^l’onpourroit lesffaife entrer
dans fon jardin pour y former des canaux ou des pie*
dès d’eau , & même des clôtures de pafe en régula-
rifant ces ruiffeaux en canaux revêtus de tables de
gazon.
- Ces ruiffeaux peuvent encore, par le moyen d’une
vanne ou d’un bâtardeau qui retient les eaux un peu
haut, tomber en nappes à la tête d’un canal, ou faire
tourner un moulin qui, avec lefecours d’une pompe,
élevera les eaux dans un réfervoir pour fournir des
fontaines jaillifiantes. (K) , \
Ruisseau, (Archit. hydraul,) c’eft l’endroit Oit
deux revers de pave fe joignent par leurs morces, ôc
qui fert pour l’écoulement des eaux. Les ruijffèaux des
pointes font fourchus*' : : ‘; :P. t.
On appelle ruifj'eauèn bifeau celui qui n’a ni cani^
veaux, ni contre-jumelles, pour faire liaifon avec lé
revers, comme dans les ruelles oû il ne pafîe point
•' de charois. Davil'er. ( D. J.)
Ruisseau , fi m. (Jardinage.) petit Canal qu’oft
pratique dans les jardins pour les arr^er. (D , J.) |
RUM, ( Géog. mod. ) île d’Ecoffe , une des Hébrn
des au midi de celle de Skie. On lui donne 5 mfiles
de longueur. Ses montagnes font remplies de bêtes
fauves, & on pêche beaucoup de faumofl dans fes
petites rivières. ( D, J .) ' : ’ v - v !J 4 t
Rum ou Reun , fi m, (Marine.) efpace pratique
dans te fond de cale d’un vaiffeau, pour-^ arranger1.
1 1 1 i