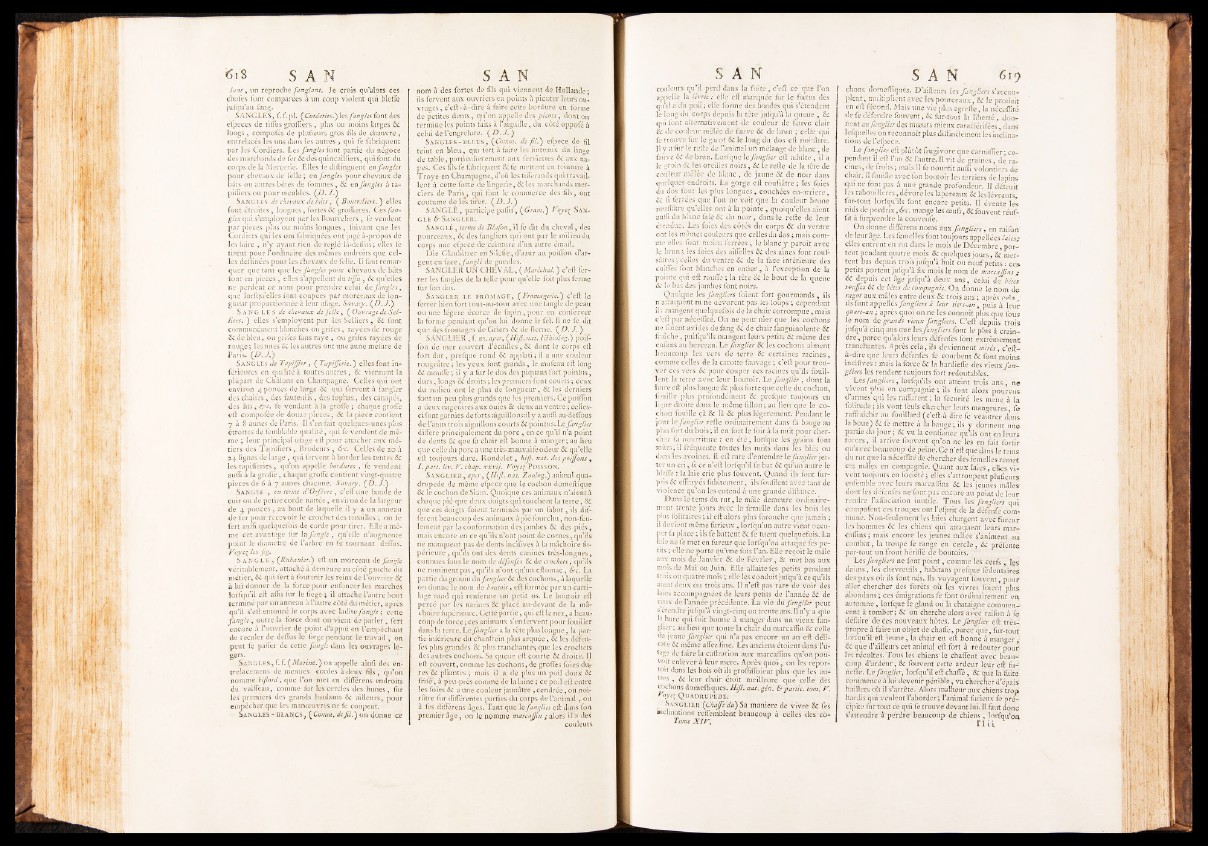
<5i3 SAN
lant, un reproche /anglant. Je crois qu’alors ces
choies font comparées à un coup violent qui bleffe
jufqu’au fang.
SANGLES, f. f. pl. ( Corderi es.), les /angles (ont des
éfpeces de tilfus groffiers , plus ou moins larges 6c
longs , compofés de plufieurs gros fils de chanvre ,
entrelacés les uns dans les autres , qui fe fabriquent
par les Cordiers. Les /angles font partie du négoce
des marchands de fer 6c des quincailliers, qui font du
corps de la Mercerie. Elles fe diftinguent en /angles
pour chevaux de felle ; en /angles pour chevaux de
bats ou autres bêtes de fournies, 6c en /angles à ta-
pifliers ou pour meubles. (.Z?. /.)
SANGLES de chevaux de bâts , ( Bourreliers. ) elles
font étroites, longues, fortes 6c groflieres. Ces /angles
qui s'employant par les Bourreliers , fe vendent
par pièces plus ou- moins longues, fuivant que les
Cordiers qui les ont fabriquées ont jugé à-propos de
les faire , n’y ayant rien de réglé là-deffus ; elles fe
tirent pour l’ordinaire des mêmes endroits que celles
deninées pour les chevaux de felle. Il faut remarquer
que tant que les /angles pour chevaux de bâts
font en pièces , elles s’appellent du tiffu , 6c qu’elles
ne perdent ce nom pour prendre celui de /angks,
que lorfqu’elies font coupées par morceaux de longueur
proportionnée à leur lifage. Savary. {D . J.)
SANGLES de chevaux de /elle , v| Ouvrage de Selliers.
) elles s’employent par les Selliers, 6c font
communément blanches ou grifes, rayées de rouge
6 d e b l e u , o u g r ife s fans r a y e , o u g r ife s r a y é e s de
r o u g e ; le s.une s 6c le s a u t re s o n t u n e au n e m e fu r e de
Paris. (B . J.)
S a n g l e s de Tapi/Jitr, { Tapi/ferie. ) elles font inférieures
en qualité à toutes autres , 6c viennent la
plupart de Châlons en Champagne. Celles qui ont
environ 4 pouces de large 6c qui fervent à fangler
des chailes , des fauteuils , des lophas, des canapés,
des lits, >&c. fe vendent à la groffe ; chaque groffe
eft compofée de douze pièces, 6c la piece contient
7 à 8 aunes de Paris. Il s’en fait quelques-unes plus
étroites de femblable qualité, qui fe vendent de même
; leur principal ufage eft pour attacher aux métiers
des Tapifiiers, Brodeurs , &c. Celles de 20 à
24 lignes de large , qui fervent à border les tentes 6c
les tapifl'eries , qu’on appelle bordures , fe vendent
aufli à la groffe, chaque groffe contient vingt-quatre
pièces de 6 à 7 aunes chacune. Savary. {D. /.)■
S a n g l e , en terme d'Or/évre , c’eft une bande de
cuir ou de petite corde nattée, environ de la largeur
de 4 pouces * au bout de laquelle il y a un anneau
de fer pour recevoir le crochet des tenailles ; on fe
fert aufli quelquefois de corde pour tirer. Elle a même
cet avantage fur la /angle , qu’elle n’augmente
point le diamètre de l’arbre en fe tournant deffus.
Voyei les fig.
S a n g l e , {Rubanier.') e ft u n m o r c e a u de /angle
v é r i ta b lem e n t , a t ta ch é à d em eu r e au c ô t é g a u ch e du
m é t ie r , 6c q u i fe r t à fo u ten ir le s r eins de l ’o u v r ie r 6c
à lu i d o n n e r de la fo r c e p o u r e n fo n c e r le s m a r che s
lo r fq ù ’i l e ft aflis fur le fie g e ; il a t ta ch e l’a u t r e b o u t
te rm in é p a r u n an ne au à l’a u t r e c ô t é d u m é t ie r , ap rès
q u ’il s’ e ft e n to u ré le co rp s a v e c la d ite /angle ; c e t te
/angle , ou t re la fo r c e d o n t o n V ien t de p a r l e r , fe rt
e n c o r e . à l’ o u v r ie r de p o in t d’a p p u i en l'em p ê ch a n t
d e r e c u le r de d effus le fie g e p en d an t lé t r a v a i l , o n
p e u t fe paffe r d e c e t te /angle dans le s o u v r a g e s lé g
e r s .
S a n g l e s , f . f . {Marine. ') o n ap p e lle a in fi d es én-
t re la c em en s de men u e s co rd e s à d e u x f i l s , q u ’ o n
n om m e biflord, q u e l’ o n m e t en d iffé ren s e n d ro its
d u v a i f f e a u , com m e fu r le s c e r c le s des h u n e s , fur
le s p rem ie r s des g rand s haub ans 6c a i lle u r s , p o u r
em p ê c h e r q u e les m a noe u v r e s ne fe co u p en t .
S a n g l e s - b l a n c s , (tComrn,defil.) o n d o n n e c e
SAN
nom à des fortes de fils qui viennent de Hollande ;
ils fervent aux ouvriers en points à picoter leur£ ouvrages,
c’eft-à-dire à faire cette bordure en forme
de petites dents, qu’on appelle des picots, dont on
termine les points faits à l’aiguille, du côté oppofé à
celui de l’engrelure. ( Z>. /. )
S a n g l e s - b l e u s , ( Comm. de ƒ / . ) efpece de fil
teint en bleu, qui fert à faire les linteaux du linge
de table,particulièrement aux ferviettes & aux na-
pes. Ces fils fe fabriquent 6c fe mettent en teinture à
Troye en Champagne, d’oii les tifferands qui travaillent
à cette forte de lingerie, 6c les marchands merciers
de Paris, qui font le commerce des fils, ont
coutume de les tirer. ( D .J . )
SANGLÉ, p a r tic ip e p a f l i f , {Gram.) Voyeç S a n g
l e & S a n g l e r .
S a n g l é , terme de Bla/ony il fe dit du cheval, des
pourceaux, 6c des fangliers qui ont par le milieu du
corps une efpece de ceinture d’un autre émail.
Die Glaubitzer en Siléfie, d’azur au poiffon d’argent
en face,/anglé de gueules.
SANGLER UN CHEVAL, {Maréchal. ) c’eft ferrer
les fangles de la ielle pour qu’elle foit plus ferme
fur fon dos.
S a n g l e r LE f r o m a g e , {Fromagerie.') c’ eft le
ferrer bien fort tout-au-tour avec une l’angle de peau
ou une légère écorce de fapin, pour en conferver
la forme pendant qu’on lui donne le fel. Il ne fe dit
que des fromages de Griers 6c de Berne. :{D . J. )
SANGLIER, f. m. aper, {Hiß. nat. Jclhiolog.) poiffon
de mer couvert d’écailles , 6c dont le corps eft
fort dur, prefque rond 6c applati ; il a une couleur
rougeâtre ; les yeux font grands , le mufeau eft long
6c moufle ; il y a fur le dos des piquans fort pointus,
durs, longs 6c droits ; les premiers font courts ; ceux
du milieu ont le plus de longueur, 6c les derniers
font un peu plus grands que les premiers. Ce poiffon
a deux nageoires aux ouies & deux au ventre; celles-
ci font garnies de forts aiguillonsfil y a aufli au-deffous
de l’anus trois aiguillons courts 6c pointus. Le/anglier
différé principalement du porc , en ce qu’il n’a point
de dents & que fa chair eft bonne à manger; au lieu
que celle du porc a une très-mauvaife odeur 6c qu’elle
eft toujours dure. Rondelet, hifi. nat. despoijjons,
I. part. liv. V. chap. xxvij. Voye\ POISSON.
Sa n g l ie r , aper, {Hiß. nat. Zoolog.) animal quadrupède
de même efpece que le cochon domeftique
6c le cochon de Siam. Quoique ces animaux n’aient à
chaque pié que deux doigts qui touchent la terre, 6c
que ces doigts foient termines par un fabot, ils different
beaucoup des animaux à pie fourchu, non-feulement
par la conformation des jambes 6c des piés,
mais encore en ce qu’ils n’ont point de cornes, qu’ils
ne manquent pas de dents incifives à la mâchoire fu-
périeure, qu’ils ont des dents canines très-longues,
connues fous le nom de dé/en/es 6c de crochets, qu’ils
ne ruminent pas, qu’ils n’ont qu’un eftomac, &c. La
partie du grouin du /anglier 6c des cochons, à laquelle
On donne le nom de boutoir, eft formée par un cartilage
rond qui renferme un petit os. Le boutoir eft
percé par les narines 6c placé au-devant de la mâchoire
fupérieure. Cette partie, qui eft le nez, a beaucoup
de force ; ces animaux s’en fervent pour fouiller
dans la terre. Le /anglier a la tête plus longue, la paiv
tie inférieure du chanfrein plus arquée, 6c les défen-
fes plus grandes 6c plus tranchante^ que les crochets
des autres cochons. Sa queue eft courte 6c droite. Il
eft couvert, comme les cochons, de groffes foies dur
res & pliantes ; mais il a de plus un poil doux 6c
friie, à peu-près comme de la laine ; ce poil eft entre
les foies 6c a une couleur jaunâtre , cendrée, ou noir
râtre fur différentes parties du corps de l’animal, où
à les différens âges. Tant que le /anglier eft dans fon
premier âge, on le nomme rnarcajfin ; alors il a1 des
couleurs
SAN
couleurs qu’il perd dans la fuite, c’eft ce que l’on
appelle la livrée : elle eft marquée fur le foetus dès
qu’il a du poil; elle forme des bandes qui s’étendent
le long dit corps depuis la tête jufqu’à la quelle , 6c
qui font alternativement de couleur de fauve clair
& de couleur mêlée de fauve 6c de brun ; celle qui
fe trouve fur le garot 6c le long du dos eft noirâtre.
Il y a fiir le refte de l’animal un mélange de blanc, de
fauve 6c de brun. Lorfqué le /anglier eft adulte , il 3'
le groin 6c les oreilles noirs, 6c le refte de la tête de
couleur mêlée de blanc, de jaune & de noir dans
quelques endroits. La gorge eft roufsâtre ; les foies
du dos font les plus longues, couchées en-arriere ,
& fi ferrées que l’on ne voit que la couleur brune
roufl'âtre qu’elles ont à la pointe , quoiqu’elles aient
aufli du blanc fale 6c du noir , dans le refte de leur
étendue. Les foies des côtés du corps & du ventre
ont les mêmes couleurs que celles du dos ;.mais comme
elles font moins ferrées , le blanc y paroît avec
Je brun; les foies des aiffelles 6c des.aines font rouf-
sâtres ; celles du ventre 6c de la face intérieure des
cuiffes fönt blanches en entier, à l’exception de la
pointe qui eft rouffe ; la tête 6c le bout de la queue
6c le bas des jambes font noirs.
Quoique les /anglièrs foient fort gourmands , ils
n’attaquent ni ne dévorent pas les loups ; cependant
ils mangent quelquefois de la chair corrompue, mais
c’eft par néceflite. On ne peut nier que les cochons
ne foient avides de fang 6c de chair languinolente 6c
fraîche, puifqu’ils mangent leurs petits 6c même des
enfans au berceau. L e Jdnglier 6c les cochons aiment
beaucoup les vers de terre 6c certaines racines,
comme celles de la carotte fauvage ; c’eft pour trouver
ces vers 6c pour couper ces racines qu'ils fouillent
la terre avec leur boutoir. Le /angliêr , dont la
huré eft plus longue 6c plus forte que celle du cochon,
fouille plus profondément 6c prefque toujours en
ligne droite dans le même fillon; au lieu que le cochon
fouille çà & là 6c plus légèrement. Pendant le
jour le /anglier refte ordinairement dans fa bauge au
plus fort du bois ; il en fort le foir à la nuit pour chercher
fa nourriture : en é té , lorfque les grains font
murs, il fréquente toutes les nuits dans les blés ou
dans les avoines. Il eft rare d’entendre le /anglier jet-
ter un cri, fi ce n’eft lorfqu’il fe bat 6c qu’un autre le
bleffe : la laie crie plus fouvent. Quand ils font fur-
pris 6c effrayés fubitement, ils foufïlent avec tant de
violence, qu’on les entend à une grande diftance.
Dans lé tems du rut, le mâle demeure ordinairement
trente jours avec la femelle dans les bois les
plus fqlitaires ; il eft alors plus farouche que jamais ;
il devient même furieux , lorfqu’un autre vient occuper
la place ; ils fe battent & fe tuent quelquefois. La
laie ne fe met en fureur que lorfqu’on attaque fes petits
; elle ne porte qu’une fois l’an. Elle reçoit le mâle
aux mois de Janvier & de Février , & met bas aux
mois de Mai ou Juin. Elle allaite fes petits pendant
trois ou quatre mois ; elle les conduit jufqu’à ce qu’ils
aient deux ou trois ans. Il n’eft pas rare 'de voir des
laies accompagnées de leurs petits de l’année 6c de
ceux de l’année précédente. La vie du /anglier peut
s etendre jufqu’à vingt-cinq ou trente ans. Il n’y a que
l?i hure qui foit bonne à manger dans un vieux langher;
aii lieu que toute la chair du marcaflin 6c celle
du jeune /anglier qui n’a pas encore un an eft délicate
6c même affez fine. Les anciens étoient dans l’u-
fige de faire la caftration aux marcalïins qu’on pôii-
voit enlever à leur mere. Après quoi-, on les re'por-
toit danè lés bois où ils grofliffoient plus que les au-
tres , & leur chair étoit meilleure que celle des
cochons domeftiques. Hifi. nat. gèn. & partie, tom. V.
Voyci QUADRUPEDE:
S a n g l i e r {ChaJ/e:du) Sa maniéré de vivre 6c fes
inclinations reffemblcnt beaucoup à celles des cô-
Tome X 1K
SAN 619
chons domeftiques. D’ailleurs les /anglièrs s’accouplent,
multiplient avec les pourceaux, 6c le produit
en eft fécond. Mais une vie plus agrefte, la néceflite
de fe défendre fouvent, 6c fur-tout la liberté , donnent
au Janglier des moeurs mieux carattérifées, dans
lefquelles on reconnoît plus diftin&ement les inclinations
de l’efpece.
Ée/anglier èft plutôt frugivore que carnaflier ; cependant
il eft l’un 6c l’autre. Il vit de graines, de racines,
de fruits; mais il fe nourrit aufli volontiers de
chair. Il fouille avec fon boutoir les terriers de lapins
qui ne font pas à une grande profondeur. Il détruit
les rabouilleres, dévore les lapereaux 6c les lévrauts,
lur-tout lorfqu’ils font encore petits. Il évente les
nids de perdrix, &c. mange les oeufs, 6c fouvent réuf-
fit à furprendre la couveufé.
On donne différens noms aux /anglièrs, en raifon
de leur âge. Les femelles font‘toujours appellées laies;
elles entrent en rut dans le mois de D écembre, portent
pendant quatre mois 6c quelques jours, 6c mettent
bas depuis trois jufqu’à huit ou neuf petits : ces
petits portent jufqu’à fix mois le nom de marca/finsh
6c depuis cet âge jufqu’à deux ans, celui de bêtes
roujfes 6c de bêtes de compagnie. On donne le nom de
ragot aux mâles entre deux' 6c trois ans ; après cela 1
ils font appellés Jangliers'à leur tiersHin, puis à leur
quart-an ; après quoi on ne les connoît plus que fous
le nom de grands vieux Jangliers. C’eft depuis trois
jufqu’à cinq ans que les /anglièrs font le plus à craindre
, parce qu’alôrs leurs défenfes font extrêmement
tranchantes. Après cela, ils deviennent mirés\ c’eft-
à-dire que leurs défenfes fe courbent 6c font moins
incifives : mais la force 6c la hardieflè dés vieux /an-
gliers les rendent toujours fort redoutables.
Les/anglièrs, lorfqu’ils ont atteint trois ans , ne
vivent plus en compagnie ; ils font alors pourvus
d’armes qui les raffurent ; la fécurité les mene à la
foiitude ; ils vont feuls chercher leurs mangeùres, fe
raffraichir au foiullard fc’eft-à-dire fe vçautrer dans
la boue) & fe mettre a la bauge ; ils y dorment une
partie du-jour ; 6c vu la Confiance qu’ils ont en leurs
forces, il arrive fouvent qu’on ne les en fait fortir
qu’avec beaucoup dé peine. Ce n’eft que dans le tems
du rut que la néceflité de chercher des femelles remet
ces mâles en compagnie. Quant aux laies, elles vivent
toujours en fociété ; elles s’attroupent plufieurs
enfemble avec leurs marcaflins 6c les jeunes mâles
dont les défenfes ne font pas encore au point de leur
rendre l’affociation inutile. Tous les fangliers qui
compofenuces troupes ont l’efprit de la défenfe commune.
Non-feulement les laiés chargent âv'éè fureur
les hommes 6c les chiens qui attaquent leurs marcaflins
; mais encore les jeunes mâlés s’animent au
combat, la troupe fe range en cercle, 6c préfente
par-tout un front hérifle de boutoirs. '
Les /anglièrs ne font point, comme les cerfs , les
daims, les chevreuils , habitans prefque fédentaires
des pays oii ils font nés. Ils voyagent fouvent, pour
aller, chercher des forêts où les vivres foient plus
âbondans ; ces émigrations fe font ordinairement en
automne, lorfque le gland ou la châtaigne comment-
cent à tomber; 6c on cherche alors avec raifon .à fe.
défaire de ces nouveaux hôtes. Le /anglier eft très-
propre à faire un objet de chaffe, parce que, fur-tout
loiîqu’il eft jeune, la chair en eft .bonne à manger -
6c que d’ailleurs cet animal eft fort à redourer pour1
l:es récoltes. Tous les .chiens le chaffent avec beaucoup
d’ardeur, 6c fouvent cette ardeur leur eft fu-;
nefte. -he/anglier, lorfqu’il eft chafle, & que là. fuite
cpnirnence’à lui devenir pénible, va chercher d’épais
haillers où il s’arrête. Alors malheur aux chiens trop»
hardis qui veulent l’aborder; l’animal furieux fe précipite
fur tout ce qui fe trouve' devant lui. Il faut donc
S’attendre à perdre beaucoup de chiens , lorfquïôn