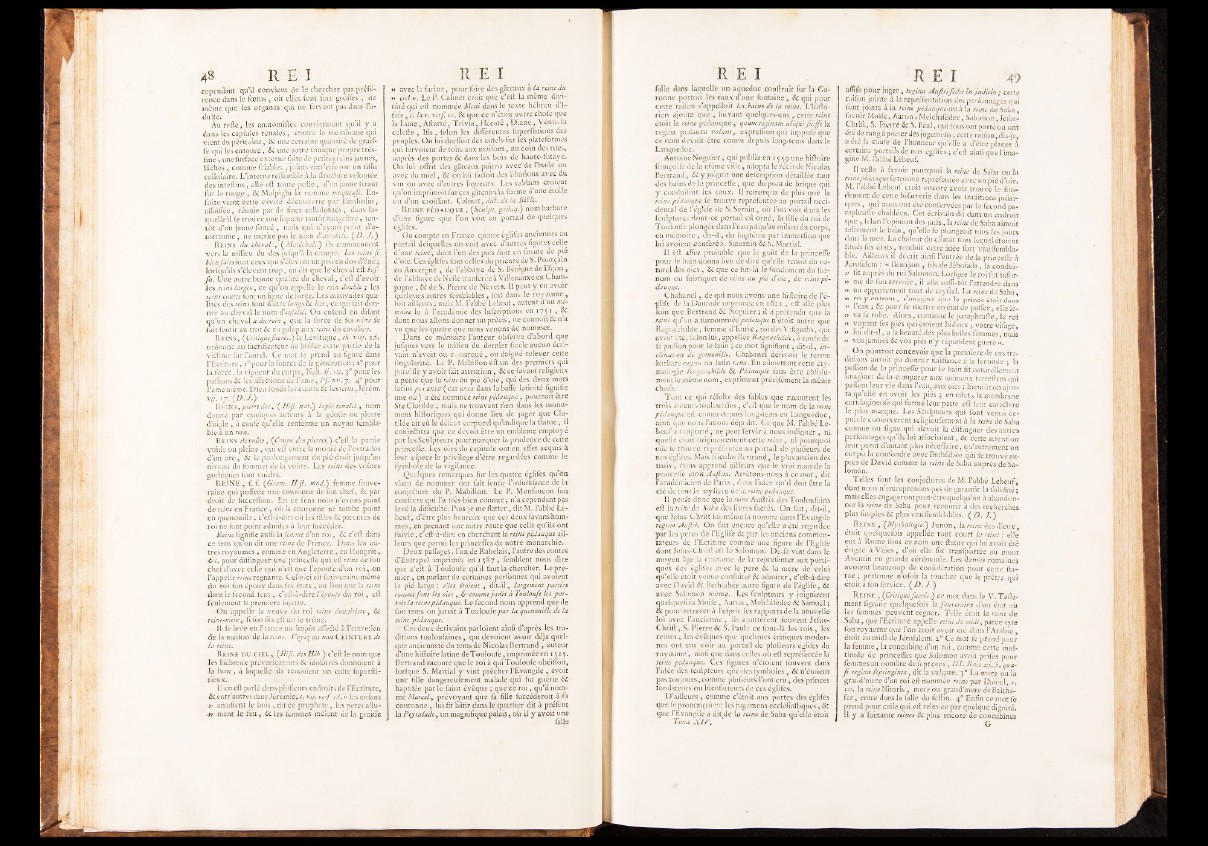
cependant qu’il convient de le chercher par préférence
dans le foetus , oh elles font fort groffes , de
même que les organes qui ne fervent pas dans l’adulte.
Au refte, les anatomiftes conviennent qu’il y a
dans les capfules rénales , contre la membiane qui
vient du péritoine, & une certaine quantité de graif-
fe qui les entoure, 8c une autre tunique propre très-
fine , unefurface externe faite de petits grains jaunes,
lâches, comme friables , joints entr’eux par un tiffu
cellulaire. L’interne reflemble à la ftruêture veloutée
des inteftins, elle eût toute polie , d’un jaune tirant
fur le rouge , 8c Malpighi la nomme muqueufe. En-
fuite vient cette cavité découverte par Bartholin,
affaiffée, réunie par de fines cellulofités , dans la-
ouelleil fe trouve une liqueur tantôt rougeâtre, tantôt
d’un jaune foncé , mais qui n’ayant point d’amertume,
ne mérite pas le nom à'atrabile. (D . /. )
- Reins du cheval , ( Maréchal. ) ils commencent
vers le milieu du dos jufqu’à la croupe. Les reins f i
bien faitsCont Ceux qui s’élèvent un peu en dos d’âne.;
lorfqu’ils s’élèvent trop, on dit que le cheval eft bofi
fiu. Une autre bonne qualité du cheval, c’eft d’avoir
les reins larges, ce qu’on appelle le rein double ; les
■ reins courts font un figne deforce. Les mauvaifes qualités
des reins font d’être longs & bas, ce qui fait donner
au cheval le nom àéejifcllé. On entend en difant
qu’un cheval a du rein , que la force de fes reins fe
-fait fentir au trot & au galop aux reins du cavalier.
Reins , (Critiquefacrée.) le Lévitique, ch. viij. 2 J.
ordonne au facrificateur de brûler cette partie de la
viftime fur l’autel. Ce root fe prend au figuré dans
l’Ecriture, i°pour la fource de la génération ; i°pour
la force, la vigueur du corps, Nah. ij. 10 .f i pour les
pallions & les affeêüons de l’ame, Pf. xv. y. f i pour
Tarne même. Dieu fonde les;coeurs Itsreins, Jérém.
Re I NS, pierre des,. ( Hifi. nat.) lapis renalis , nom
donné par quelques auteurs à la géode ou pierre
-d’aigle , à caufe qu’elle renferme un noyau'fembla-
ble à un rein.
R eins de voûte, (Coupe des pierres.fic’eû. la partie
-vuide ou pleine, qui eft entre la moitié de l’extrados
d’un arc , & le prolongement du pié droit jufqu’au
niveau du fommet de la voûte-. Les reins des. voûtes
gothiques font vuides.
REINE, f. f. (Gram. H f i. mod.') femme fouve-
-raine qui poffede une couronne de fon chef, & par
droit de fucceffion. En ce fens nous n’avons point
de reine en France, oii la couronne ne tombe point
en quenouille, c’eil-à-dire où les filles & parentes de
roi ne font point admifes à leur fuccéder.
Reine lignifie aulïi la femme d’un ro i, & c’efl dans
ce fens qu’on dit une reine de France. Dans les autres
royaumes , comme en.Angleterre , en Hongrie,
&c. pour diliinguer une princelfe qui eft reine de fon
chef d’avec celle qui n’eft que l’epoufe d’un roi, on
l’appelle reine régnante. Celle-ci eft fouveraine même
du roi fon époux dans fes états , au lieu que la reine
dans le fécond fens , c’eft-à-dire l'éfouje du ro i, eft
feulement fa première fujette.
On appelle.la veuve du roi reine douairière, &
reine-mere, fi fon fils eft fur le trône.
fe leve en France un impôt aftéêïé à l’entretien
de la maifon de la reine. Voye{ au mot C einture de
la reine.
. Reine du c ie l , {Hiß. desHéb.) c’eft lenom que
les Hébreux prévaricateurs & idolâtres donnoient à
la lune, à laquelle ils rendôient un Culte fiiperfti-
, ;tieux.
Il en eft parlé dans plufieurs endroits de l’Ecriture,
&entr’autres dâns Jérémie, c. vij. verf 18. « les enfans
» amaflent le bois , dit ce; prophète., les peresallument
le feu , 6cles femmes mêlent delà grailfe
» avec la farine, pour faire des gâteaux à la reine du
» ciel ». Le P. Calmet croit que c’efl: la même divinité
qui eft nommée Meni dans le texte hébreu d’I-
faie, c. Ixv. verfi 11. & que ce n’ étoit autre chofe que
la Lune, Aftarté, Trivia, Hécaté , Diane , Vénus la
célefte , Ifis , félon les différentes fuperftitions des
peuples. On lui dreffoit des autels fur les plateformes
qui fervoient de toits aux maifons, au coin des rues,
auprès des portes & dans les bois de haute-futaye.
On lui offrit des gâteaux paîtris avec de l’huile ou
avec du m iel, & on lui faifoit des libations avec du
vin ou avec d’autres liqueurs. Les rabbins croient
qu’on imprimoitfurces gâteaux la forme d’une etoile
ou d’un croiffant.. Calmet, dicl. de la Bible.
Reine pédàuque , (Sculpt. gothiq.') nom barbare
d’une figure que l’on voit au portail de quelques
églifes, ;
On compte en France quatre églifes anciennes au
portail defquelles on voit avec d’autres figures celle
d’une reine, dont l’un des pies finit en forme de pie
d’oie. Ces églifes font celles du prieuré de S. Pourçain
en Auvergne , de l ’abbaye de S. Bénigne de Dijon,
de l’abbaye deNefle tranférée à Villenauxe en Champagne
, 6c de S. Pierre de Nevers. Il peut y en avoir
quelques autres femblables, foit dans le royaume ,
foit ailleurs ; mais M. l’abbé Lebeuf, auteur d’un mémoire
lu à l’académie des Infcriptions en 1 7 5 1 ,6 C
dont nous allons donner un précis, ne connoitôcn’a
vu que les quatre que nous venons de nommer.
Dans ce mémoire l’auteur obferve d’abord que
jufques vers le milieu du dernier fiecle aucun écrivain
n’avoit ou remarqué, ou daigné relever cette
fingularité. Le P. Mabilloii eft un des premiers qui
paroiffe y avoir fait attention, 6c ce favant religieux
a penfé que la reine au pié d’oie, qui des deux mots
latins pes ancce (car anca dans la baffe latinité fignifie
une oie') a été nommée reine pédàuque, pourroit être
Ste Clotilde ; mais ne trouvant rien dans les monu-
mens hiftoriques qui donne lieu de juger que Clôs
tilde ait eû le défaut corporel qu’indique la ftatue, il
conjeôura que ce devoitêtre un emblème employé
par les Sculpteurs pour marquer la prudence de cette
princeffe. Les oies du capitole ont en effet acquis à
leur efpece le privilège d’être regardées comme le
fymbole de la vigilance.
Quelques remarques fur les quatre églifes qufon
vient de nommer ont fait fentir l’infufhfance de la ’
conjecture du P. Mabillon. Le P: Monfaucon fon
confrère qui Ta très-bien connue, n’a cependant pas
levé la difficulté. Puis-je me flatter, ditM. l’abbé Lebeuf,
d’être plus heureux que ces deux favanshommes
, en prenant une autre route que celle qu’ils ont
fuivie, c’ eft-à-dire en cherchant la reine pédàuque ailleurs
que parmi les princeffes de notre monarchie.
Deux paffages, l’un de Rabelais, l’autre des contes
d’Eutrapel imprimés en 1587', femblent nous dire
que c’eft à Touloufe qu’il faut la chercher. Le premier
, en parlant de certaines perfonnes qui avoient
le pié large : elles étoient , dit-il, largement pattées
comme font les oies , & comme jadis à Touloufe les por-
toit la reine pédàuque. Le fécond nous apprend que de
fon tems on juroit à Touloufe par la quenouille de la.
reine pédàuque.
Ces deux écrivains parloient ainfi d’après les traditions
touloufaines, qui dévoient avoir déjà quelque
ancienneté du tems de Nicolas Bertrand , auteur
d’une hiftoire latine de Touloufe, imprimée en 1515.
Bertrand raconte que le roi à quiTouloufe obéiffoit,
lorfque S. Martial y vint prêcher l’Evangile , avoit
une fille dangereulement malade qui fut guérie 6c
baptifée par le faint évêqüe ; que ce ro i, qu’il nomme
Mar ce f prévoyant que fa fille fuccéderoit à fa
couronne , lui fit bâtir dans le quartier dit à préfent
la Peyralade, un magnifique palais, oîi il y avoit une
falle dans laquelle un aqueduc conftruit fur la Garonne
portoit lès eaux d’une fontaine, 6c qui pour
cette raifon s’appelloit les bains de La reine. L’hifto-
rien ajoute que , fuivant quelques-uns , cette reine
étoit la reine pédàuque , quant reginam aliqui füiffe la
regina pedauca volunt, expreffion qui fuppofe que
ce nom devoir être connu depuis long-tems dans le
Languedoc.
Antoine Noguier, qui publia en 1 $ 59 une hiftoire
françoife de la nfênie v ille, adopta le récit de Nicolas
Bertrand, 6c y joignit une defeription détaillée tant
des bains de la princeffe, que du pont de brique qui
y conduifoit les eaux. Il remarqua de plus que la
reine pédàuque fe trouve repréfentée au portail occidental
de Téglife de S. Sernin, oii Ton voit dans les
fculptures dont ce portail eft orné, la fille du roi de
Touloufe plongée dans l’eau jufqu’au milieu du corps,
en mémoire, dit-il, du baptême par immerfion que
lui avoient conférés. Saturnin 6c S. Martial, - '
Il eft affez probable que le goût de la princeffe
pour le bain donna lieu de dire qu’elle tenoit du naturel
des oies , 6c que ce fut-là le fondement du fur-
nom ou fobriquet de reine au pié d'oie, de reine pé-
dauque.
. Chabanel, de qui nous avons une hiftoire de l’é-
■ glife de la Daurade imprimée en i 6z i , eft allé plus
loin que Bertrand 6c Noguier ; il a prétendu que la
reine qu’on a furnommée pédàuque n’étoit autre que
Ragnachilde, femme d’Euric,roidesVifigoths, qui
avoit clé, félon lui, appellée Ragnachilde, à caufe de
fa pailion pour le bain ; ce mot lignifiant, dit-il, inclination
de grenouille. Chabanel dérivoit le terme
barbare ragria du latin rana. En admettant cette étymologie
Ragnachilde ÔC Pédauqtle fans être abfolu-
ment le même nom, expriment précifément la même
chofe.
Tout ce qui réfuite des fables que racontent les
trois auteurs touloufains, c’eft que le nom de la reine
pédàuque eft connu depuis long-tems en Languedoc,
ainfi que nous TaVons déjà dit. Ce que M. l’abbé Lebeuf
a rapporté, ne peut fervir à nous indiquer , ni
quelle étoit originairement cette reine , ni pourquoi-
elle fe trouve repréfentée au portail de plufieurs de
nos églifes. Mais Nicolas Bertrand, le plus ancien des
trois , nous apprend ailleurs que le vrai nom de la
princeffe étoit Aufiris. Arrêtons-nous à ce mot dit
l’académicien de Paris , dans l’idée qu’il doit être la
clé de tout le myftere de la ,reine pédàuque.
Il penfe donc que la reine Auftris des Touloufains
eft la reine de Saba des livres facrés. On fait, dit-il,
que Jelus-Chrift lui-même la nomme.dans l’Evangile
regina Aufiri. On fait encore qu’elle a été regardée
par les peres de TEglife 6c par les anciens Commentateurs
de l’Ecriture comme une figure de TEglife
dont Jefus-Chûft eft le Salomon. De-là vint dans le
moyen âge la coutume de la repréfenter aux portiques
des églifes avec le pere 6c la mere de-celui
qu’elle étoit venue confulter 6c admirer, c’eft-à-dire
avec David 6c Bethfabée autre figure de Téglife, 6c
avec Salomon meme. Les fculpteurs y joignirent
quelquefois Moife, Aaron, Melchifedec 6c Samuel ;
oc pour retracer à l’efprit les rapports de la nouvelle
loi avec l’ancienne, ils ajoutèrent fouvent Jefus-
Chrift, S. Pierre 6c S. Paul : ce font-là les rois , les
reines , les évêques que quelques critiques modernes
ont cru voir au portail de plufieurs églifes du
royaume, ainfi que dans celles oh eft repréfentée la
reine pédàuque. Ces figures n’étoient fouvent dans
l’idée des fculpteurs que des fymbolès , ôc n’étoient
pas toujours,comme plufieurs l’ont cru, des princes
fondateurs ou bienfaiteurs de ces églifes.-
D ’ailleurs, comme c’étoit aux portes dès églifes
que fe prononçoient les jugemens eccléfiaftiques, 6c
que l’Evangile a ditde la reine de Saba qu’elle étoit
Tome X IV .
affife {iate juger, ngina AufitlfttUi m judiào ; eetw
raifon jointe à la rcpréfëntation des perfonnages qui
font joints à la reine pédauqüe ou à la reine de Saba,
Lavoir Moife, Aaron, Melchifedec, Salomon, Jefus-
Chrift, S. Pierre 6c S. Paul, qui tous ont porté ou ont
été de rang à porter des jtigemefis ; cette raifon, dis-je,
a été la caufe de l’honnéur qu’elle a d’être placée à
certains portails de nos .églifes ;.e’eft ainfi que l'ima-
gilie M. l’abbé Lebeuf.
Il refte à favoir pourquoi la reine de Saba ou la
reine pédàuque fe trouve repréfentée avec un pié d’oie*
M. l’abbé Lebeuf croit encore avoir trouvé le fondement
de cette bifarrerie dans les traditions judaïques
, qui nous ont été cqnfervées par le fécond pa-
raphrafte chaldéen. Cet écrivain dit dans un endroit
que , félon l’opinion de.s juifs, la reine de Saba aimoit
tellement le bain, qu’elle fe plongeoit tous les jours
dans la mer. La chaleur du climat fous lequel étoient
fitués fes états , rendoit cette idée fort vraiffembla-
b le* Ailleuis il deciit ainfi l’entree de la princeffe à
Jérufalem : « Benajam , fils de Jéhoïada, la condui-
» fit auprès du roi Salomon. Lorfque lé roi fut infor-
» mé de fon arrivée, il alla aufli-tôt l’attendre dans
» un appartement tout de cryftal. La reine de Saba
» en y entrant, s’imagina que le prince étoit dans
» l’eau ; 6c pour fe mettre en état de paffer, elle le-
» va fa robe. Alors ^continue le paraphrafte, le roi
» voyant fes pies qui étoient hideux , votre vifage
» lui dit-il, a la beauté des plus belles femmes, mais
» vos jambes 8c vos piés n’y répondent guère ».
On pourroit concevoir que la première de ces traditions
auroit pu donner naiffance à la fécondé ; la
paflxon de la princeffe pour le bain fit naturellement
imaginer de la comparer aux animaux terreftres qiii
paffent leur vie dans l’eau, aux oies ; bientôt on ajouta
qu’elle en avoit lés piés en effet, la membrane
cartilagineufe qui forme leur patte eft leur caraérere
le plus marqué. Les Sculpteurs qui font venus depuis
le conferverent religieufement à la reine de Saba
comme un figne qui devoit la diftinguer des autres
perfonnages qu’ils lui affocioient, 6c cette attention
leur parut d’autant plus néceflàire, qu’autrement on
eut pu la confondre avec Bethfabée qui fe trouve auprès
de David comme la reine de Saba auprès de Salomon*
Telles font les Conjeàures de M. Tâbbé Lebeuf ,'
dont nous n’entreprenons pas de garantir la folidité ;
mais elles engageront peut-être quelqu’un à abandonner
la reine de Saba pour recourir à des recherches
plus fimples 6c plus vraiffemblabiés. (D . J .)
R e in e , (Mythologie.) Junon, la reine desdieux,
étoit quelquefois appellée tout court la reine : elle
eut à Rome fous ce nom une ftatue qui lui avoit été
erigée^ à Véïes , d’oîi elle fut tranfportée au mont
Aventin en grande cérémonie. Les dames romaines
avoient beaucoup de confidération pour cette ftatue
; perfônne n’ofoit la toucher que le prêtre qui
étoit à fon fervice. {D . J.)
R eine , (Critique facrée.) ce mot dans le V* Tefta-
inent fignifie quelquefois la fouveraine d’un état où
les femmes peuvent régner. Telle étoit la reine de
Saba, que l’Ecriture appelle reine du midi, parce que
fon royaume que Ton croit avoir été dans l’Arabie -
étoit au midi de Jérufalem. i ° Ce mot fe pfend pour
la femme, la concubine d’un ro i, comme cette multitude
de princeffes que Salomon avoit prifes pour
femmes au nombre de fept cens, III. Rois x j. 5< qua-
f i regiriæ feptinginta, dit la vulgate. f i La mere 911 la
grand’mere d’un roi eft nommée reine par Daniel, y.
10. la reine Nitoris, mere ou grand’mere deBaltha-
fa r , entra dans la falle du feftin. f i Enfin ce mot fe
prend pour celle qui eft relevée par quelque dignité.
Il y a foixante reines 6c plus encore de concubines
G