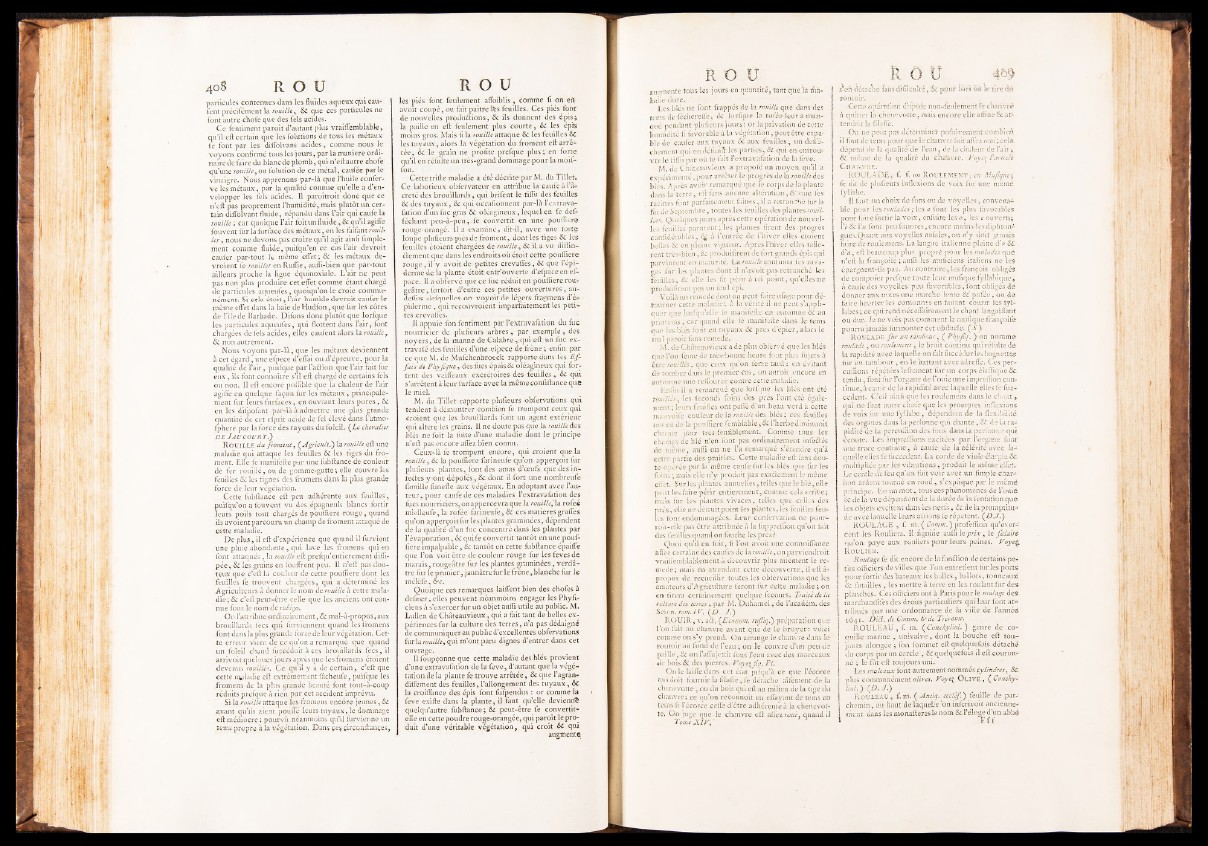
particules contenues dans les fluides aqueux qui caillent
précifément la rouille, 6c que ces particules ne
font autre choie que des lels acides.
Ge fentiment paroît d’autant plus vraiffemblable,
qu’il eft certain que les (blutions de tous les métaux
le font par les dilîolvans acides, comme nous le.
voyons confirmé tous les jours, par la maniéré ordinaire
de faire du blanc de plomb, qui n’ellautre ehofe
qu’une rouille., ou folution de ce métal, caufée par le
vinaigre. Nous apprenons par-là que l’huile confer-
ve les métaux, par la qualité connue qu’elle a d’envelopper
les fels acides. • Il paroitroit donc que ce
n’ell pas proprement l’humidité, mais plutôt un. certain
diffolvant fluide, répandu dans l’air qui caufe la
rouille ; car quoique l’air foit un fluide ; & qu’il agiffe
fouvent fur la furface.des métaux, en les faifant rouiller,
nous ne devons pas croire qu’il agit ainfi Amplement
comme fluide, puifqu’en ce cas l’air devroit
caufer par-tout le même effet ; & les métaux de-
vroient fe rouiller en Ruflie, aufîi-bien que par-tout
ailleurs proche la ligne équinoxiale. L ’air ne peut
pas non plus produire cet effet comme étant chargé
de particules aqueufes, quoiqu’on le croie cpmmu-
nément. Si cela étoit, l’air humide devroit caufer le
même effet dans la baie de Hudfon, que fur les côtes
de file de Barbade. Difons donc plutôt que lorfque
les particules aqueufes, qui flottent dans l’air, font
chargées de fels acides, elles caufent alors la rouille,
6c non autrement.
Nous voyons par-là, que les métaux deviennent
à cet égard, une efpece d’effai ou .d’épreuve, pour la
qualité de l’air, pùif'que par l’a&ion que l’air fait fur
eu x, ils font connoitre s’il eft chargé de certains fels
ou non. Il eft encore poflible que la chaleur de l’air
agiffe en quelque façon fur les métaux, principalement
fur leurs furfaces-, en ouvrant leurs pores, 6c
en les difpofant par-là à admettre une plus grande
quantité de cet efprit acide de fel éleyé dans l’atmo-
fphere par la force des rayons du foleil. (JLe chevalier
D E J A V CO U R T .)
R ouille du froment, (Agricult.) la rouille eft une
maladie qui attaque les feuilles & les tiges du froment.
Elle fe manifêfte par une fubftance de couleur
de fer rouillé, ou de gommergutte ; elle couvre les
feuilles 6c les tignes des fromens dans la plus grande
force de leur végétation.
Cette fubftance eft peu adhérente aux feuilles,
puifqu’on a fouvent vu des épagneuls blancs fortir
leurs poils tout chargés de pouffiere rouge, quand
ils avoient parcouru un champ de froment attaqué de
cette maladie.
De plus, il eft d’expérience que quand il furvient
une pluie abondante, qui 'lave les fromens qui en
font attaqués , la rouille eft prefqu’entierement difli-
pée, & les grains en fouffrent peu. Il n’eft pas douteux
que c’eft la couleur de cette pouffiere dont les
feuilles fe trouvent chargées, qui a déterminé les
Agriculteurs à donner le nom dérouillé à cette maladie
; & c’eft peut-être celle que les anciens ont connue
fous le nom de rubigo.
On l’attribue ordinairement, 6c mal-à-propos, aux
brouillards fecs qui furviennent quand les fromens
font dans la plus grande force de leur végétation. Cette
erreur vient de ce qu’on a remarqué que quand
un foleil chaud fuccédoit à ces brouillards fecs, il
arrivoit quelques jours après que les fromens étoient
devenus rouilles. Ce qu’il y a de certain, .c’eft que
cette îïfciladie eft extrêmement fâcheufe, puifque les
fromens de la plus grande beauté font tout-à-coup
réduits prefque à rien par cet accident imprévu.
Si la rouille attaque les fromens encore jeunes, 6c
avant qu’ils aient pouffé leurs tuyaux, le dommage
eft médiocre ; pourvu néanmoins qu’il furvienne un
tems propre à la végétation. Dans çe$ çirconftances,
les piés font feulement affoiblis , comme fi orç eft
avoit coupé, ou fait paitre lfes feuilles. Ces piés font
de nouvelles productions, 6c ils donnent des épis;
la paille en eft feulement plus courte, 6c les épis
moins gros. Mais fi la rouille attaque 6c les feuilles 6c
les tuyaux, alors la végétation du froment eft arrêtée
, 6c le grain ne profite prefque plus ; en forte
qu’il en réfulte un très-grand dommage pour la moif-
fon.C
ette trifte maladie à été décrite par M. du Tillet«
Ce laborieux obfervateur en: attribue la.caufe à PS*
crêté des brouillards, qui brifent le tiffu des feuilles
6t des tuyaux, &c qui oceafionnent par-là l’extrava*
fation d’un fuc gras 6c oléagineux, lequel en fe def-
féchant peu-à-peu.,.fe convertit en une pouffiere
rouge-orangé. Il a examiné, dit-il, avec une forte
loupe plufieurs piés de froment, dont les tiges 6c les
feuilles étoient chargées de rouille, & il a vu diftim-
élément que dans.Ies endroits où étoit cette pouffiere
rouge j il y avoit de. petites crevaffes, & que l’épiderme
de la plante étoit entr’ouverte d’efpace en ef-
paee. Il a obfervé que ce fuc réduit en: pouffiere roiir
geâtre, fortoit d’entre ces petites ouvertures, au-
deffus rdefquelles on voyoit de légers fragmens d’ér
piderme, qui recouvraient imparfaitement les peti*
tes crevaffes.
Il appuie fon fentiment par l’extravafation du fuc
nourricier de plufièurs .arbres.y par exemple, des
noyers, de la manne de Calabre ,; qui eft un fuc ex-
travafé:des feuilles-d’une, efpece de frêne; enfin par
ce que M. de Mufcheribroeck rapporte dans les Ef-
Jiiis de. Pkyjique, des fixes épais & oléagineux qui for-
tent des vaifleaux excrétoires des feuilles, 6c qui
s’arrêtent à leur l'urface avec la même confiftance que
; le miel.
M. du Tillet rapporte plufieurs obfervations qui
tendent à démontrer combien fe trompent ceux qui
croient que les brouillards font un agent extérieur
qui altéré les grains.. Il ne doute pas que la rouille des
blés ne foit la fuite d’une maladie dont le principe
n’eft pas encore affez bien connu. '
Ceux-là fe trompent encore, qui croient que la
rouille., 6c la pouffiere farineufe qu’on apperçoit fur
plufieurs plantes, font des amas d’oeufs que des in-
îèétes y sont dépôfés, 6c dont il fort une nombreufe
famille fimefte aux végétaux. En adoptant avec l’auteur,
pour caufe de ces maladies l’extravafation des
fucs nourriciers, on appercevra que la rouille' , r o f e é
mielleufe, la rofée farineufe, 6c ces matières graffes
qu’on apperçoit fur les plantes graminées, dépendent
de la qualité d’un fuc concentré dans les plantes par
l'évaporation, & quife convertit tantôt en une pouffiere
impalpable, 6c tantôt en cette fubftance épaifle
que l’on voit être de couleur rouge fur les feves de
marais, rougeâtre fur les plantes graminées, verdâtre
fur le prunier, jaunâtre fur le frene, blanche fur le
mélèfe, &c.
Quoique ces remarques laiffent bien des chofes à
defirer, elles peuvent néanmoins engager les Phyfi-
ciens à s’exercer fur un objet aufli utile au public. M.
Lullen de Châteauvieux, qui a fait tant de belles expériences
fur la culture des terres, n’a pas dédaigné
de communiquer au public d’excellentes obfervations
fur la rouille, qui m’ont paru dignes d’entrer dans cet
ouvrage.
Il foupçonne que cette maladie des blés provient
d’une extravafation de la feve, d’autant que la végétation
de la plante fe trouve arrêtée, 6c que l’agran-
diflement des feuilles,l’allongement des tuyaux, 6c
la croiflance des épis font fufpendus : or comme la
feve exifte dans la plante, il faut qu’elle devienne
qiielqu’autre fubftance; 6c peut-être fe convertit-
elle en cette poudre rouge-orangée, qui paroît le produit
d’une véritable végétation, qui croît 6c qui
augmente;
augmente tous les jours en quantité, tant que là maladie
dure. '■ • ' .
Les blés ne font frappés de la rouille que dans deS
tems de féchereffe, 6c lorfque la rofée leur a man-
aué. pendant plufieurs jours-: or la privation de cette
humidité fi favorable à la végétation, peut être capa5-
ble de caufer aux tuyaux 6c aux feuilles, un delfé-
chement qui en défunft les parties, 6c qui en entrouvre
le tiffu par où fe fait l’extravafation de la feve.
M. de Châteauvieux a propofé un moyen qu’il a
exnérimenté, pour arrêter le progrès de la rouille des;,. ]
blés. Après avoir remarqué que le corps de la plante
dans la terre y eft fans aucune altération ,& que fes
1-acines font parfaitement faines, il a retranché fur la
fin de Septembre, toutes les fepilles des plantes rouil-
lées. Quelques jours après cette opération de nouvelles
feuilles parurent; les plantes firent des progrès
confidérables, & à l’entrée de l’hiver elles étoient
belles 6c en pleine vigueur. Après l’hiver elles talle-
rent très*-bien, 6c produifirent de fort grands épis qui
parvinrent en maturité. La rouille continua fes ravages
fur. les plantes dont il n’avoit pas retranché les
feuilles , 6c elle les fit périr à tel point, qu’elles ne
produifirent pas un feul epi.
Voilà un remede dont on peut faire ufage pour détourner
cette, maladie; à la vérité il ne peut s’appliquer
que lorfqu’elle fe manifefte en automne & ail
prinrems , car quand elle fe manifefte dans le tems
que les blés font en tuyaux 6c près d’épier, alors le
mal paroit fans remede.
M. de Châteauvieux a de plus obfervé que les blés
que l’on feme de très-bonne heure font plus fujets à
être fouillés, que ceux qu’on feme tard : en évitant
de tomber dans le premier cas, on auroit encore en
automne une reffource contre cette maladie;
Enfin il a temaraué que lorfque les blés ont été
touillés, les féconds foins des près l’ont été également
; leurs feuilles ont paffé d’un beau verd à cette
mauvaife couleur de la rouille des blés ; ces feuilles
ont eu de la pouffiere femblable, 6c l’herbe diminuoit
chaque jour très-fenfiblement.. Comme tous- les
champs de blé n’en font pas ordinairement infeftés
de même, aufli on ne l’a remarqué-s’étendre qu’à
cette partie des prairies. Cette maladie eft fans doute
opérée par la même caufe fur les blés que fur les
foins ; mais elle n’y produit pas exaélement le même
effet. Sur les plantes annuelles, telles que le blé, elle '
peut les faire périr entièrement, comme cela arrive;
mais fur les plantes vivaces, telles que celles des
prés, elle ne détruit point les plantes, les feuilles feules
font endommagées. Leur confervation ne pour-
roit-elle pas être attribuée à la fupprefîion qu’on fait
des feuilles quand on fauche les prés ?
Quoi qu’il en foit, fi l’on avoit une eonnoiffance
affez certaine des caufes de la rouille,on parviendroit
vraiffemblablenient à découvrir, plus aifément le remede;
mais en attendant cette découverte, il eft à-
propos de recueillir toutes les obfervations que les
amateurs d’Agriculture feront fur cette maladie; on
en tirera certainement quelque fecours. Traité de la
culture des terres > par M. Duhamel, de l’académ. des
Scien '.tom.LV. (JD. /.)
ROUIR, v. aél. (Econom. rujîiq.) préparation que
l ’on fait au chanvre avant que de le broyer: voici
comme on s’y prend. On arrange le chanvre dans le
foutoir au fond de l’eau ; on le couvre d’un peu de
paille, & onfaffujettit fous l’eau avec des morceaux
de bois 6c des pierres. Voye^fig. PL
On le laiffe dans cet état jufqu’à. ce que l’écorce
qui doit fournir la filaffe, fe détache aifément de la
chenevotte, ou du bois qui eft au milieu de la tige du
chanvre; ce qu’on reconnoit en effayant de tems en
tems fi l’écorce ceftê d’être adhérente à la chenevot--
te. On juge que le chanvre eft affez roui, quand il
Tome X Iy , *
sVi'l détaché fahs difficulté, '6c pour lors ôn lé tire dût
rouioir.
Cette opération difpofè non-feuléméht le chanvre
à quitter la chenevotte, mais enebre elle affine 6c at£
tendrit la filaffe.
. On ne peut pas détèrmine'f- pofitiveifl'eht cômbierk
il faut de tems pour que le chanvrefoit affez roui-, celà
dépend de la qualité de l’eau, de la chaleur de l’air y
6c même de la qualité du chaîivre. Voye\ Ü article
C hanvre.
ROULADE; f. A. ou Roulement; in Mu f que;
fe dit de plufieurs inflexions de. voix fur une mêmé
fyllabe.
Il faut-un choix de fons ou de voyelles, convenable
pour les roulades ; les a font les plus favorables
pour faire fortir la voix, enfuir.e les 0, les e ouverts;
l’i 6c Vu font peu fonores, encore moins les diphtongues.
Quant aux voyelles nafales,on n’y doit jamais
faire de roulemens; La langue italienne pleine d’o 6s ■
dV, eft beaucoup plus propre pour les roulades qué
n’eft la françoife ; aufli les nnificiens italiens ne leâ
épargnent-ils pas. Au contraire, les françois obligés
de compoler prefque toute leur mufique fyllabique;
à caufe des voyelles peu favorables, font obliges dë
donner aux notes une marche lente 6c pofée , ’bu dô
faire heurter les confonnss en faifant courir les fyl-
labes ; ce qui rend néceffairement le chant languiffant
ou dur. Je ne vois pas comment la nnifique françoifë
pourra jamais furmonter cet obftacle. (b1)
ROULADE fur un tambour, ( Phyfiq. ) on nommé
roulade , ou roulement, le bruit continu qui réfulte dé
la rapidité avec laquelle on faitfuccéder les baguettes
fur un tambour , en le battant avec adreffe. Ces per-
euflions réoétées leftement fur un corps élaftique 6s
tendu, font fur l’organe de l’ouie une impreffion continue,
à caufe de la rapidité avec laquelle elles"fe fuc-
cedent. C’eft ainfi que les roulemens dans le chant y
qui ne font autre chofe que les promptes inflexions
de voix fur une fyllabe, dépendent de la flexibilité
des organes dans la.perfonne qui chante, 6c de la rapidité
de la pereuffion des fons dans la perfonne qui
écoute. Les impreflîons excitées par l’organe font
une trace continue, à caufe de la célérité avec la-
aueile elles fe fuccedent. La corde de viole élargie 6è
multipliée par les vibrations, produit le même effet;
Le cercle de feu qu’on fait voir avec un (impie charbon
ardent tourné en rond, s’explique par le mêmé
principe. En un mot, tous ces phénomènes de l’ouiè
& de la vue dépendent de la durée de la fenfation que
les objets excitent dans les nerfs, 6c de la promptitu*
de avec laquelle leurs aérions fe repetent. (D./.)
ROULAGE , f. m. ( Comm.) profeffion qu’exercent
les Rouliers. Il fignifie aufli le prix , le falairè
qu’on paye aux rouliers pour leurs peines; Voye^.
R oulier.
Roulage fe dit encore de la fonélion de certains petits
officiers de villes que fon entretient fur les ports
pour fortir des bateaux les balles, ballots, tonneaux
6c futailles , les mettre à terre en les roulant fur des
planches.. Ces officiers ont à Paris pour le roulage des
marchandifes des droits particuliers qui leur font attribués
par une ordonnance de la ville de l’année
1641. Dicl, de Comm>. & de Trévôuxi
ROULEAU, f. m. (Conchyliol: ) genre de coquille
marine , univalve, dont la bouche eft toujours
alongée ; fon fommet eft quelquefois détaché
du corps par un cercle , & quelquefois il eft couronné
; le fut eft toujours uni.
Les rouleaux font autrement nommés çylihdrts, 8è
plus communément olives; V O liv e , ( Conchy-
Hol.) (D. /.)
R o ule au , fini. (Jntitj. eccléf ) feuillè de par-
1 chemin, au haut de laquelle on inferivoit anciennement
dans les monafteres le nom 6c l’éloge d’un abbé
i F f f