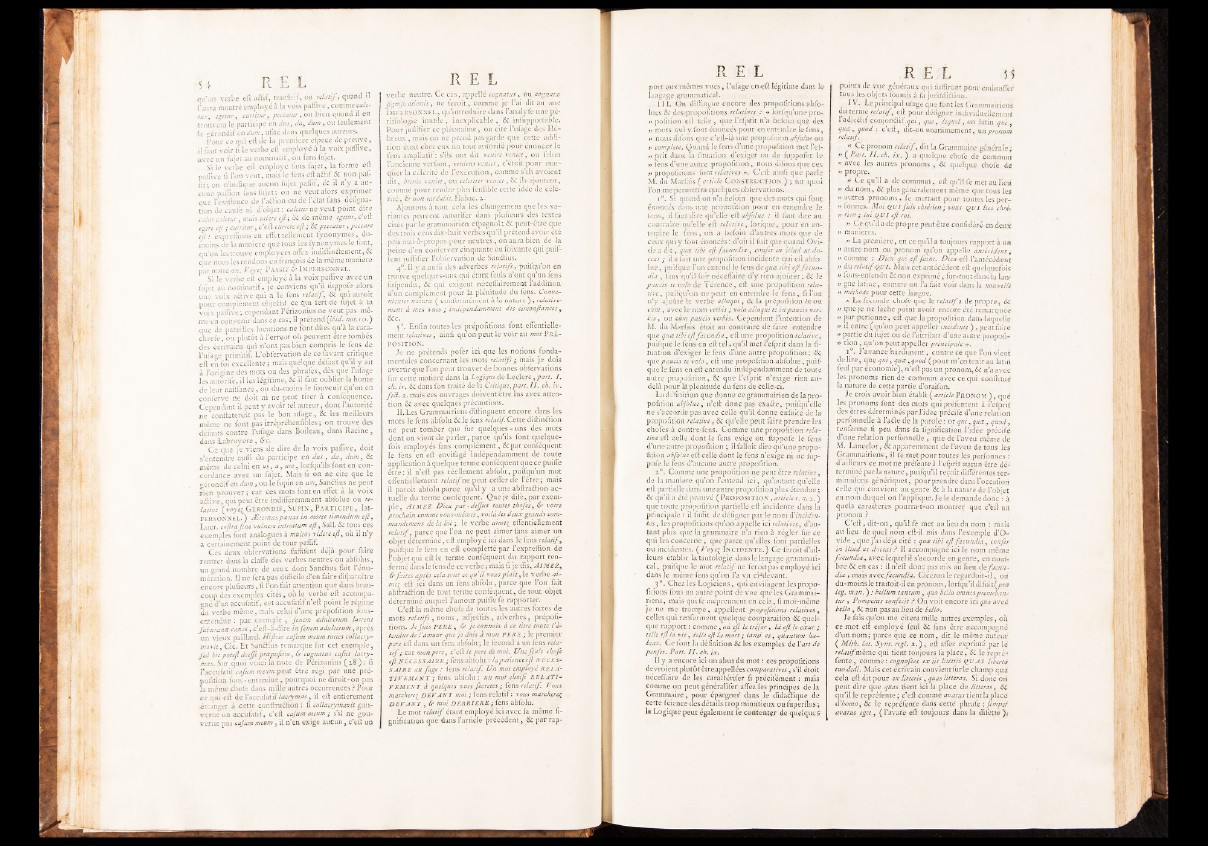
WÊÊmÊÊti
t:
<m\in verbe efi a Gif, tranfitif, ou relatif, quand il
l’aura montré employé à la voix paffive, comme cale-
tur e«etur curritur, ptccatur, ou bien quand il en
trouvera le participe en dus, da, dum, ou ieulement
4e gérondif en dum, ufité dans quelques auteurs.
Pour ce qui efi de la première d'pece de preuve,
il faut voir fi le verbe elt employé à la voix paffive,
•avec un fujet au nominatif, ou fans fujet.
Si le verbe elt employé fans fujet, la forme eft
paffive fi l’on veut, mais le fens eftaGif & non paffif;
on n’indique aucun fujet paffif, & il n y a aucune
paffion fans fujet; on ne veut alors exprimer
que l’exiftence de l’aGion ou.de l’etat (ans défigna-
tion de caufe ni d’objet : caletur ne veut point dire
■ calor calitur mais calere efl; &C de même egetur, e’eft
jgere e(i ; curritur, c’eft currere efl; & peccatur, peccare
efl : expreffions en effet tellement fynonymes, du-
moins de la maniéré que tous les fynonymes le font,
qu’on les trouve employées affez indiftin&ement,&
eue nous les rendons en françois de la même maniéré
par notre on. Voye^_ PASSIF & IMPERSONNEL.
Si le verbe eft employé à la voix paffive avec un
fujet au nominatif, je conviens qu’il fuppofe alors
une voix aGive qui a le fens relatif, & qui auroit
pour complément objeGif ce qui fert de lujet à la
voix paffive ; cependant Périzonius ne veut pas mê-
.me en convenir dans ce cas; il prétend(ibid. not. 10.)
que de pareilles locutions ne font dues qu’à la cata-
chrefe, ou plutôt à l’erreur où peuvent être tombés
des écrivains qui n’ont pas bien compris le fens de
l’ufage primitif. L’obfervation de ce (avant critique '
eft en foi excellente ; mais quelque défaut qu’il y ait
à l’origine des mots ou des phrafes, dès que l’ufage
les autorife, il les légitime, & il faut oublier la honte
de leur naifiànce, ou du-moins le fouvenir qu’on en
conferve ne doit ni ne peut tirer à confequence.
Cependant il peut y avoir tel auteur, dont l’autorité
ne conftateroit pas le bon ufage, & les meilleurs
même ne font pas irrépréhenfibles ; on trouve des
défauts contre l’ufage dans Boileau, dans Racine,
dans Labruyere, &c.
Ce que je viens de dire de la voix paffive, doit
s’entendre auffi du participe en dus , da, dum, &
même de celui en us, a , um, lorfqu’ils font en concordance
avec un fujet. Mais fi , on ne cite que le
oérondif en dum, on le fupin en itm, SanGius ne peut
rien prouver ; car ces mots font en effet à la voix
aftive, qui peut être indifféremment abfolue ou relative
( voyet(_ Gérondif, Supin , Pa r t ic ip e , Impersonnel.)
ÆterncLS panas in morte timendum efl,
Lucr. caflra. fine vulnere introïtum efl, Sali. & tous ces
exemples font analogues à multos videre efl, où il n’y
z certainement point de tour paffif. %.
Ces deux observations fuffifent déjà pour faire
-rentrer dans la claffe des verbes neutres ou abfolus,
un grand nombre de ceux dont SanGius fait l’enu-
mération. Il ne fera pas difficiled’en faire difparoître
.encore plufieurs, fi l’on fait attention que dans beaucoup
des exemples cités, où le verbe eft accompagné
d’un accufatif, cet accufatif n’eft point le régime
du verbe même, mais celui d’une prepofition (ous-
■ entendùe : par exemple , fenem adulterum latrent
fuburan.ee canes, c’eft-à-dire in fenem adulterum, après
.un vieux paillard..Hifirio cafum meum loties collacry-
mavit Cic. Et SanGius remarque fur cet exemple,
fed hic poiefl deeffé protpofitio, & cognatus cafus lacry-
mas. Sur quoi voici la note de Périzonius ( 28 ) : fi
l’accufatif cafum meum peut être régi par une pré-
pofition fous - entendue, pourquoi ne diroit-on pas
la même chofe dans mille autres occurrences ? Pour
ce qui eft de l’accufatif laaymas, il eft entièrement
-étranger à cette conftruGion : fi collacrymavit gouverne
un accufatif, c’eft cafum meum ; s’il ne gouverne
pas cafum meum, il n’en exige aucun, c’eft un
R E L
verbe neutre. Ce cas, appellé cognatus, ou cogna ta
fgnificadonis, ne feroit, comme, je l’ai dit au mot
Impersonnel, qu’introduire dans l’analyfe une pé-
riflologie inutile, inexplicable, 6t infupportable.
Pour jlifiifier ce pléonafme, on cite l’ufage des Hébreux
, ma^qn ne prend pas garde que cette addition
étoit chez eux un tour autorifé pour énoncer le
fens ampliatif : s’ils ont dit vende veniet, ou félon
l’ancienne verfion, veniens veniet, c’étoit pour marquer
la célérité de l’exécution, comme s’ils avoient
ait, b revis veniet, o u celeriter veniet, & ils ajoutent,
comme pour rendre plus fenfible cette idée de célérité
, & non tardabit. Habac. 2.
Ajoutons à tout cela les changemens que les variantes
peuvent autorifer dans plufieurs des textes
cités par le grammairien efpagnol; & peut-être que
des trois cens dix-huit verbes qu’il prétend avoir été
pris mal-à-propos pour neutres', on aura bien de la
peine d’en conferver cinquante oufoixante qui puif-
fent juftifier l’obfervation de SanGius.
40. Il y a auffi des adverbes relatifs ,-puifqu’on en
trouve quelques-uns qui étant feuls n’ont qu’un fens
fufpendu, & qui exigent néceffairement l’addition
d’un complément pour la plénitude du fens. Conve-
nienter naturel ( conformément à la nature ) ; relativement
à mes vues ; indépendamment des circonflànces,
&c. <°. Enfin toutes les prépofitions font effentielle-
ment relatives, àinfi qu’on peut le voir au mot Préposit
io n.
Je ne prétends pofer ici que les notions fondamentales
concernant les mots relatifs; mais je dois
avertir que l’on peut trouver de bonnes obfervations
fur cette matière dans la Logique de Leclerc, part. 1.
ch. iv. & dans fon traité de la Critique,part. II. ch. iv.
' fect. 2. mais ces ouvrages doivent'être lus avec attention
& avec quelques précautions.
II. Les Grammairiens diftinguent encore dans les
mots le fens abfolu ècle fens relatif. Cette diftinGion
ne peut tomber que fur quelques-uns des mots
dont on vient de parler, parce qu’ils font quelquefois
employés fans complément, &par conféquent
le fens en eft envifagé indépendamment de toute
application à quelque terme conféquent que ce puifle
être : il n’eft pas réellement abfolu, puifqu’un mot
effentiellement relatif ne peut ceffer de l’être ; mais
il paroit abfolu parce qu’il y a une abftraGion actuelle
du terme conféquent. Que je dife, par exemple,
A im e z Dieu par-defj'us toutes chofes, & votre
prochain comme vous-mêmes, voilà les deux grands com-
mandemens de la loi ; le verbe aime{ effentiellement
relatif, parce que l’on ne peut aimer fans aimer un
objet déterminé, eft employé ici dans le fens relatif,
puifque le fens en eft completté par l’expreffion de
l’objet qui eft le terme conféquent du rapport renfermé
dans le fens de ce verbe ; mais fi je dis, A im e z ,
& faites apres cela tout ce qu'il vous p la ît, le verbe ai-
me{ eft ici dans un fens abfolu, parce que l’on fait
abftraGion de tout terme conféquent, detout objet
déterminé auquel l’amour puiffe fe rapporter.
C’eft la même chofe de toutes les autres fortes de
mots relatifs , noms, adjeftifs., adverbes, prépofitions.
Je fuis PERE, & je cannois à ce titre toute l ’étendue
de L'amour que je dois à mon PERE ; le premier
pere eft dans un fens abfolu; le fécond a un fens relatif;
car mon pere, c’efl: le pere de moi. Une feule chofe
efl n e c e s s a ir e ; fens abfolu,: lapatience ejl n é c e s s
a i r e au J'age : fens relatif. Un mot employé RELATIVEMENT
; fens abfolu; un mot choifi r e l a t i v
e m e n t à quelques vues fecretes ; fens relatif. Kous
marchere? d e v a n t moi ; fens relatif: vous marcherez
d e v a n t , & moi DERRIERE ; fens abfolu.
Le mot relatif étant employé ici avec la même lignification
que dans l’article précédent, & par rap-
R E L
port aux mêmes vues, l’ufage en-eft légitime dans le
langage grainmatical.
I II. On diftingue encore des propofitions abfo*;
lues & des-propofitions relatives ; « lorfqu’une prot
» pofition eft telle, que l’efprit n’a befoin que des
» mots qui y (ont énoncés pour en entendre le fens,
» nous difons que c ’eft-là une propofition abfolae pu
>1 complété. Quand le fens d’une propofition met l’ef-
» prit dans la fituation d’exiger ou de fiippofer le.
» fens d’une autre propofition , nous difons que ces
» propofitions font relatives ». C’eft ainfi que parle
M. du Marfais ( article C onstruction ) ; fur quoi:
l’on me permettra quelques obfervatiooSi
i° . Si quand on n’a befoin quelles mots qui font
énoncés dans une propofition pour en entendre le
fens, il faut dire qu’elle eft abfolue ; il faut dire au
contraire qu’elle eft relative, lorfque, pour en entendre
le fens, on a befoin d’autres mots que dé
ceux qui y font énoncés Ed’où il fuit qué quand Ovide
a dit, qutÈ tibi ejl facundia , tonfer iri ÏLlud ut do-
ccas ; il a fait urte propofition incidente qui eft abfo-
lu e , puifque l’on entend le Cens de quee dbi ejl facundia
, fans qu’il foit néceffaire d’y rien ajouter; & le
puucis te volo de Térence, eft une propofition relative,
puifqu’on ne peut en entendre le fens-, fi l’on
n’y aj otite le verbe alloqui, & la prépofition in ou
cum , avec le nom verbis ; volo alloqui te iri paucis ver-
bis, où cum paucis verbis. Cependant l’intention de
M. du Marfais étoit au contraire de faire entendre
que qua tibi efl facundia, eft une propofition relative,
puifquë le fens en eft tel, qu’il met l’efprit dans la fituation
d’exiger le fens d’une autre propofition ; Ôç
que paucis te volo, eft Une propofition abfolue, puifque
le fe.ns en eft entendu indépendamment de toute
autre propofition, & que l’efprit n’ exig.e rien au-
delà pour lâ.plénitude du fens de celle-ci.
La définition que donne ce grammairien de la pro-
pofiriôn abfolue, n’eft donc pas eXaGe, puifqii’elle
ne s’accorde pas avec celle qu’il donne enfuite de la
propofition relative ^ & qu’elle peut faire prendre les
chofes à con.tre-fens. Comme une propofition relative
eft celle dont le fens exige ou ftippofe le fens
d’une autre propofition ; ilfaUoit dire qu’une propofition
abfolue eft celle dont le fens n’exige ni ne fuppofe
le fens d’aiicune autre propofition.
■ 20. Comme une propofition ne peut être relative,
de la maniéré qu’on l’entend ic i, qii’autant qu’elle
eft partielle dans une autre propofition plus étendue ;
& qü’il a été prouvé ( Proposition , article 1. n. 2. )
que toute propofition partielle eft incidente dans ia
principale : il fuffit de défigner par le nom à'incidentes
+ les propofitions qu’on appelle ici relatives, d’autant
plus que la grammaire n’a rien à régler fur ce
qui les concerne , que parce qu’elles font partielles
ou incidentes. ( Voye^ Incidente.) Ce feroit d’ailleurs
établir la tautologie daiïs le langage grammatical,
puifque le mot relatif ne feroit pas employé ici
dans le même fens qu’on l’a vu ci*devant.
30. Chez les Logiciens, qili envifagent les propofitions
fous lin autre point de vue que les Grammairiens,
mais quife méprennent en cela, fi moi-même
je ne me trompe, appellent propofitions relatives,
celles qui renferment quelque comparaifon & quel-,
que rapport : comme, où efi le tréfor, là efl. le coeur ;
telle efl la vie , telle efl la niort ; tanti es, quantum ha-,
béas. Ce font la définition & les exemples de Y art dè
penfer. Part. II. ch. ixt
Il y a encore ici un abus dù mot : ces pro‘po‘fitiôris
devroient plutôt êtreâppellées comparatives ; s’il étoit
néceffaire de les earaGérifer fi précifément ; mais
comme on peut généralifer affez les principes de la
Grammaire, pour épargner dans le didaGique de
Cette fcience des détails trop minutieux oùfuperflus ;
la Logique peut également fe contenter de quelque S
R E L 5 !
points de vue généraux qui fuffirortr pour embraffer
tous les objets fournis à fa jurifdiGion. .
IV . Le principal ufage qüe font les Grammairiens
du terme relatif, eft pour défigner individuellement
ladjeGif conjondif qui, que, ■ lequel, en latin qui ^
quez,, quôd ; c’eft,, dit-pn unanimement, un prono ni
relatif.
« Ce pronom relatif, dit la Grammaire générale j
» ( Part. II. ch. ix. ) a quelque chofe de commun
n: avec les autres pronoms , & quelque chofe de
» propre.
» Ce qu’il a de commuri, eft qu’il fe met au, lieu
» du nom., ôc plus généralement même que tous les
«autres pronoms j fe mettant pour toutes les per-
» lonnes. Moi QUI fuis chrétien; vous QUI êtes chré-
» tien ; Ipi q u i efl roi.,
” C.eRu’Ha de propre peut être cônfidérê en dénie
» maniérés.,
. » La-première, eii ce qu’il a toujours rapport à lin
« autre nom ou pronom qii’on appelle antécédent ;
»comme : Dieu qui efl faim. Dieu eft l’antécédent
» du relatif q u i . Mais cet antécédent eft quelquefois
» fousrentendu &non exprimé; fur-tout dans la lan-
» gue latine, comme on.l’a fait voir dans la nôuvellè
» méthode pour cette langue..
» La fécondé chofe. que le relatif a dè propre $ &
» que je ne fâche point avoir encore été remarquée
» par perfonne, eft que ia propofition dans laquelle
» il entre (qu’on peut appeller incidente ) , peut faire
» partie du fujet où de l’attribut d’une autre propofi-
>> tion , qu’on peut appeller principale ».
i° . J’avance hardiment, contre ce qüe l’ori vient
de lire, que qui, qua, quod ( pour m’en tenir ail latin
feul par économie), n’eft pas un pronom, & n’a avec
les pronoms rien de commun avec ce qui eonftitué
la nature de cette partie d’oraifon.
Je crois avoir bien établi ( article PRONOM ) , qué
les pronoms font des mots qui préfentent à l’efpriC
des êtres déterminés par l’idée précife d’une relation
perfonnelle à l’aGe de la parole : or qui, quæ, quod,
renferme li peu dans fa Lignification l’idée précife
d’une relation perfonnelle ; que dé l’aveu même de
M. Lancelot, & apparemment de l’aveu de tous les
Grammairiens, il fe met pour toutes lés perfonnes i
d’ailleurs ce mot ne préfente à l’efprit aucun être dé^
terminé par la nature, puifqu’il reçoit différentes ter-
minaifons génériques, pour prendre dans l’occalîon
celle qui convient au genfe & à la nature de l’objet
au nom duquel ori l’applique. Je le demandé donc : à
quels caraGeres pourra-t-on montrer que c’eft un
pronom ?
C ’eft, dit-oii, qii’il fe riiet au lieu du nom : niais
aii lieu de quel nom eft-il mis dans l’exemple d’O vide
, qüe j’ai déjà cité : qua iibi efl facundia, confer
in illud ut doceas ? Il accompagne ici le nom même
facundia, avec lequel il s’accorde en genre, en nombre
& en cas : il n’eft donc pas mis au lieu de facundia
; mais avec facundia. Cicéron le regardoit-il,. ou
du-moirts le traitoit-il en pronom, lorfqu’il clifoit (^prô
lèg. man. ) „• bellum tantuni, quo bello omnts premebam
tur, Pompeius confiât ? On voit encore ici quo aved
btllo, & non pas au lieu de belloi
Je fais qu’on me citera mille autres exemples, où
ce mot elt employé feiil & fans être accompagné'
d’un nom ; parce que ce nom, dit le même auteur
( Mèth. lat. Synt. rcgl. 2. ),- eft affez exprimé par le'
relatif même qui tient toujours; fa place, & le repréfente
, comme : cognofces ex iis litleris QU AS liberto
tuodedi. Mais cet écrivain ,cort vient fur le champ que
cela eft dit pour ex littèris , quas litteras. Si donc ori
petit dire que qUas tient ici la placé de litte ra sôc
qu’il le repréfente ; c’eft commè avarus tient la placé
à’hornôi & le repréfente dans cette phrafe l fèmpef
avarus eget, ( l’avare eft toujours dans la diletté f