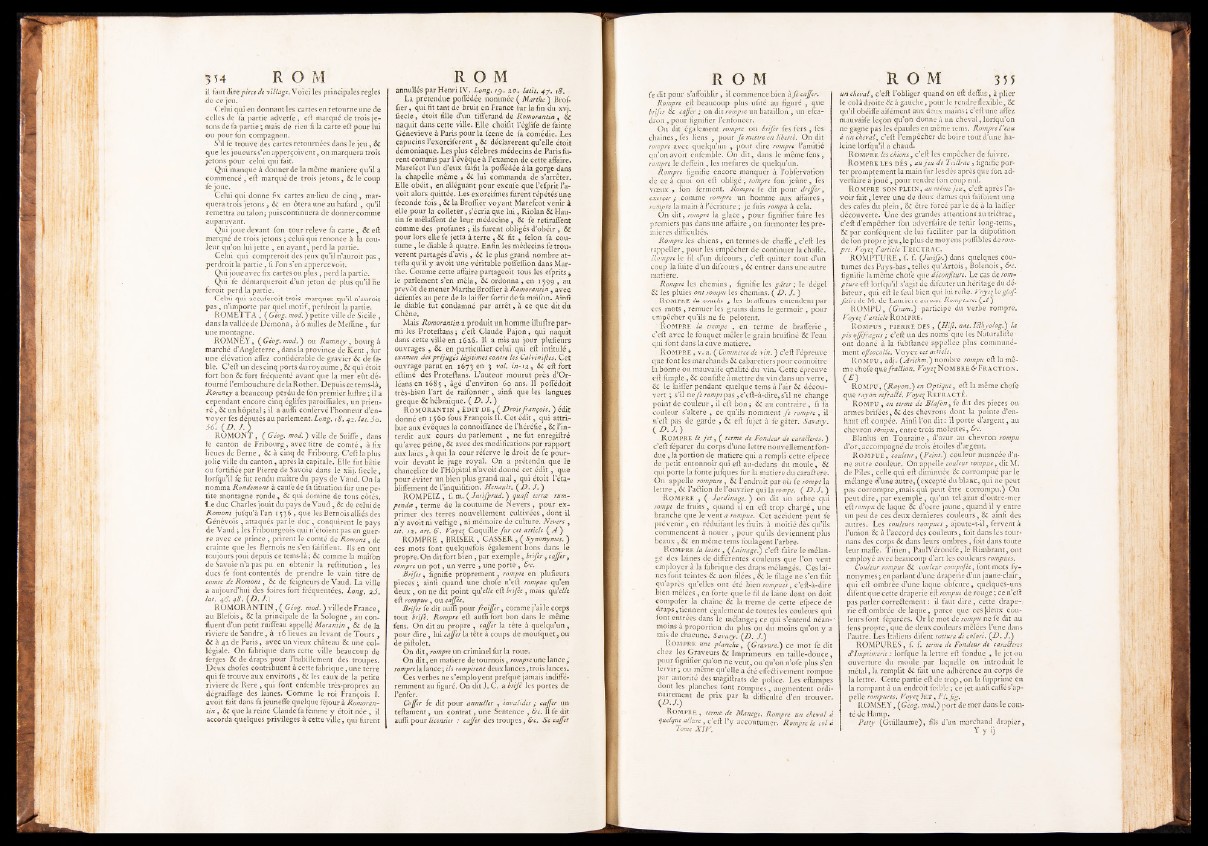
il faut dire pièce de village. Voiei les principales réglés
de ce jeu.
Celui qui en donnant les cartes en retourne une de
•celles de fa partie adverfe, eft marqué de trois jetons
de la partie ; mais de rien li la carte elt pour lui
ou pour Ion compagnon.
S’il fe trouve des cartes rétournées dans le jeu, &
que les joueurs s’en apperçoivent, on marquera trois
-jetons pour celui qui fait.
• Q ui manque à donner de la même maniéré qu’il a
commencé, eft marqué de trois jetons, & le coup
fe joue.
Celui qui donne lix cartes au-lieu de cin q , marquera
trois jetons , & en ôtera une au hafard , qu’il
remettra au talon; puis continuera de donner comme
•auparavant.
Qui joue devant fon tour releve fa carte, & eft
marque de trois jetons ; celui qui renonce à la couleur
qu’on lui jette , en ayant, perd la partie.
Celui qui compteroit des jeux qu’il n’auroit pas ,
perdroitla partie, fi l’on s'en appercevoit.
Qui joue avec lix cartes ou plus , perd la partie.
Qui fe démarqueroit d’un jeton de plus qu’il ne
feroit perd la partie.
Celui qui accuferoit trois marques qu’il n’auroit
pas , n’importe par quel motif, perdroit la partie.
ROMETTA , ( Géog. mod. ) petite ville de Sicile ,
dans la vallée de Démona, à 6 milles de Meffine, fur
une montagne.
ROMNEY, ( Géog. mod. ) oit Rumney , bourg à
marché d’Angleterre j dans la province de K en t, lur
une élévation affez confidérable de gravier & de fable.
C’ eft un des cinq ports du royaume, & qui étoit
fort bon & fort fréquenté avant que la mer eût détourné
l’embouchure delaRother. Depuis ce tems-là,
Romney a beaucoup perdu de fon premier luftre ; il a
cependant encore cinq églifes paroifliales, un prieuré
, & un hôpital ; il a aulîi confervé l’honneur d’envoyer
fes députés au parlement. Long. 18. 42. lat. 5o.
SSi (D . J. )
ROMONT , ( Géog. mod. ) ville de Suiffe, dans
le canton de Fribourg, avec titre de comté, à fix
lieues de Berne, & à cinq de Fribourg. C’eft la plus
jolie ville du canton, après la capitale. Elle fut bâtie
ou fortifiée par Pierre de Savoie dans le xiij. fiecle,
lorfqu’il fe fut rendu maître du pays de Vaud. On la
nomma Rondemont à caufe de fa fituation fur une petite
montagne ronde, & qui domine de tous côtés.
Le duc Charles jouit du pays de Vaud, & de celui de
Romont jufqu’à l’an 1536, que les Bernois alliés des
Génévois , attaqués par le du c, conquirent le pays
de Vaud ; les Fribourgeois qui n’étoient pas en guerre
avec ce prince , prirent le comté de Romont de
crainte que les Bernois ne s’en faififfent. Ils en ont
toujours joui depuis ce tems-là; & comme la maifon
de Savoie n’a pas pu en obtenir la reftitution , les
ducs fe font contentés de prendre le vain titre de
comte de Romont, & de feigneurs de Vaud. La ville
a aujourd’hui des foires fort fréquentées. Long. 26.
lat. 46'. 48. (D . J.)
ROMORANTIN, ( Géog. mod. ) ville de France,
au Blefois, & la principale de la Sologne , au confluent
d’un petit ruiffeau appellé Morantin , & de la
riviere de Sandre, à 16 lieues au levant de Tours ,
& à 42 de Paris, avec un vieux château & une collégiale.
On fabrique dans cette ville beaucoup de
ferges & de draps pour l’habillement des troupes.
Deux chofes contribuent à cette fabrique, une terre
qui fe trouve aux environs , & les eaux de la petite
riviere de Rere , qui font enfemble très-propres au
dégraiffage des laines. Comme le roi François I.
avoit fait dans fa jeuneffe quelque féjour à Romoran-
tin , & que la reine Claude fa femme y étoit née , il
accorda quelques privilèges à cette v ille, qui furent
annullés par Henri IV. Long. ig . 20. latit. 4y. 18.
La prétendue pofledée nommée ( Marthe ) Birof-
fie r , qui fit tant de bruit en France lur la fin du xvj.
fiecle, étoit fille d’un tifferand de Romorantin , 6c
naquit dans cette ville. Elle choifit l’églife de fainte
Génevieve à Paris pour la fcene de fa comédie. Les
capucins l’exorciferent, & déclarèrent qu’elle étoit
démoniaque. Les plus célébrés médecins de Paris furent
commis par l’évêque à l’examen de cette affaire.
Marefcot l’un d’eux faifit la pofledée à la gorge dans
la chapelle même » & lui commanda de s’arrêter.
Elle obéit, en alléguant pour excufe que l’efprit l’a-
voit alors quittée. Les exorcifmes furent répétés’une
fécondé fois , & la Broflier voyant Marefcot venir à
elle pour la colleter, s’écria que lu i, Riolan & Hau-
tin fe mêlaffent de leur médecine, & fe retiraffënt
comme des profanes ; ils furent obligés d’obéir * &
pour lors elle fe jetta à terre , & fit , félon fa coutume
, le diable à quatre. Enfin les médecins fe trouvèrent
partagés d’avis , & le plus grand nombre at-
tefta qu’il y avoit une véritable pofîeflion dans Marthe.
Comme cette affaire partageoit tous les efprits ;
le parlement s’en mêla, & ordonna , en 1599 , au
prévôt de mener Marthe Broflier à Romorantin, avec
défenfes au pere de la laifler fortir de fa maifon* Ainfi
le diable fut condamné par arrêt, à ce que dit du
Chêne.
Mais Romorantin a produit un homme illuftre parmi
les Proteftans ; c’eft Claude Pajon, qui naquit
dans cette ville en i6 i6 . Il a mis au jour plufieurs
ouvrages , & en particulier celui qui eft intitulé ^
examen des préjugés légitimes contre les Calvinifles. Cet
ouvrage parut en 1673 en 3 vol. in-12, & eft fort
eftimé des Proteftans. L’auteur mourut près d’Orléans
en 1685 , âgé d’environ 60 ans. Il poffédoit
très-bien l’art de raifonner , ainfi que les langues
greque & hébraïque. ( D . J. )
R o m o r a n t i n , é d i t d e , (Droitfrançois. ) édit
donné en 1560 fous François II. Cet édit, qui attribue
aux évêques la connoiffance de l’héréfie , & l’interdit
aux cours du parlement , ne fut enregiftré
qu’avec peine, & avec des modifications par rapport
aux laïcs , à qui la cour réferve le droit de fe pourvoir
devant le juge royal. On a prétendu que le
chancelier de l’Hôpital n’avôit donné cet édit , que
pour éviter un bien plus grand m al, qui étoit l ’étk-
bliffementde l’inquifition. Henault. (D . J .)
ROMPEIZ , f. m. ( Jurifprud. ) qua(î terra rum-
pendce , terme de la coutume de Nevers , pour exprimer
des terres nouvellement cultivées , dont il
n’y avoit ni veftige , ni mémoire de culture. Nevers ,
tit.12 . art. 6 . Voye{ Coquille fur cet article ( A )
ROMPRE , BRISER , CASSER , ( Synonymes. )
ces mots font quelquefois également bons dans le
propre. On dit fort b ien, par exemple, brifer t caffer,
rompre un p o t , un verre , .une porte , &c.
Brifer, fignifie proprement, rompre en plufieurs
pièces ; ainfi quand une chofe n’eft rompue qu’en
deux , on ne dit point ocelle eft brifée , mais qu’elle
eft rompue , ou caffée.
Brifer fe dit aufli pour froijfer, comme j’ai le corps
tout brifé. Rompre eft aufli fort bon dans le même
fens. On dit au propre , caffer la tête à quelqu’un -9
pour dire, lui caffer la tête à coups de moufquet, ou
de piftolet.
On dit, rompre un criminel fur la roue.
On dit, en matière de tournois, rompre une lance ÿ
rompre la lance ; ils rompirent deux lances, trois lances.
Ces verbes ne s’employent prefque jamais indifféremment
au figuré. On dit J. C . a brifé les portes de
l’enfer.
Caffer fe dit pour annulltr , invalider ; caffer un
teftament, un contrat, une Sentence , &c. Il fe dit
aufli pour licentier : caffer des troupes, &c. Se caffer
fe dit pour s’àffoiblir, il commence bien à fe caffer.
Rompre eft beaucoup plus ulité au figuré , que
brifer & caffer ; ort Ait rompre un bataillon, un efca-
dron, pour lignifier l’enfoncer.
On dit également rompre ou brifer fes fers , fes
chaînes, fes liens , pour fe mettre en liberté. On dit
rompre avec quelqu’un , pour dire rompre l’amitié
qu’on avoit enfemble. On dit, dans le même fens ,
rompre le deffein , les mefures de quelqu’un.
Rompre fignifie encore manquer à l’obfervat-ion
de ce à quoi on eft obligé -, rompre fon jeûne, fes
voeux , fon ferment. Rompre fe dit pour drèfferp
exercer ; comme rompre un homme aux affaires ,
rompre la main à l’écriture ; je fuis rompu à cela.
On dit ; rompre la g la ce, pour fignifier faire les
premiers pas dans une affaire, ou furmonter les premières
difficultés.
Rompre les chiens, en termes de chaflè , c’eft les
rappeller, pour les empêcher de continuer la chaffe.
Rompre le fil d’un difcours, c’eft quitter tout d’un
coup la fuite d’un difcours , & entrer dans une autre
matière.
Rompre les chemins , fignifie les gâter ; le dégel
& les pluies ont rompu les chemins. fD . J. )
R o m p r e la couche j les braffeurs entendent par
ces mots , remuer les grains dans le germoir , pour
empêcher qu’ils ne fe pelotent.
' R o m p r e la trempe , en terme de brafferie ,
c’eft avec le fouquet mêler le grain bruifiné & l’eau
qui font dans la cuve matière.
R o m p r e , v. a. ( Commerce de vin. ) c’eft l’épreuve
que font les marchands & cabaretierspour connoître
la bonne ou mauvaife qualité du vin. Cette épreuve
eft fimple, & confifte à mettre du vin dans un verre,
êf le laifler pendant quelque tems à l’air & découvert
; s ’il nefe rompt pas, c’eft-à-dire, s’il ne change
point de couleur, il eft bon ; & au contraire , fi fa
couleur s’altere , ce qu’ils nomment fe rompre, il
n’eft pas de garde , & eft fujet à fe gâter. Savary. ■ H I R o m p r e le j e t , ( terme de Fondeur de caractères. )
c’eft féparer du corps d’une lettre nouvellement fondue
, la portion de matière qui a rempli cette efpece
de petit entonnoir qui eft au-dedans du moule, &
qui porte la fonte jufques fur la matière du caraftere.
On appelle rompure , & l’endroit par oii fe rompt la
lettre , & l’a&ion de l’ouvrier qui la rompt. ( D. J. )
R o m p r e , ( Jardinage. ) on dit un arbre qui
rompt de fruits, quand il en eft trop chargé, une
branche que le vent a rompue. Cet accident peut fe
prévenir , en réduifant les fruits à moitié dès qu’ils
commencent à nouer , pour qu’ils deviennent plus
beaux, & en même tems foulagent l’arbre.
R o m p r e la laine, (Lainage.) c’eft faire le mélange
des laines de différentes couleurs que l’on veut
employer à la fabrique des draps mélangés. Ces laines
font teintes & non filées, &: le filage ne s’en fait
qu’après qu’elles ont été bien rompues, c’eft-à-dire
bien mêlées, en forte que le fil de laine dont on doit
compofer la chaîne & la treme de cette efpece de
draps, tiennent également de toutes les couleurs qui
lont entrées dans le mélange ; ce qui s’entend néan-1
moins a proportion du plus ou du moins qu’on y a
mis de chacune. Savary. (D . J.)
R o m p r e une planche, (Gravure.) ce mot fe dit
chez les Graveurs & Imprimeurs en taille-douce,
pour fignifier qu’on ne veut, ou qu’on n’ofe plus s’en
lervir; ou meme qu’elle a été effectivement rompue
par autorité des magiftrats de police. Les eftampes
dont les planches font rompues, augmentent ordi-
— t de prix par la difficulté d’en trouver.
R o m p r e , terme de Mantge. Rompre un cheval à
quelque allure , c ’e ft l ’y a c c o u tum e r . Rompre le col à
Tome XIV.
un cheval, c’eft l’obliger quand on eft defliis, à plier
le col à droite & à gauche, pour le rendre flexible, &
qu’il obéiffe aifément aux deux mains ; c’eft une affez
mauvaife leçon qu’on donne à un cheval, lorfqu’on
ne gagne pas les épaulés en même tems. Rompre l'eau
à un cheval, c’eft l’empêcher de boire tout d’une haleine
lorfqu’il a chaud.
R o m p r e les chiens, c’eft les empêcher de fuivre.
R o m p r e LES DÉS , au jeu de Trictrac, fignifie porter
promptement la main fur les.dés après que fon ad-
verfaire a jou é, pour rendre fon coup nul.
ROMPR.E SON p l e i n , au même jeu, c’eft après l’avoir
frit, lever une de deux dames qui faifoient une
des cafés du plein, & être forcé par le dé. à la laifler
découverte. Une des grandes attentions au tri&rac,
c’eft d’empêcher fôn adverfaire de tehir long-tems,
& par conféquent de lui faciliter par la difpofition
de fon propre jeu, le plus de moyens poffibles derom~
pre. Voyt{ Varticle T R IC T R A C .
ROMPTURE, f. f. (.Jurifp.) dans quelques coutumes
des Pays-bas, telles qu’Artois, Bolenois, &c.
fignifie la même chofe que déconfiture. Le cas de rom-
pture eft lorfqu’il s’agit de difcuterun héritage du débiteur,
qui eft le feul bien qui lui refte. V?ye{ le glofi
faire de M. de Lauriere au mot Rompture. (.A )
ROMPU, (Gram.) participe du verbe rompre.
Voyeu r article ROMPRE.
R o m p u s , p i e r r e d e s , (Hifl. nat. Icthyolog.') la
pis offifragus ; c’eft un des noms que les Naturalifte-
ont donné à la fubftance appellée plus communément
ofleocolle. Voyez cet article.
R om p u , adj. (Aritkm.) nombre rompu eft la même
chofe que frakion. P o y e^ N oM B R E 6 *F r a c t i o n .
( E )
R o m p u , (Rayon.) en Optique, e ft la m êm e ch o fe
q u e rayon refraïlé. Voye^ R é f r a c t é .
R o m p u , en terme de Blafon, fe dit des pièces' ou
armes brifées, & des chevrons dont la pointe d’en-
haut eft Coupée. Ainfi l’on dit : il porte d’argent, au
chevron rompu, entre trois molettes, &c.
Blanlus en Touraine, d’azur au chevron rompu
d’or, accompagné de trois étoiles d’argent.
R o m p u e , couleur, (Peint.) couleur nuancée d’une
autre couleur. On appelle couleur rompue, dit M.
de Piles, celle qui eft diminuée & corrompue par le
mélange d’une autre, (excepté du blanc, qui ne peut
pas corrompre, mais qui peut être corrompu.) On
peut dire, par exemple, qu’un tel azur d’outre-mer
eft rompu de laque & d’ocre jaune, quand il y entre
1 un peu de ces deux dernieres couleurs, & ainfi des
autres. Les couleurs rompues , ajoute-t-il, fervent à
l’union & à l’accord des couleurs, foit dans les tour-
nans des corps & dans leurs ombres, foit dans toute
leurmaffe. Titien, PaulVéronèfe, le Rimbrant,ont
employé avec beaucoup d’art les couleurs rompues.
Couleur rompue & couleur cOmpofce, font mots fy-
nonymes; en parlant d’une draperie d’un jaune-clair,
qui eft ombrée d’une laque obfcure, quelques-uns
difent que cette draperie eft rompue de rOuge ; ce n’eft
pas parler correctement : il faut dire, cette drape-,
rie eft ombrée de laque, parce que ces Jdeux couleurs
font féparées. Or le mot de rompu ne fe dit au
fens propre, que de deux couleurs mêlées l’une dans
l’autre. Les Italiens difent rottura di colori. (D . J.)
ROMPURES ? f. f. terme de Fondeur de caractères
d’imprimerie : lorfque la lettre eft fondue , le jet ou
ouverture du moule par laquelle on introduit le
métal, la remplit & fait une adhérence au corps de
la lettre. Cette partie eft de trop, on la fupprime en
la rompant à un endroit foible ; ce jet ainfi caflé s’appelle
rompures. Voye£ Je t , Fl. fig.
ROMSEY, (Géog. mod.) port de mer dans le comté
de Hamp.
Petty (Guillaume), fils d’un marchand drapier,
Y y ij