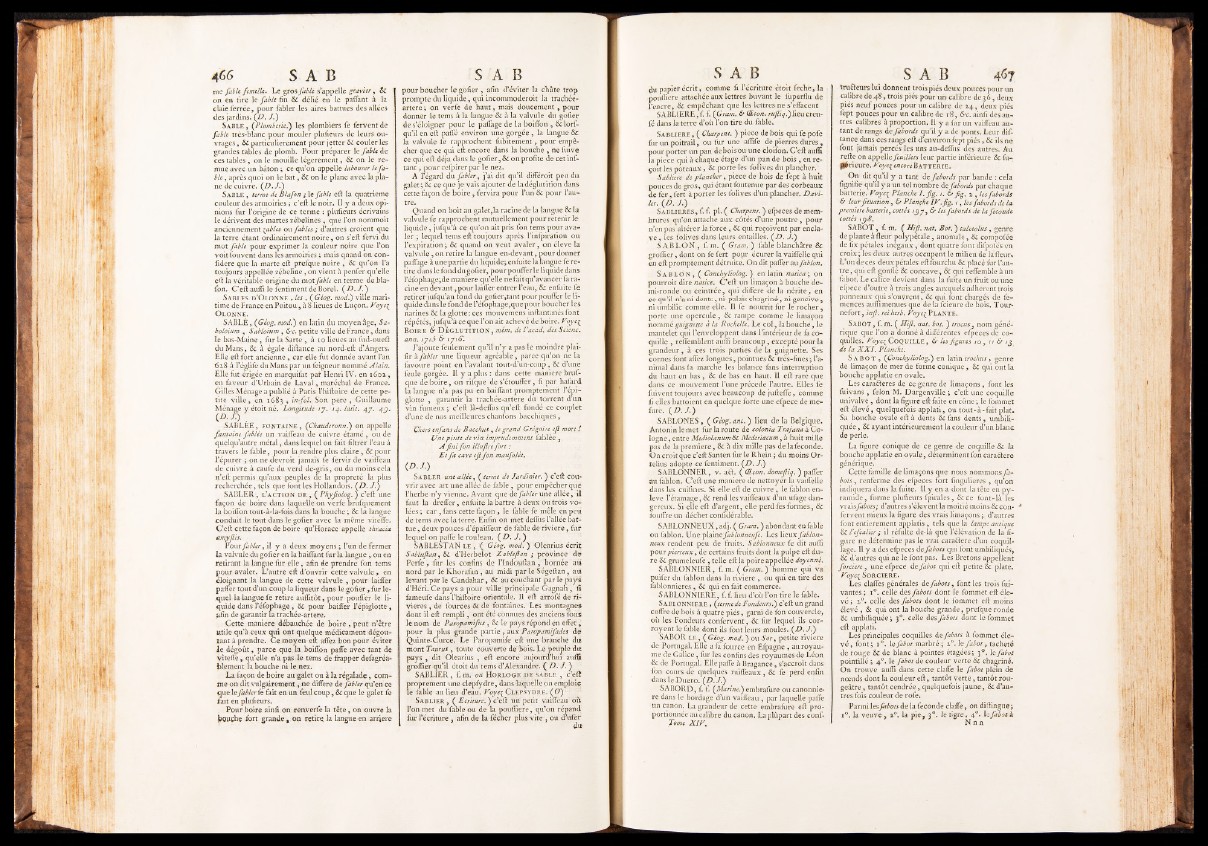
me fable femelle. Le gros fable s’appélle gravier, 8c
on en tire le fable fin 8c délié en le paffant à la
claie ferrée, pour fabler les aires battues des allées ,
des jardins. (D . Z.)
Sable , (.Plomberie.) les plombiers fe fervent de
fable très-blanc pour mouler plufieurs de leurs ouvrages
, 8c particulièrement pour jetter 8c couler les
grandes tables de plomb. Pour préparer le fable de
ces tables, on le mouille légèrement, 8c on le remue
avec un bâton ; ce qu’on appelle labourer le fa ble
, après quoi on le b at, & on le plane avec la plane
de cuivre. (D. Z.)
Sable , terme de Blafon ; le fable eft la quatrième
couleur des armoiries ; c’eft le noir. Il y a deux opinions
fur l’origine de ce terme : plufieurs écrivains
le dérivent des martes zébelines , que l’on nommoit
anciennement gables ou fables ; d’autres croient que
la terre étant ordinairement noire, on s’ eft fervi du
mot fable pour exprimer la couleur noire que l’on
voit fouvent dans les armoiries ; mais quand on con-
fidere que la marte eft prefque noire , 8c qu’on l’a
toujours appellée zébeline, on vient à penfer qu’elle
eft la véritable origine du mot fable en terme de blafon.
C’eft aufli le fentiment deBorel. (Z?.Z.')
Sables d’O lonne , les, ( Giog. mod.') ville maritime
de France en Poitou, à 8 lieues de Luçon. Vrye{
O lonne.
SABLÉ, ( Géog. mod.) en latin du moyen âge, Sa-
boloium , Sabloium , &ç. petite ville de France, dans
le bas-Maine, fur la Sarte, à io lieues au fud-oueft
du Mans, & à égale diftance au nord-eft d’Angers.
Elle eft fort ancienne, car elle fut donnée avant l’an
6x8 à l’ép;life du Mans par un feigneur nommé Alain.
Elle fut erigée en marquifat pat Henri IV. en i6 o x ,
en faveur d’Urbain de La va l, maréchal de France.
Gilles Ménage a publié à Paris i’hiftoire de cette petite
v ille , en 1683 * in-fol., Son pere , Guillaume
Ménage y étoit né. Longitude i j . 14. latit. 47. 49.
m m , I
SABLEE, FONTAINE, (’Chauderonn.) on appelle
fantaine fablée un vaifleau de cuivre étamé , ou de
quelqu’autre métal, dans lequel on fait filtrer l’eau à
travers le fable, pour la rendre plus claire, 8c pour
l’épurer ; on ne devroit jamais fe fervir de vaifleau
de cuivre à caufe du verd de-gris, ou du moins cela
n’eft permis qu’aux peuples de la propreté la plus
recherchée, tels que font les Hollandois. (Z?. Z.)
SABLER, l’a ct ion de , ( Phyjiolog. ) c’eft une
façon de boire dans laquelle on verfe brufquement
la boiffon tout-à-la-fois dans la bouche ; 8c la langue
conduit le tout dans le gofier avec la même viteffe.
C ’ eft cette façon de boire qu’Horace appelle thracia
amyJtiSi
Pour fabler, il y a deux moyens ; l’un de fermer
la valvule du gofier en la baillant fur la langue , ou en
retirant la langue fur elle, afin de prendre fon teins
pour avaler. L’autre eft d ’ouvrir cette valvule , en
éloignant la langue de cette valvule B pour laiffer
paffer tout d’un coup là liqueur dans le gofier, fur lequel
la langue fe retire auflïtôt, pour pouffer le liquide
dans l’éfophage, 8c pour baiffer l’épiglotte,
jâfin de garantir la trachée-artere.
. .Cette maniéré débauchée de b oire, peut n’être
utile qu’à.ceux qui ont quelque médicament dégouttant
à prendre. Ce moyen eft affez bon pour éviter
le dégoût, parce que.la boiffon paffe avec tant de
yîtefle, qu’elle n’a pas le tems de frapper defagréa- !
blement la bouche ni le nez.
La façon de boire au galet ou à la régalade, comme
on dit vulgairement, ne différé de fabler qu’en ce i
que le fabler fe fait en un feul coup, 8c que le galet fe ;
»ait en plufieurs.
Pour boire ainfi on renverfe la tête, on ouvre la
fcouçhe fort grande , on retiré la langue en arriéré ;
pour boucher le gofier , afin d’éviter la chute trop
prompte du liquide, qui incommoderoit la trachée-
artere ; on verfe de haut, mais doucement , pour
donner le tems à la langue & à la valvule du gofier
de s’éloigner pour le paffage de la boiffon , 8c lorf-
qu’il en eft paffé environ une gorgée , la langue 8c
la valvule fe rapprochent fubitement, pour empêcher
que ce qui eft encore dans la bouche , ne fuive
ce qui eft déjà dans le gofier, 8c on profite de cet inf-
tant, pour refpirer par le nez.
A l’égard du fabler, j’ai dit qu’il différoit peu du
galet; 8c ce que je vais ajouter de la déglutition dans
cette façon de boire, fer vira pour l’un 8c pour l’autre
.Q
uand on boit au galet,la racine de la langue 8c la
valvule fe rapprochent mutuellement pour retenir le
liquide, jufqu’à ce qu’on ait pris fon tems pour avaler
; lequel tems eft toujours après l’infpiration ou
l’expiration ; 8c quand on veut avaler, on éleve la
valvule, on retire la langue en-devant, pour donner
paffage à une partie du liquide; enfuite la langue fe retire
dans le fond du gofier, pour pouffer le liquide dans
l’éfophage;de maniéré qu’elle ne fait qu’avancer fa racine
en devant, pour laiffer entrer l’eau, 8c enfuite fe
retirer jufqu’au rond du gofier,tant pour pouffer le liquide
dans le fond de l’éfophage,que pour boucher les
narines 8c la glotte: ces mouvemens inftantanés font
répétés, jufqu’à ce que l’on ait achevé de boire. Voye^
Boire & D ég lu t it io n , mém. de Vacad. desScienc.
ann. i j iS & tyiG.
J’ajoute feulement qu’il n’y a pas le moindre plai-
fir à fabler une liqueur agréable, parce qu’on ne la
favoure point en l’avalant tout-d’un-coup, 8c d’une
feule gorgée. Il y a plus : dans cette maniéré bruf-
que de boire, on rifque de s’étouffer, fi par hafard
la langue n’a pas pu en baiffant promptement l’épiglotte
, garantir la trachée-artere du torrent d’un
vin fumeux ; c’eft là-deffus qu’eft fondé ce couplet
d’une de nos meilleures chanlons bacchiques,
Vhers enfansde Bacchus , le grand Grégoire ejl mon !
Une pinte de vin imprudemment lablee ,
A fini fon illufirefort :
Et fa cave ejl fon maufolée. MM I WM
SABLER une allée, ( terme de Jardinier. ) c’eft couvrir
avec art une allée de fable , pour empêcher que
l’herbe n’y vienne. Avant que de fabler une allée, il
faut la dreffer, enfuite la battre à deux'ou trois volées.;
car , fans cette façon , le fable fe mêle en peu
de tems avec la terre. Enfin on met deffus l’allée battue
, deux pouces d’épaiffeur de fable de riviere, fur
lequel on paffe le rouleau. ( D . J. )
SABLESTAN le , ( Géog. mod. ) Olearius écrit
Sabluftan, 8c d’Herbelot Zablejlan ; province de
Perfe, fur les confins de l’Indouftanbornée ai»
nord par le Khorafan , au midi pa rle Ségeftan, ai»
levant par le Candahar, 8c au couchant par le pays
d’Héri. Ce pays a pour ville principale Gagnan, fi
fameufe dans l’hiftoire orientale. Il eft arrofé de rivières
, de fources 8c de fontaines. Les montagnes
dont il eft rempli, ont été connues des anciens fous
le nom de Paropamifus, 8c le pays répond en effet §j
pour la plus grande partie , aux Paropamifades de
Quinte-Curce. Le Paropamife eft une branche dit
mont Taurus , toute couverte dé bois* Le peuple du
pays , dit Olearius , eft encore aujourd’hui aufl»
groflier qu’il étoit du tems d’Alexandre. ( D . J. )
SABLIER, f. m. ou Horloge .de sa ble', c’eft
proprement une clepfydre, dans laquelle on emploie
le fable au lieu d’eau. Voyc{ Clepsydre. (O ) '
Sa b l ie r , ( Ecriture. ) c’eft un petit vaifleau' oïl
l’on met du fable ou de la poufliere, qu’on répand
I fur l’écriture , afin de la fécher plus vite , ou d’ufer
du
du papier écrit, comme fi l’écriture étoit feche, la
poufliere attachée aux lettres buvant le fuperfiu de
l’encre, 8c empêchant que les lettres ne s’ effacent
SABLIERE,f. f. {Gram. & OEcon. rufiiq.)lieucreu-
fé dans la terre d’où l’on tire du fable.
Sablière , ( Charpent. ) piece de bois qui fe pofe
fur un poitrail, ou fur une aflïfe de pierres dures,
pour porter un pan de bois ou une cloilon. C’eft aufli
la piece qui à chaque étage d’un pan de bois , en reçoit
les poteaux, 8c porte les folives du plancher.
Sablière de plancher, piece de bois de fept à huit
pouces de gros, qui étant foutenue par des corbeaux
de fer, fert à porter les folives d’un plancher. Davi-
ler. {D. ƒ.)
Sablières, f. f. pl. ( Charpent. ) efpeces de membrures
qu’on attache aux côtés d’une poutre, pour
n’en pas altérer la force, 8c qui reçoivent par enclav
e , les folives dans leurs entailles. {D . Z.)
S A B L O N , f. m. ( Gram. ) fable blanchâtre 8c
groflier, dont on fe fert popr écurer la vaiffelle qui
en eft promptement détruite. On dit paffer au fablon.
SA B LON , ( Conchyliolog. ) en latin natica ; on
pourroit dire natice. C ’eft un limaçon à bouche demi
ronde ou ceintrée, qui différé de la nérite, en
ce qu’il n’a ni dents, ni palais chagriné, ni gencive,
ni umbilic comme elle. Il fe nourrit fur le rocher,
porte une opercule, 8c rampe comme le limaçon
nommé guignette à la Rochelle. Le co l, la bouche, le
mantelet qui l’enveloppent dans l ’intérieur de fa coquille
, reffemblent aufli beaucoup, excepté pour la
grandeur, à ces trois parties de la guignette. Ses
cornes font affez longues, pointues 8c très-fines ; l’animal
dans la marche les balance fans interruption
du haut en bas , 8c de bas en haut. Il eft rare que
dans ce mouvement l’une précédé l’autre. Elles fe
fuivent toujours avec beaucoup de jufteffe, comme
fi elles battoient en quelque forte une efpece de me-
furè. (Z). Z.)
SABLONES, ( Géog. anc. ) lieu de la Belgique.
Antonin le met fur la route de colonia Trajana à Cologne,
entre Mediolanum&C Mederiacum, k huit mille
pas de la première, 8c à dix mille pas de la fécondé.
On croit que c’eft Santen fur le Rhein ; du moins Or-
telius adopte ce fentiment. {D . Z.)
SABLONNER, v. aft. ( OEcon. domejliq. ) paffer
au fablon. C’eft une maniéré de nettoyer la vaiffelle
dans les cuifines. Si elle eft de cuivre, le fablon en-
leve l’étamage, 8c rend les vaiffeaux d’un ufage dangereux.
Si elle eft d’argent, elle perdfes formes, 8c
fouffre un déchet confidérable.
SABLONNEUX, adj. ( Gram. ) abondant en fable
ou fablon. \J neplainefablonneufe. Les lieux fablon-
neux rendent peu de fruits. 'Sablonneux fe dit aufli
pour pierreux, de certains fruits dont la pulpe eft dure
8c grumeleufe , telle eft la poire appellée doyenné.
SABLONNIER, f. m. ( Gram. ) homme qui va
puifer du fablon dans la riviere , ou qui en tire des
fablonriieres , 8c qui en fait commerce. y
SABLONNIERE, f. f. lieu d’où l’on tire le fable.
Sablonniere, {termede Fondeurs.) c’eft un grand
coffre de bois à quatre piés, garni de fon couvercle,
où les Fondeurs confervent, 8c fur lequel ils cor-
royent le fable dont ils font leurs moules. {D. Z.)
SABOR l e , ( Géog. mod. ) ou S or, petite riviere
de Portugal. Elle a fa fource en Efpagne , au royaume
de Galice, fur les confins des royaumes de Léon
8c de Portugal. Elle paffe à Bragance, s’accroît dans
fon cours de quelques ruiffeaux, 8c fe perd enfin
dans le Duero. {D. Z.)
SABORD, f. f. {Marine.') embrafure ou canonnière
dans le bordage d’un vaifleau , par laquelle paffe
un canon. La grandeur de cette embrafure eft proportionnée
au calibre du canon, La plupart des conf-
Tome XIV,
truéïeürs lui donnent trois piés deux pouces pour un
calibre de 48, trois piés pour un calibre de 3 6 , deux
piés neuf pouces pour un calibre de 24, deux piés
fept pouces pour un calibre de 18, &c. ainfi des autres
calibres à proportion. Il y a fur un vaifleau autant
de rangs de J,abords qu’il y a de ponts. Leur diftance
dans ces rangs eft d’environ fept p iés, 8c ils ne
font jamais percés les uns au-deffus des autres. Au
refte on appelle feuillets leur partie inférieure 8c fu-
gànexite.Voye^ encore Ba t t er ie .
On dit qu’il y a tant de fabords par bande : cela
lignifie qu’il y a un tel nombre de fabords par chaque
batterie. Voye^ Planche I. fig. 1. & fig, % , les fabords
& leurJituation, & Planche IV. fig. 1 , les fabords de la
première batterie, cottés ig y , & les fa bords de lafecoudt
cottés iÿ8.
SABOT, f. m. ( Hifl. nat. Bot. ) calceolus, genre
de plante à fleur polypetale, anomale, 8c compofée
de fix pétales inégaux , ‘dont quatre font difpofés en
croix; les deux autres occupent le milieu de la fleur*
L’un de ces deux pétales eft fourchu 8c placé fur l’autre
, qui eft gonflé 8c concave, 8c qui reffemble à un
fabot. Le calice devient dans la fuite un fruit ou une
efpece d’outre à trois angles auxquels adhèrent trois
panneaux qui s’ouvrent, 8c qui font chargés de fe-
mences aufli menues que de la feieure de bois. Tour*
nefort, in fi. reiherb. Voye[ Plante.
Sabot , f. m. ( Hifi. nat. bot. ) trocus} nom générique
que l’on a donné à différentes efpeces de coquilles.
Voye7 C oquille , & les figures 10, // & 12
de la X X L Planche.
S A B O T , (1Conchyliolog.) en latin trochus, genre
de limaçon de mer de forme conique, 8c qui ont la
bouche applatie en ovale.
Les cara&eres de ce genre de limaçons, font les
fuivans , félon M. Dargenville ; c’eft une coquille
univalve , dont la figure eft faite en cône ; le fommet
eft é lev é, quelquefois applati, ou tout-à-fait plat.
Sa bouche ovale eft à dents 8c fans dents, umbili-
quée, 8c ayant intérieurement la couleur d’un blanc
de perle.
La figure conique de ce genre de coquille 8c la
bouche applatie en ovale, déterminent fon caractère
générique.
Cette famille de limaçons que nous nommons ja bots
, renferme des efpeces fort fingulieres , qu’on
indiquera dans la fuite. Il y en a dont la tête en p yramide,
forme plufieurs fpirales, 8cce font-là les
vrais fabots; d’autres s’élèvent la moitié moins 8c confervent
mieux la figure des vrais limaçons ; d’autres
font entièrement applatis , tels que la lampe antique
8c l'efcalier ; il réfulte de-là que l’élévation de la figure
ne détermine pas le vrai caraétere d’un coquillage.
Il y a des efpeces de fabots qui font umbiliqués,
8c d’autres qui ne le font pas. Les Bretons appellent
forciere, une efpece de fabot qui eft petite 8c plate.
Voye[ SORCIERE.
Les claffes générales de fabots, font les trois fui-
vantes ; i° . celle des fabots dont le fommet eft élevé
; z°. celle des fabots dont le fommet eft moins
élevé , 8t qui ont la bouche grande, prefque ronde
8c umbiliquée ; 30. celle des fabots dont le fommet
eft applati.
Les principales coquilles de fabots à fommet élevé
, font ; i° . le fabot marbré ; 20. le fabot, tacheté
de roüge 8c de blanc à pointes étagées; 30. le fabot
pointillé ; 40. le fabot de couleur verte 8c chagriné.
On trouve aufli dans cette claffe le fabot plein de
noeuds dont la couleur eft, tantôt verte, tantôt rougeâtre
, tantôt cendrée, quelquefois jaune, 8c d’autres
fois couleur de rofe.
Parmi lesfabots de la fécondé claffe, on diftingue;
i° . la v eu ve , 20, la pie, 30. le tigre, 40. k fabot à
N n n