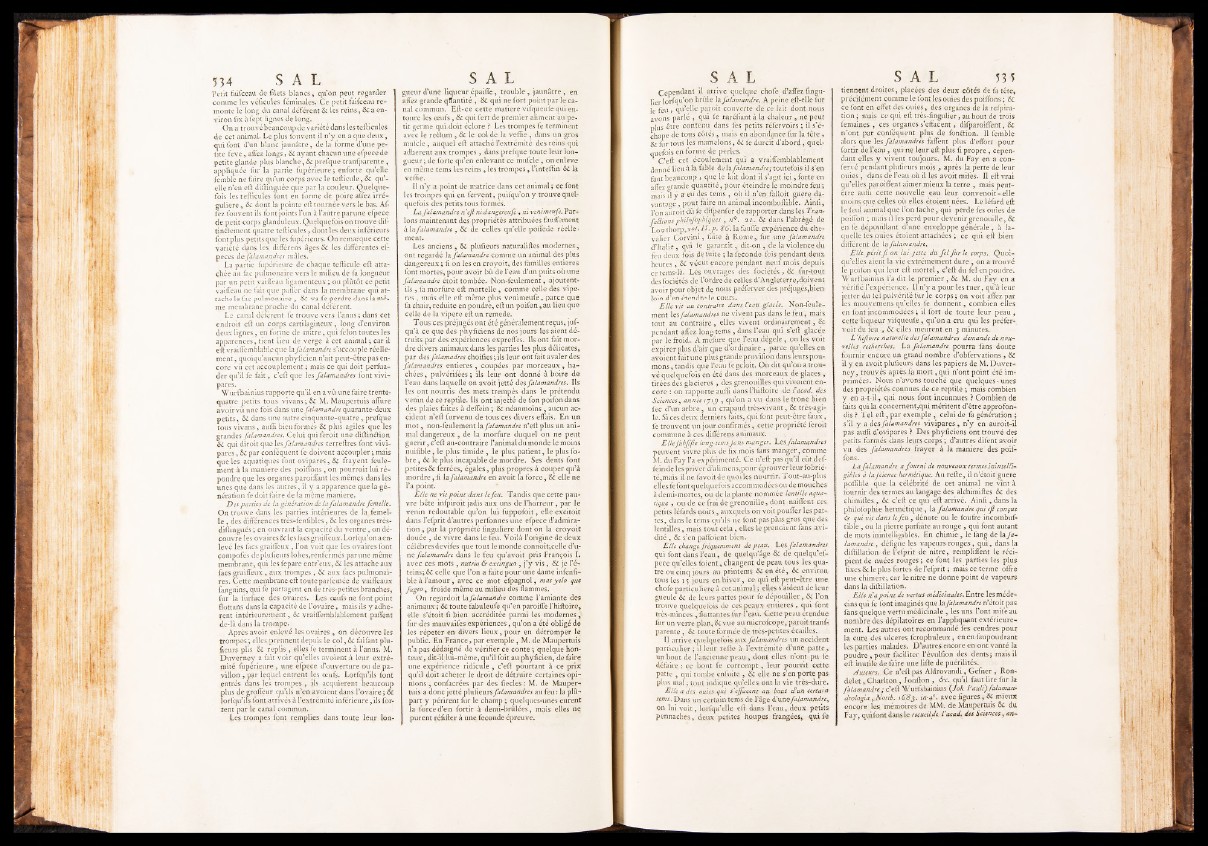
Petit faifceavt de filets blancs, qu’on peut regarder
comme les véficules féminales; Ce petit faifceau remonte
le long du canal déférent & les reins, 6c a environ
fix à fept lignes de long.
On a trouvé beaucoup de variété dans les tefticules
de cet animal. Le plus fouvent il n’y en a que deux,
■ qui font d’un blanc jaunâtre, de la forme d’une petite
feve , affez longs, 6c ayant chacun une efpecede
petite glande plus blanche, 6c prefque tranfparente ,
appliquée fur la partie fupérieure; enforte qu’elle
femble ne faire qu’un corps avec le tefticule, 6c qu’elle
n’en eft diftinguée que par la couleur. Quelquefois
les tefticules font en forme cle poire alfez irréguliere
, 6c dont la pointe eft tournée vers le bas. Af-
lez fouvent ils font joints l’un à l’autre parune efpece
de petit corps glanduleux. Quelquefois on trouve dif-
tinéfement quatre tefticules, dont les deux inférieurs
font plus petits que les fupcrieurs. On remarque cette
variété dans les différens âges 6c les différentes ef-
peces de falamandres mâles.
La partie fupérieure de chaque tefticule eft attachée
au fac pulmonaire vers le milieu de fa longueur
par un petit yaifi’eau ligamenteux ; ou plutôt ce petit
vaiffeaù ne fait que palier dans la membrane qui attache
le fac pulmonaire , & va fe perdre dans la même
membrane proche'du canal déférent.
Le canal déférent fe trouve vers l’anus ; dans cet
endroit eft un corps cartilagineux, long d’environ
deux lignes , en forme de mitre, qui félon toutes les
apparences, tient lieu de verge à cet animal ; car il
eft vraiffemblable que la falamandre s’accouple réellement
, quoiqu’auçun phyficien n’ait peut-être pas encore
vû cet accouplement ; mais ce qui doit perfua-
der qu’il fe fait, c’eft que les falamandres font vivipares.
Wurfbainius rapporte qu’il en a vû une faire trente-
quatre petits tous vivans ; & M. Maupertuis affure
avoir vû une fois dans une falamandre quarante-deux
petits, 6c dans une autre cinquante-quatre, prefque
fous vivans, aufti bien formés & plus agiles que les
grandes falamandrcs. Celui qui feroit une diftinélion
& qui diroit que les falamandrcs terre ftres font v ivipares
, 6c par conféquent fe doivent accoupler ; mais
que les aquatiques font ovipares, 6c frayent feulement
à la maniéré des poiffons, on pourroit lui répondre
que les organes paroiffant les mêmes dans les
unes que dans les autres, il y a apparence que la gé-,
nération fe doit faire de la même maniéré.
Des parties de la génération de la falamandre femelle.
On trouve dans les parties intérieures de la, femelle
, des différences très-fenfibles, 6c les organes trèsr
diftingués ; en ouvrant la capacité du ventre, on découvre
les ovaires & les facsgraiffeux.Lorfqu’on a enlevé
les facs graiffeux , l’on voit que les ovaires font
çompofés de plufieurs lobes,renfermés parune même
membrane, qui les fepare entr’ eux, & les attache aux
lacs graiffeux, âux trompes , 6c aux facs pulmonaires.
Cette membrane eft toute parfemée de vaiffeaux
ianguins, qui fe partagent en de très-petites branches,
fur la furtace des ovaires. Les oeufs ne font point
flottans dans la capacité de l’ovaire, mais ils y adherent
intérieurement, 6c vraiffemblablement paffent
de-là dans la trompe*
Après avoir enlevé les ovaires , on découvre les
trompes ; elles prennent depuis le co l, 6c faifant plusieurs
plis 6c replis , elles fe terminent à l’anus. M.
Duverney a fait voir qu’elles avoient à leur extrémité
fuperieure , une efpeçe d’ouverture ou de pavillon
, par lequel entrent les oeufs. Lorfqu’ils lont
entrés dams les trompes , ils acquièrent beaucoup
plus de groffeur qu’ils n’en avoient dans l’ovaire ; 6c
lorfqu’ils fontarrivés à l’extrémité inférieure, ils for-
lent par le canal commun.
Les trompes font remplies dans toute leur Iongueur
d’une liqueur épaiffe, trouble , jaunâtre , en
affez grande quantité , 6c qui ne fort point par le canal
commun. Eft-ce cette matière vifqueufe qui entoure
les oeufs , 6c qui fert de premier aliment au petit
germe qui.doit éclore l Les trompes fe terminent
avec le reélum » & le col de la velîie , dans un gros
mufcle, auquel eft attaché l’extrémité des reins qui
adhèrent aux trompes , dans prefque toute leur longueur
; de forte qu’en enlevant ce mufcle , on enlève
en même tems les reins , les, trompes, l’inteftin 6c la
veflie.
Il n’y a point de matrice dans cet animal ; ce font
les trompes qui en fervent, puifqu’on y trouve quelquefois
des petits tous formes.
La falamandre n e f ni dangerenfe, ni venimeufe. Parlons
maintenant des propriétés attribuées fauffement
à la falamandre , 6c de celles qu’elle poffede réelle*
ment.
Les anciens , 6c plufieurs naturaliftes modernes,
ont regardé la falamandre comme un animal des plus
dangereux ; fi on les en croyoit, des familles entières
font mortes, pour avoir bû de l’eau d’un puits où une
falamandre étoit tombée. Non-feulement, ajoutent-
ils , fa morfiire eft mortelle , comme celle des vipe*
res , mais elle eft même plus venimeufe, parce que
fa chair, réduite en poudré, eft un poifon, au lieu que
celle de la vipere eft un remede.
Tous ces préjugés ont été généralement reçus, juf-
qu’à ce que des phyficiens de nos jours les aient détruits
par des expériences expreffes. Ils ont fait mordre
divers animaux dans les parties les plus délicates,
par des falamadres choifies; ils leur ont fait avaler des
falamandrcs entières, coupées par morceaux , hachées
, pulvérifées ; ils leur ont donné à boire de
l’ eau dans laquelle on avoit jetté des falamandrcs. Ils
les ont nourris des mets trempés dans le prétendu
venin de ce reptile. Ils ont injeété de fon poifon dans
des plaies faites à deffein ; & néanmoins , aucun accident
n’eft furvenu de tous ces divers effais. En un
mot, non-feulement la falamandre n’eft plus un animal
dangereux, de la morfure duquel on ne peut
guérir, c’eft au-contraire l’animal du monde le moins
nuifible, le plus timide , le plus patient, le plus fo-
b re, 6c le plus incapable de mordre. Ses dents font
petites & ferrées, égales, plus propres à couper qu’à
mordre, fi la falamandre en avoit la force, 6c elle ne
' l’a point.
Elle ne vit point dans le feu. Tandis que cette pauvre
bête infpiroit jadis aux uns de,l’horreur, par le
venin redoutable qu’on lui fuppofoit, elle excitoit
dans l’efprit d’autres perfonnes une efpece d’admiration
, par la propriété finguiiere dont on la croyoit
douée , de vivre dans le feu. Voilà l’origine de deux
célébrés devifes que tout le monde connoît;celle d’une
falamandre dans le feu qu’avoit pris François I.
avec ces mots , nutrio & extinguo , j’y v is , 6c je l’éteins
celle que l’on a faite pour une dame infenfi-
ble à l’amour , avec ce mot efpagnol, mas yelo que
fugeo, froide même au milieu des flammes.
On regardoit la falamandre comme l’amiante des
animaux ; 6c toute fabuleufe qu’en paroiffe l’hiftoire,
elle s’étoit fi bien accréditée parmi les modernes,)
fiir des mauvaifes expériences, qu’on a été obligé de
les répéter en divers lieux, pour en détromper le
public. En France, par exemple, M. de Maupertuis
n’a pas dédaigné de vérifier ce conte ; quelque honteux,
dit-il lui-même, qu’il foit au phyficien, de faire
une expérience ridicule , c’eft pourtant à ce prix
qu’il doit acheter le droit de détruire certaines opinions
, confacrées par des fiecles : M. de Mauper-
tuis a donc jetté plufieurs falamandrcs au feu : la plû-
part y périrent fur le champ ; quelques-unes eurent
la force d’en fortir à demi-brûlées, mais elles nç
purent réfifter à une fécondé épreuve.
Cependant il arrive quelque chofe d’affez fingu-
lier lorfqu’on brille la falamandre. A peine eft-elle fur
le feu, qu’elle pjiroît. couverte de ce lait dont nous
avons parlé , qui fe raréfiant à la chaleur, ne peut
plus être contenu dans fes petits réfervoirs ; il s’é-
chape de tous côtés, mais en abondance fur la tête,
& fur tous les mamelons, 6c fe durcit d’abord, quelquefois
en forme de perle?. _ ■
C’eft cet écoulement qui a vraiffemblablement
donné lieu à la fable de la falamandre• toutefois il s’en
faut beaucoup ,.que le lait dont il s’agit ic i , forte'en
affez grande quantité, pour éteindre le moindre feu:;
mais il y a'eu des tems , ou il n’en falloit guere.da-:
vantaee , pç>ur faite un animal incombuftible. Ainli,
l’on auroit du fe chfpenfer de rapporter dans les Trany
factionspliilojbphiques , n9. z i . 6c dans l’abrégé; dç
LowthorpjVQl.ILp. 86. la fiiuffe expérience du chevalier
Côrvini, faite à Rome, fur une falamandre
d’Italie, qui fe garantit, dit-on , de la violence du
feu deux fois ffç fui1:? ; la fécondé, fois pendant deux
heures , 6c vécut encore pendant neuf mois depuis
ce tems-là. Lés ouvrages des, fociétés., 6c fur-ternt
des fo.çiétés de l’ordre de celles d’Angleterre,doivent
avoir pour objet çle nous préferver des préjugés,bien
lpin d’en étendre le cours.
Elle yit au çontraire dans l'ea.u glacée. Non-feulement
les falamandres ne vivent pas dans le feu , mais,
tout au contraire, elles vivent ordinairement, 6c
pendant affez long-tems , dans l’eau qui s’eft glacée
par le froid. A mefure que l’ eau dëgele , on les voit
expirer plus d’air que d’ordinaire , parce qu’elles, en
avoient fait une plus grande provifion dans leurspou-,
mons, tandis que l’eau fe geloit. Oh dit qu’on a trouvé
quelquefois en été dans des morceaux de glaces ,•
tirées des glacières , des grenouilles quivivoiént encore
: on rapporte aufti dans l’hiftoire de Pacad. des
Sciences, année , qu’on a vu dans le tronc bien
fec d’un arbre, un crapaud très-vivant, 6c très-agile.
Si ces deux derniers faits, qui font peut-être faux,
fe trouvent un jour confirmés, cette propriété feroit
commune à ces différens animaux.
Ellefubfijle long-temsjcns manger. Lesfalamandres
peuvent vivre plus de fix mois fans manger, comme
M. du Fay l’a expérimenté. Ce n’eft pas qu’il eût.def-
fein de les priver d’alimens,pour éprouver leur fobrié-
té,mais il ne f avoit-de quoiles nourrir. Tout-au-plus
elles fe font quelquefois accommodées.ou de mouches
à demi-mortes, ou de la plante nommée lentille aquatique
, ou de ce frai de grenouille,, dont naiflent ces
petits léfards noirs., auxquels on voit pouffer les pattes,
dans le tems qu’ils ne font pas plus gros que des
lentilles, mais, tout cela, elles le prenoient fans avidité
, 6c s’en paffoient bien.-
Elle change fréquemment de peau. Les falamandres
qui font dans l’eau, de quelqu’âge 6ç de quelqu’ef-
pece qu’elles foient, changent de peau tous les quatre
ou cinq jours, au pr-intems & en été, 6c environ,
tous les 1 5 jours en hiver, ce qui eft peut-être une.
chofe particulière à cet animal.; elles s’aident de leur
gueule 6c de leurs pattes pour fe dépouiller, 6ç l’on
trouve quelquefois de ces peaux- ent-ieres, qui font
très-minces , flottantes fur l’eau. Get-te peau étendue
fur un verre .plan, 6ç vue au microfcope, paroît tranfi
parente , 6ç toute formée de très-petites, écaillés.,
Il arrive quelquefois aux falamandres un accident
particulier ; i\ leur refte à l’extrémité d’une, patte.j;
un bout de Fancienne peau.,. dont elles n’ont pu le
défaire : ce bout fe corrompt, leur pourrit, cette
patte , qui tombe emfuite, & elle ne s’en porte pas.
plus mal ; tout indique qu’elles, ont la vie très-dure.
Elle a des ouïes qui s'effacent au bout d?un certain
tems. Dans un certain tems de l’âge d’une falamandre,
on lui v o it , lorfqu’elle eft dans l’eau, deux petits;
pennaches, deux petites, houpes frangées, qui fe
tiennent droites, placées des deux eôtés de fa tête,
précilement comme le font les ouies des poiffons ; 6c
ce font en effet des ouies, des organes de la refpira-
tion ; mais ce qui eft très-fingulier, au bout de trois
femaipes , çes organes s’effacent, difparoiffent, 6c
n’ont par conféquent plus de fonélion. Il femble
alors que les falamaridrês faffent plus d’effort pour
fortir de l’eau, qui ne leur eft plus fi propre , cependant
çlles y vivent toujours. M. du Fay en a con-
fervé pendant plufieurs mois , après la perte de leur
ouies, d?ns de l’eau où il les avoit mifes. Il eft vrai
qu’elles parpifiènt aimer mieux la terre , mais peut-
être aufti cette nouvelle eau leur convenoit - elle
moin^que celles où elles, étoient nées. Le léfard eft
le feul animal que l’on fâche, qui perde fes ouies de
poiffon ; mais il les perd pour devenir grenouille, 6c
en fe dépouillant d’une enveloppe générale, à laquelle
fes quies étoient attachées ;, çe qui eft bien
différent de la falamandre. ■
Elle,périt;fi onlitijette: du fe l furie corps.. Quoiqu’elles
aient la vie extrêmement dure , on a trouvé
le poifon qui leur eft mortel, e’eft du fel en poudre.
"Wurfbainius l’a-dit le premier , 6c M. du Fay en a
vérifié l’expérience. Il n’y a pour les tuer, qu’à leur
jetter du fel pulvérife fur le corps ; on voit affez par
les mouvemensqu’ elles fe donnent, combien elles
en font incommodées ; il fort de toute leur peau ,
cetteffiqueur vifqueule, qu’on a cru qui les préfer-
voit du feu -, 6c elles meurent en 3 minutes.
L'hijloire naturelle des falamandres demande de nouvelles
re'chefçhes. La falamandre pourra fans doute
fqurnir ençore un grand nombre d’obfervations , 6c
il y en ayoit plufieurs dans les papiers de M. Duverney.,
trouvés après la mort, qui n’ont point été imprimées.
Nous n’avons touché que quelques-unes
des propriétés connues de-ce reptile ; mais combien
y en a-t-il, qui nous font inconnues J Combien de
faits qui la cpncernent,qui méritent d’être approfondis
? Tel eft, par exemple , celui de fa génération ;
s’il y a des^falamandres vivipares , n’y en auroit-il
pas aufti d’ovipares 1- Des phyficiens ont trouvé des
petits formés dans leurs corps ; d’autres difent avoir
vu des falamandres frayer à la maniéré des poiffons.
La falamandre a fourni de nouveaux termes inintelli^
gibles à la fcience hermétique. Au refte, il n’étoit guere
poftible que la célébrité, de cet animal ne vînt à
fournir des termes au langage des alchimiftes & des
çhimiftes;, 6c ç’eft ce qui eft arrivé. Ainfi , dans la
philofophie hermétique, la falamandre qui ejl conçue
& qui vit dans le fe u , dénote ou le foufre incombuftible
, ou la pierre parfaite au rouge , qui font autant
de mots inintelligibles. En chimie , le fang de falamandre
, défigne les vapeurs rouges, q ui, dans la
diftillafion de l’efprit de nitre, rempliflent le récipient
de nuées rouges ; ce font les parties les plus
fixes 6ç le plus fortes de l’efprit ; mais ce terme offre
une chimere; car le nitre ne donne point de vapeurs
dans la difti.Uation.
Elle lia point de vertus médicinales. Entre les médecins
qui fe font; imaginés que la falamandre n’étoit pas
fans auelque vertu médicinale , les uns l’ont mifeau
nombre des dépilatoires en l’appliquant extérieurement.
Les autres ont recommandé lès cendres pouç
la cure des ulcérés, fcrophuleux, en en faupoudrant
les parties malades. D’autres.encore en ont vanté la
poudre , pour faciliter l’évulfion des dents; mais il
eft inutile de. faire une lifte de puérilités.
Auteurs. && n’eft pas Aldrovandi , Gefner , Rondelet
, Charbon , Jo.nfton , &c. qu’il faut lire fur la
falamandre; c’eft "Wurfsbainius; (Jok Pauli)falaman-
drolQgia^.Norib, 168y. in-40. avec figures, 6c mieux
encore les. mémoires de MM. de Maupertuis & du
Fay, qui font dans le ncueil.de. l'acad. des Sciences-, an