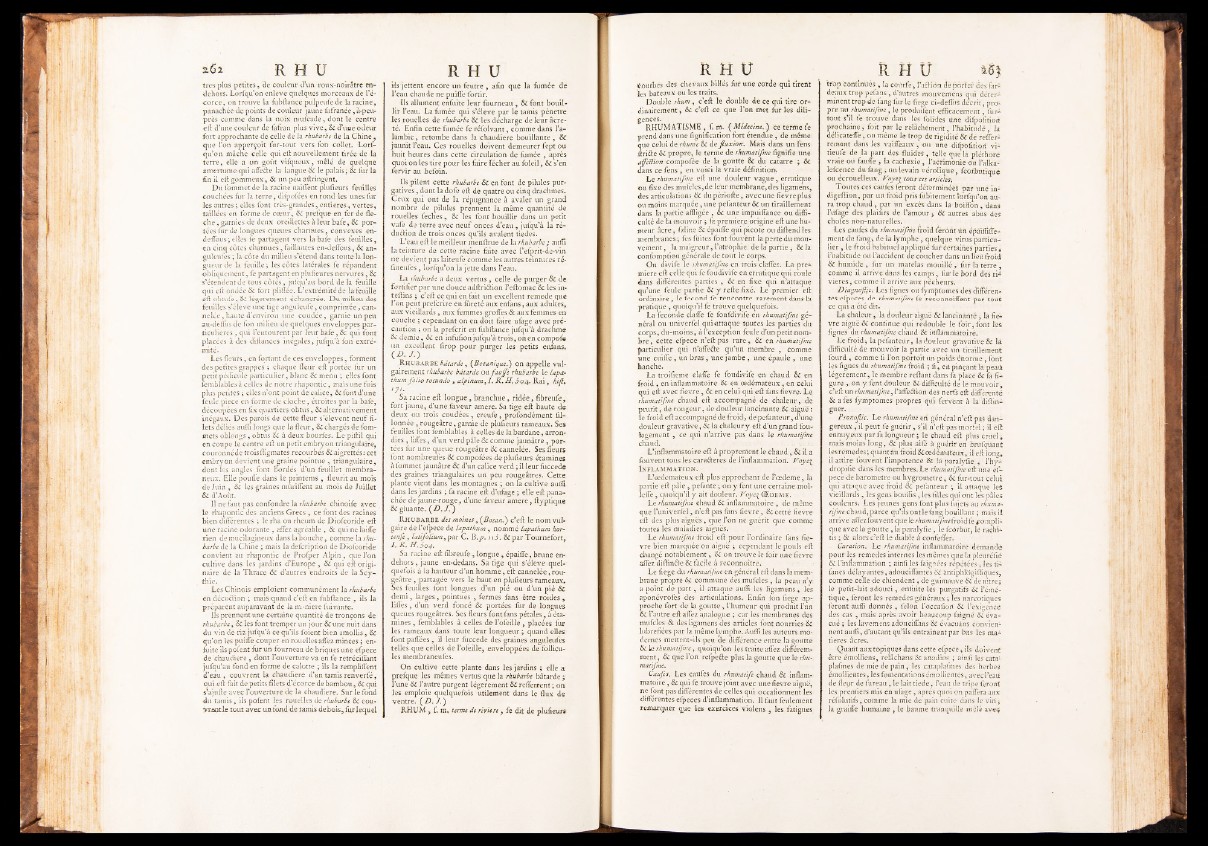
R H ü
très plus petites, 3e couleur d\m roux-noirâtre en-
dehors. Lorfqu’on enleve quelques morceaux de l’écorce
, on trouve la fqbftance pulpeulede la racine,
panachée<le points de couleur jaune fafranée, à-peu-
près -comme dans la noix mulcade, dont le centre
eft d’une couleur de fafran plus v iv e , & d’uneedeur
fort approchante de celle de la rhubarbe de la Chine ,
que l’on apperçoit fur-tout vers fon collet. Lorfqu’on
mâché celle qui eft nouvellement tirée de la
terre, elle a-un goût vifqweux, mêlé de quelque
amertume-qui affeéte la langue & le palais; & fur la
fin il eft gommeux, & un peu aftr-ingertt.
Du fommet de la racine naiffent plufieurs feuilles
couchées fur la terre, difpofées en rond les unes fur
les autres; elles font très-grandes, entières-, vertes,
taillées en forme de coeur, 6c prefque en fer de fléché
, garnies de deux oreillettes à leur bafe, 6c portées
fur de longues queues charnues, convexes en-
deflous; elles le partagent vers la baie des feuilles ,
en cinq côtes charnues, faiUantes en-deflous, 6c an-
guleufes ; la côte du milieu s’étend dans toute la longueur
de la feuille ; les côtes latérales le répandent
-obliquement, fe partagent en plufieures nervures, 6c
détendent 3 e tous côtes, jufqu’au bord de la feuille
qui eft ondée 6c fort pliftee. L’extrémité de la feuille
eft obtufe, 6c légèrement échancrée. Du milieu des
feuilles s’élève une tige anguleufe, comprimée, cannelée
, haute d’environ une coudée, garnie un peu
au-defliis de fon milieu de quelques enveloppes particulières
, qui l’entourent par leur bafe, 6c qui font
placées A des diftances inégales, jufqu’à fon extrémité.
Les fleurs, en fortant de ces enveloppes, forment
des petites grappes ; chaque fleur eft portée fur un
petit pédicule particulier, blanc 6c menu ; elles font
femblables à celles de notre rhapontic, mais une fois
plus petites ; elles n’ont point de calice, 6c font d’une
feule piece en forme de cloche, étroites par la bafe,
découpées en fix quartiers obtus, 6c alternativement
inégaux. Des parois de cette fleur s’élèvent neuf filets
déliés aufli longs que la fleur, 6c chargés de fom-
mets oblongs , obtus 6c à deux bourfes. Le piftil qui
en coupe le centre eft un petit embryon triangulaire,
couronnéde troisftigmates recourbés &aigrettés: cet
embryon devient une «raine pointue , triangulaire,
•dont les angles font Bordés d’un feuillet membraneux.
Elle pouffe dans le printems , fleurit au mois
de Juin , 6c les graines mûriflènt au mois de Juillet
6c d’Août.
Il ne faut pas confondre la rhubarbe chinoife avec
le rhapontic des anciens Grecs , ce font des racines
bien différentes ; le rha ou rheum de Diofcoride eft
une racine odorante , aflèz agréable , & qui ne laifle
rien de mucilagineux dans la bouche, comme la rhubarbe
de la Chine ; mais la defeription de Diofcoride
convient au rhapontic de Profper Alpin, que l’on
cultive dans les jardins d’Europe , 6c qui eft originaire
de la Thrace 6c d’autres endroits de la Scy-
thie.
Les Chinois emploient communément la rhubarbe
en décoélion ; mais quand c’eft en fubftance , ils la
préparent auparavant de la mi-niere fuivante.
Ils prennent une certaine quantité de tronçons de
rhubarbe, 6c les font tremper un jour & une nuit dans
du vin de riz jufqu’à ce qu’ils foient bien amollis, &
qu’on les puiflè couper en rouelles allez minces ; en-
lûite ilspofent fur un fourneau de briques une efpece
de chaudière , dont l ’ouverture va en fe retréciffant
jufqu’au fond en forme de calotte ; ils la remplirent
d’eau , couvrent la chaudière d’un tamis renverfé,
qui eft fait de petits filets d’écorce de bambou, 6c qui
s’ajufte avec l’ouverture de la chaudière. Sur le fond
du tamis, ils pofent les rouelles de rhubarbe 6c couvrant
le tout avec un fond de tamis debois, fur lequel
R H U
Hs jettent encore un feutre , afin que la fumée de
l’eau chaude ne puiflè fortir.
•Ils allument enfuite leur fourneau, 6c font bouillir
l’eau. La fumée qui s’élève par le tamis pénétré
les rouelles de rhubarbe 6c les déchargé de leur âcre-
té. Enfin cette fumée fe réfolvant, comme dans l’alambic
, retombe dans la chaudière bouillante , 6c
jaunit l’eau. Ces rouelles doivent demeurer fept ou
huit heures dans cette circulation de fumée , après
quoi on les tire pour les faire lécher au foleil, 6c s’en
fervir au befoin.
Ils pilent cette rhubarbe 6c en font de pilules purgatives
, dont la dofe eft de quatre ou cinq drachmes.
Ceux qui ont de la répugnance à avaler un grand
nombre de pilules prennent la même quantité de
rouelles feches , & les font bouillir dans un petit
vafe de terre avec neuf onces d’eau , jufqu’à la ré-
duftion de trois onces qu’ils avalent tiedes.
L ’eau eft le meilleur menftrue de la rhubarbe ; aufli
la teinture de cette racine faite avec l’efprit-de-vin
ne devient pas laiteufe comme les autres teintures ré-
■ ûneufes., lorfqu’on la jette dans l’eau.
La rhubarbe a deux vertus , celle de purger 6c de
fortifier par une douce adftriftion l’eftomac 6c les in-
teftins ; c’eû ce qui en fait un excellent remede que
l’on peut preferire en fureté aux enfans, aux adultes,
aux vieillards, aux femmes groflès & aux femmes en
couche ; cependant on en doit faire ufage avec précaution
; on la preferit en fubftance jufqu’à drachme
6c demie, 6c en infitfion jufqu’à trois, on en compofe
un excellent lirop pour purger les petits eniàns.
Rhubarbe bâtarde, (Botanique.) on appelle vulgairement
rhubarbe bâtarde ou fauffe rhubarbe le lapathumfolio
rotundo , alpinum, I. R. H. S 04. Ra i, hiß, BS
a racine eft longue , branchue, ridée, fibreufe,
fort jaune, d’une faveur amere. Sa tige eft haute de
deux 011 trois coudées, creufe, profondément fil-
lonnée , rougeâtre, garnie de plufieurs rameaux. Ses
feuilles font femblables à celles de la bardane, arrondies
, liftes, d’un verd pâle 6c comme jaunâtre, portées
lur une queue rougeâtre 6c cannelée. Ses fleurs
font nombreufes 6c compofées de plufieurs étamines
à fommet jaunâtre 6c d’un calice verd ; il leur fuccede
des graines triangulaires un peu rougeâtres. Cette
plante vient dans les montagnes ; on la cultive aufli
dans les jardins ; fa racine eft d’ufàge ; elle eft panachée
de jaune-rouge, d’une faveur amere, ftyptique
& g lu an te - (D ./ .)
Rhubarbe des moines, ('Botan.) c’eft le nom vulgaire
de l’efpece de lapathum, nommé lapathum hor-
tenfe, laùfolium, par C. B.p. u 5 . 6c par Tournefort,
I. R. H. S04.
Sa racine eft fibreufe , longue, épaiflè, brune en-
dehors , jaune en-dedans. Sa tige qui s ’élève quelquefois
à la hauteur d’un homme, eft cannelée, rougeâtre
, partagée vers le haut en plufieurs rameaux.
Ses feuifles font longues d’un pié ou d\in pié 6c
demi, larges, pointues , fermes fans être roides ,
liftes, d’un verd foncé 6c portées fur de longues
queues rougeâtres. Ses fleurs font fans pétales, à étamines
, femblables à celles de l’ofeille , placées fur
les rameaux dans toute leur longueur ; quand elles
font paftées , il leur fuccede des graines anguleufes
telles que celles de l’ofeille, enveloppées de follicules
membraneufes.
On cultive cette plante dans les jardins ; elle a
prefque les mêmes vertus que la rhubarbe bâtarde ;
l’une 6c l’autre purgent légèrement 6c refferrent ; on
les emploie quelquefois utilement dans le flux de
ventre. ( D. J. )
RHUM, f. m, terme de riyiere, fe dit de plufieurs
R H U
tourbes des chevaux biliés fur une corde qui tirent
fes bateaux ou les traits»
Double rhum, c’eft le double de ce qui tire or
dinairement, & c’eft cé que l ’on met fur les diligences.
RHUMATISME , f. m. ( Médecine. ) ce terme fe
prend dans une fignification fort étendue, de même
que celui de rhume 6c de fluxion. Mais dans un fens
ftriéle 6c propre, le terme de rhumatifme lignifie une
affection compofée de la goutte & du catarre ; 6c
dans ce fens , en voici la vraie définition^ .
Le rhumai fme eft une douleur vague, erratique
tou fixe des miifcles,de leur membrane, des ligamens,
des articulations 6c dupériofte, avec une fievre plus
ou moins marquée, une pefanteur 6c un tiraillement
dans la patrie affligée , & une impuiffance ou difficulté
de la mouvoir ; fa première origine eft une hu*
meur âcre, faline 6c épaiflè qui picote ou diftend les
membranes ; fes flûtes font fouvênt la perte du mouvement
, la maigreur, l’atrophie. de la partie * 6c la
confomption générale de tout le corps.
On divife le rhumatifme en trois claffes'. La pre»
miere eft celle qui fe foudivife en erratique qui roule
dans différentes parties , 6c en fixe qui n’attaque
qu’une feule partie & y relie fixé. Le premier eft
ordinaire, le fécond fe rencontre rarement dans la
pratique -, quoiqu’il fe trouve quelquefois» 11,
La fécondé cîaffe fe foufdivife en rhumatifme général
ou univerfel qui-attaque toutes les parties du
corps, du-moins, à l’exception feule d’un petit nombre,
cette efpece n’eft pas rare , 6c en rhumatifme
particulier qui n’affeéte qu’un membre , comme
une cuiffe , un bras, une jambe , une épaule , une
hanche.
La troifieme claffe fe foudivife en chaud 6c en
froid , en inflammatoire 6c en oedémateux , en celui
qui eft avec fievre, 6c en celui qui eft fans fievre. Le
rkumaiifme chaud eft accompagné de chaleur , de
prurit, de rongeur, de douleur lancinante. & aigiie :
le froid eft accompagné de froid, de pefanteur, d’une
douleur gravative, 6c la chaleur y eft d’un grand foula
gement , ce qui n’arrive pas dans le rhumatifme
chaud.
L’inflammatoire eft à proprement le chàud, 6c il a
fouvent tous les caraêleres de l’inflammation. Foyer
In f l a m m a t io n .
L’oedemateux eft plus approchant de l’oedeme, la
partie eft pâle , pefante ; on y fent une certaine mol-
leflè, quoiqu’il y ait douleur. Voyt{ CEd em e .
Le rhumatifme chaud 6c inflammatoire , de même
que l’univerfel, n’eft pas fans fievre, 6c cette fievre
eft des plus aiguës, que l’on ne guérit que comme
toutes les maladies aiguës.
Le rhumatifme froid eft pour l’ordinaire fans fie-
vre bien marquée ou aiguë ; cependant le pouls eft
changé notablement, 6c on trouve le foir une fievre
aftez diftincle 6c facile à reconnoître»
Le fiege du rhumatifme en général eft dans la membrane
propre 6c commune des mufcles , la peau n’y
a point de pa rt, il attaque aufli les ligamens, les
aponévrofes des articulations. Enfin Ion fiege ap*
proche fort de la goutte, l’humeur qui produit l’un
6c l’autre eft aflèz gnalogue ; car les membranes des
mufcles & des ligamens des articles font nourries 6c
lubrefiées par la même lymphe. Aufli les auteurs modernes
mettent-ils peu de différence entre la goutte
& le rhumatifme, quoiqu’on les traite aflèz différemment
, 6c que l’on refpeéte plus la goutte que le rhu-,
matifme.
Caufes. Les caufes du rhumatife chaud 6c inflammatoire
, 6c qui fe trouve joint avec une fievre aiguë,
ne font pas différentes de celles qui occafionnent les
différentes efpeces d’inflammation. Il faut feulement
remarquer que les exercice« violens , les fatigues
R D Ü m
trop continués , la côilrfe, l’aéridn déporter dés Fardeaux
trop' pefans, d’autres mouvemens qui déter-
minent trop de fang fur le fiege ci-deffuà detrit, pro^
pre au rhumatifme, le produifent efficacement, fur-
tout s’il fe trouvé dans les folides line difpofitiort
prochaine ; foit par le relâchémeiit, l'habitude, la
délicateflè, ou même le trop de rigidité & dé relfer*
rement dans les vaiffeaux, ou une difpofitiori vi-
tieufe de la part des fluides , telle que là pléthore
vraie où faufle ; la cachexie, l’acrimonie ou l’alka-
lefcence du fang ; Un levain vérolique, feorbutique
ou écrouelleux. Voye^tous ces articles-.
Toutes ces caufes feront défèrminéèS par unë in*
digeftion, par urt froid pris fubitement forfqu’on aura
trop chaud, par un excès dans la boiffon, dans
l’iifage des plaifirs de l’amour, 6c autres abus des
choies nOn-naturelles. •
Les çaufe's du rhumatifme froid feront lin épâiflîfïe-
ment du fangi, de la lymphe, quelque virus particulier
, le froid habituel applique' fut Certaines parties j
l’habitude ou l’accident de coucher dans un lieù froid
& humide , fur un matelas mouillé ,■ fur la terre ,
comme il arrive dans les camps, furie bord des ri*
vieres, comme il arrive aux pêcheurs.
Diagnofiic. Les fighes ou fy mptomes des différentes
efpeces de rhumatifme fe reeonnoiffent par tout
ce qui a été dit,
La chaleur, la doüleiir aigue & lancinante ; la fièvre
aiguë 6c continue qui redouble le foir ; font les
lignes du rhumatifme chaud 6t iuflàmniâtoiré.
Le froid j la pefanteur , là douleur gravative & là
difficulté de mouvoir la partie avec un tiraillement
lourd , comme fi l’on pprtoit un poids énorme , font
les fignes dii rhumatifme froid ; f i, eii pinçant là peait
légèrement, le membre reliant dans fa placé & fa fi*
gure,,r.©n y font,douleur ôtdifficulté de le mouvoir-,
c’eft un rhumatifme, l’àffeétioh -des nerfs eft différentë
& a fes fymptomes propres qui ferVÈnr à la diftin-
guer..
Pronoflie. Le rhumatifme en général n’eft pas dan*
gereux , i l peut fe guérir, s’il n’eft pas mortel ; il eft
ennuyeux par fa longueur ; le chaud eft plus cruel ;
mais moins long, 6c plus àifé'à guérir eh briifquant
Iesrëmedes; quantàu froid & oedémateux, il-eft long,
il attire fouvent l’impotence &c là paralyfie , I’hy*
dropilié dans les membres. Le rhumatifme eû line efpece
de baromètre ou hygromètre, 6c fur-tout celui
qui attaque avec froid 6c pefanteur ; il attaque leâ
vieillards, lés gens bouffis , les filles qui ont les pâles
couleurs» Les jeunes gens font plus fujets au rkuma'■
tiftne chaud, parce qu’ils ont le fang bouillant; mais il
arrive aflèz fouvent que le rkümaufrnê froid fe $0 mpli-
que avec la goutte , la paralyfie, le fedrbut, lé rachi*
tis ; & alors c’eft le diable à confefleri
Curation. Le rhumatifme inflammatdire démandè
pouf les remedes internes les mêmes que la pleuréfië
6c l’inflammation ; ainfi les faignées répétées , les ti-
fanes délayantes, adouciffantes 6c àntiphlôgiftiques,
comme celle de chiendent, de guimauve 6c de nitre;
lé petit-lait adouci, enliiite les purgatifs 6c l’émétique,
feront les remedes généraux ; les narcotiques
feront aufli donnés , félon l’occafiort 6c l’exigence
des cas , mais après avoir beaucoup faigné 6c évacué
; les lavemens adduciffans 6c évacuàns convient
nent aufli, d’autant qu’ils entraînent par bas les ma*
tieres acres.
Quarit aux topiques dans cette efpece, ils doivent
être émolliens, relâchans 6c anodins ; ainfi les cata:
plafmes de mie de pain, les eataplafiiies des herbes
émollientes, les fomentations émollierttës, avec l’eaii
de fleyr de fureau, le lait tiede, l’eau de tripe feront
les prenûers rriis én ufage, après quoi on pafferaaux
réfolutifs, comme la mie de pain cuite dans le v in ,
la graiflè humaine , le baume tranquille mêlé aygÇf