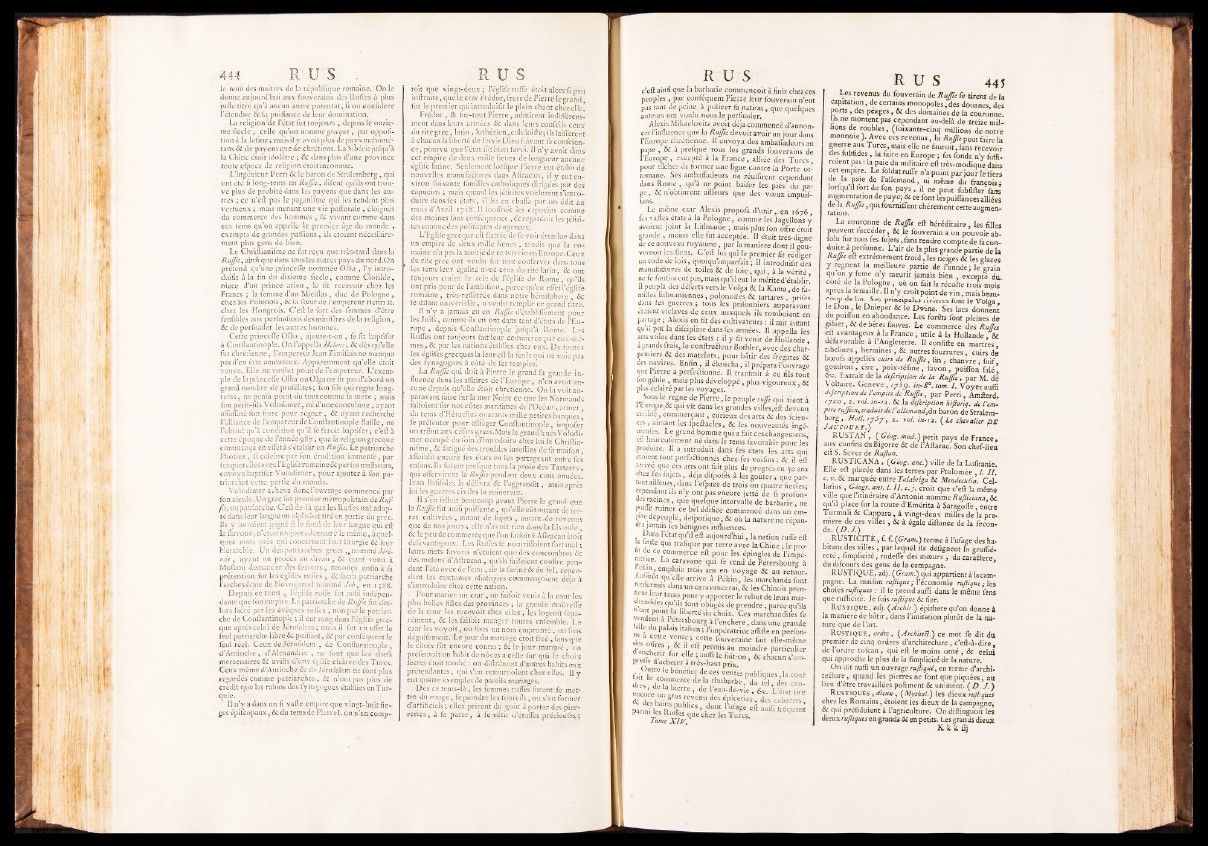
le nom des maîtres de la république romaine. On le
donne aujourd’hui aux fouverains des Rufl.es à plus
jufte titre qu’à aucun autre potentat, fi on eonfidere
l’ctendue & la puiffance de leur domination.
La religion/de l’état fut toujours , depuis le onzie*-
me fiecle , celle qu’on nomme grecque , par oppofi-
tion à la latine ; mais il y avoit plus de pays mahoméi
tans & de payens que de chrétiens. La Sibérie jufqu’à
la Chine étoit idolâtre ; & dans plus d’une province
toute efpece de religion étoit inconnue.
L’ingénieur Perri & le baron de Stralemberg, qui
ont été li long-tems en Ruffie, difent qu’ils ont trouvé
plus de probité dans les payens que dans les autres
.; ce n’eft pas le paganiime qui les rendoit plus
vertueux ; mais menant une vie paftorale , éloignés-
du commerce des hommes , & vivant comme dans
ces tems qu’on appelle le premier âge du monde ,
exempts de grandes pallions, ils étoient néceffaire-
ment plus sens de bien.
Le Chriuianifme ne fut reçu que très-tard dans la
Ruffie, ainli que dans tous les autres pays du nord.On
prétend qu’une princeffe nommée Olha , l’y intro-
duifit à la fin du dixième fiecle, comme Clotilde,
niece d’un prince arien , le fit recevoir chez les,
Francs ; la femme d’un Miciflas, duc de Pologne ,
chez les Polonois, & la foeur de l’empereur Henri II.
chez les Hongrois. C’elî: le fort des femmes d’être
fenfibles aux perfuafions des miniftres de la religion,
& de perfuader les autres hommes. 1
Cette princelfe Olha , ajoute-t-on , fe fit. baptifer
à Conllantinople. On l’appella Helene ; & dès qu’elle
fut chrétienne, l’empereur Jean Zimifcésne manqua
-pas d’en être amoureux. Apparemment qu’elle étoit
veuve. Elle ne voulut point de l’empereur. L’exemple
de la princeffe Olha ou Olga ne fit pas d’abord un
grand nombre de profélites ; Ion fils qui régna long-
tems , ne penfa point du tout comme fa mere ; mais
fon petit-fils Volodimer, né d’une concubine , ayant
affaffiné fon frere pour régner, & ayant recherché
l’alliance de l’empereur de Conllantinople Bafile, ne
l’obtint qu’à condition qu’il fe feroit baptifer; c’eft à
cette époque de l’annéé 987, que la religion grecque
commença en effet à s’établir en Ruffie. Le'patriarche
Photius , fi célébré par fon érudition immerife, par
fes querelles avec l'Eglife romaine & par fes malheurs,
envoya baptifer Volodimer, pour ajouter à fon pa-
triarchat cette partie du mônde.
Volodimer acheva donc l’ouvrage commencé par
fon aïeule. Un grec fut premier métropolitain de Ruffie,
oupatriarche. C’eft de-là que les Ruffes ont adopté
dans leur langue un alphabet tiré en partie du grec.
Ils y auroient gagné fi le fond de leur langue qui eft
la flavone, n’étoit toujours demeuré le même, à quelques
mots près qui concernent leur liturgie & leur
hiérarchie. Un des patriarches grecs ,, nommé Jérémie
, ayant un procès au divan, & étant venu à
Mofcou demander des fecours , renonça enfin à fa
prétention fur les églifes ruffes , &facra patriarche
l’archevêque de Nôvogôrod nommé Job, en 1588.
Depuis ce. tems , l’égiife ruflè fut auffi indépendante
que fon empire. Le patriarche de Ruffie fut dès-
lors facré par les évêques Tuffes , non par le patriarche
de Conllantinople ; il eut rang dans l’églife grecque
après celui de Jérufalem ; mais il fut en effet le
feul patriarche libre & puiffant, & par cohféquent le
feul réel. Ceux de Jérufalem , de Conllantinople ,
-d’Antioche, d’Alexandrie , ne font que-les chefs
mercenaires & avilis d’une églife efclave'dès Turcs.
Ceux même d’Antioche & de Jérufalem ne Rrntplus
regardés comme patriarches, & n’ont pas plus de
crédit que les rabins des fynagogues établies en Turquie.
’
Il n’y a dans un fi vafte empire que vingt-huit lièges
épilcopaux, & du tems de Pierrel. on n’en.e.omptoit
que vingt-deux ; l’égliferufie étoit alors fi peu
inllruite, que le czar Frédor, frere de Pierre le grand
fut le premier quiintroduilit le plein chant chez elle.
Frédor , & fur-tout Pierre, admirent indifféremment
dans leurs armées & dans leurs confeils ceux
du rite grec, latin, luthérien, calvinifte; ils laiflerënt
à chacun la liberté de fervirDieufuivant fa confidence
, pourvu que l’état fût bien fervi. Il n’y avoit dans
cet empire de deux mille lieues de longueur aucune
églife latine. Seulement loffque Pierre eut établi de
nouvelles manufaôures dans Aftracan, il y eut environ
foixante familles catholiques dirigées par des
capucins ; mais quand les jéfuites voulurent s’introduire
dans fes états-, if les en chaffa par un édit au
mois d’Avril 1718. Iffouffroit îes capucins comme
■des moines fans conféquence, êèregardoit les jéfuites
comme des politiques dangereux.
L’Eglife grecque eft flattée de fe voit étendue dans
un empire de deux mille lieues , tandis que la romaine
n’a pas la moitié de ce terrein en Europe. Ceux
du rite grec ont voulu fur-tout confervèr dans tous
les tems leur égalité avec ceux du rite latin, & ont
toujours craint le; zele de l’églife de Rome, qu’ils
ont pris pour de l’ambition, parce qu’en effet l’églife
romaine , très-refferrée dans notre hémifphere , Sé
fe difant univerfelle, a voulu remplir ce grand titre;
Il n’y a jamais^ eu en R u ß e d’établiffement pour
les Juifs, comme ils en ont dans tant d’états de l’Europe
, depuis Ccnftantinople jufqu’à Rome.' Les
Ruffes ont toujours fait leur commerce par eux-mé-
mes, & par les nations établies chez eux. De toutès
les églifes grecques la leur eft la feule qui ne voie pas
des fynagogues à côté de fes temples.
La R u ß e qui doit à Pierre le grand fa grande influence
dans les affaires de l’Europe , n’en avoit ai£
cune depuis qu’elle étoit chrétienne. On la voit auparavant
faire fur la mer Noire ce que les Normands
faifoient fur nos côtes maritimes de l’Océan, armer
ciu tems d’Heraclius quarante mille petites barques -,
fe préfenter poiir affiéger Conftantinople, impofer
un tribut aux céfars grecs.Mais le grand knes Volodimer
occupé du foin d’introduire chez lui le Chriftia-
nifme, & fatigué des troubles inteftins de fa maifon,
affoiblit encore fes. états en les partageant entre fës
enfans. Ils furent prefque tous la proie des Tartares',
qui affervirent la R u ß e pendant deux cens années.
Ivan Bafilides la délivra & l’aggrandit, mais après
lui les guerres civiles la ruinèrent.
11 s’en falloit beaucoup avant Pierre le grand que
la Ruffie f ii i auffi puiffante , qu’elle eût autant de ter-
res cultivées , autant de fujets , autant rde revenus
que de nos jours ; elle n’a voit rien dansria Livonie,
& le peu de commerce que l’on faifoit à Aftracan étoit
defavantageux. Les Ruffes fe nourriffoient fort mal ;
leurs mets favoris n’étoient que des concombres Sc
des melons d’Aftracan , qu’ils faifoient confire pendant
l’été avec de l’eau , de la fariné & du fiel, cependant
les coutumes afiatiques commençoient déjà à
s’introduire chez cette nation.
Pour marier un czar, on faifoit venir à la cour les
plus belles filles des provinces ; la grande ihaîtrefle
-delà cour les rèeevoit chez elles , les logeoitfépa-
?rément ,.& les faifoit manger toutes ensemble. Lè
czar les voyoit, ©û fotts un nom emprunté ou-fanfc
déguifement. Le jour du mariage étoit fixé, fans que
de choix fut encore connu ; Sc le jour-marqué , on
préfentoitun habit de noces a celle fur qui -le choix
Leeret étoit tombé : on diftribuoit d’autres habits aux
prétendantes, qui s’en retournoient chez elles. 11 y
eut.quatre exemples de pareils mariages.
Dès ce tems-là , les iemmes.ntffes furent- fe mets*
tre du rouge, fe peindre-les fourcils, ou s’en former
d’artificiels; elles prirent du goût à porter des pierreries.,
à fe parer, à fe vêtir d’étoffes précieufes,;
ç’efi ainfi gueria barbarie, coninu-nçoit à finir chez ces
peuples, .par conlèquertt Pierre' (eiirfouveràin n’eut
pas tant ae peine à policerfanatioii , que-CjUclGucs
auteurs oui voulu nous le periuader. .. ; ■
Alexis Mjhaelovitz àvftit ÿ ija conunenci dlannon-
cer l’influencp que la /laj/îc tkyo'it aTOir „ „ jour dans
fËurope chrétienne. 11 euvo.ya des ambatuideurs au
pape , & à prefque tous les grands fotixêraïns de
l’Europe , excepté à là. France, aîiiée des Turcs
pour tacher de former une ligue contre la Porte ottomane,.
Ses ainbatïitùeurs ne rcutTircnt cepw.dant
dans Roine , qu’à ne point baïfer les piéfcdjtjpa-
pe, fié n obtinrent ailleurs que des vtx-ux impuil-.
lâns. ^ ..................... r
Le même czar'Alexis propofa d’unir,, en 1S.76
fes vaties états à la Pologne, comme les Jageiions y
avoient joint la Lithuanie ; mais plus fon Ofire étoit
grande , moins elle fut acceptée. Il étoit très-digne
de ce nouveau royaume, par la maniéré dont il gou-
vernoit les liens, C ’efr lui qui le premier fit rédiger
mi code de lois , qitoiqubmparfait ; il introdvdfit des
manufactures de toiles & de, foie , qui, à la vérité
ne fe foutinrent pas, mais qu’il eut le mérite d’établir,
fl peupla deS' delerts vers lé Wolga & la Kama, de familles
lithuaniennes, polonqifes.& taftarès, p r ie !
daiis fes. guerre s ; tous les prilônniers auparavant
étaient efclaî§ÿ.de ceux auxquels ils tomboiént ,ea
partage ; Alexis en fit des cultivateurs : il mit,autant
qu’il put la difcipline dans fes armées,, Ht. appellà les
arts utiles dans les états ,:,il y.fityehir, deifollànde ,
àgitpds frai% le, conflruàeur Bothjer, avec, des charpentiers
& des matelots ; pour bâtir des frégates Sc
Enfi" , ü ébaucha, il prépara l’ouvrage
que Pierre a perfeaionhé. il tranfmit à ce fils tofit
, ■ ■ H ■ développé, plus, vigoüreui Sc
plus éclaire par les voyages.
dé Pierre,, lé peuple n jfi, qui tient à
1 Europe,& qui vit dans les grandes villes,eft devenu
crnlifé, eommergus , Curieux desarts, & des fttiçn-
ces, aimant les fpeaaetes, & les nouveautés ingé-
W Ê êl Lé grand homme qui a f a i t ^ changemens,
ef. hepreufement né dans le re,ms favorable pourries'
ÇrSÇSJiire. Il a intf%duitrd»ns fes états, ies.àrts: qu:'
ctoient tout perieclipnnés chez fe.s yo.ilins.; & il éfi
arrivé .que.ces à*|;épt fait plus de progrès en 50dm
chez tes fitjets, déjà diipoips à les goûter, tnte partout
ailleurs , dans l ’efpace de trois, ou quatre ftedes:
cepenuan: iis n’y ont pas encore jette de fi profon-
. racin?§# que quelque intervalle de barbarie., né
puilie ruiner ce bel édifice commencé: dans un em-
pire depeupie, despotique, Sc oit la naturene répan-
«ra jamais fes bénignes influences.
Dans l’é à t qu’il eft aujoijrd’hui, la nation ruffe eft
M feule qui trafique par terre avec la Chine ;rie prô-
M de ce commerce eft pour les épingles de l’iroÿé-
.rice. La caravane qui fe rend de PétersboUrg à
tn - n! emploie,trois ans en voyage & au retour,
u htot qu elle arrive à Pékin, les marchands font
rcntermes dans un caravancerai, & les Chinois pren-
. ent leur teins pour y apporter le rebut de leurs mar-
»W * G-S ^.^Ht obligés dé prendre, parce qu’ils
liberté du choix. Ces marchaiidiies fe
r ,PetersSourS à Pencheré, dans une grande
1 a 11 PaIais Malien ; l’impératrice aflifte en perfon-
j p_ e v«nt.^ ; ^ette fouveraine fait elle-même
d’en-h rC'S V P^lm^s au moindre particulier
1 e»e K le fait-°pi eüe d acheter à très-haut prix. « S & chacun s’em-,
fait î f r,!6 bénéfic? dte ce,s rentes publiques, la co.ub
dies^ede°imin,er^e 3 r^ubarbe ,^du M des cén-
de M l L’état tire
& des W B Ê m m m ? 1Ceries ^ dès cabarets,
ppaarrmmii llees RruKflesb qlCuSe S c Hhez le s1 Tuu(arSeeS .e ft fré^quent
Tome X I y .
Lès revenus du fouverâin de Ruße fe tirént de la
capitation, de certains monopoles, des douanes des
ports, des péages, & des domaines de la couronne,
ils ne montent pas cependant au-delà de treize millions
de roubles, (foixante-cinq millions de notre
monnoie ). Avec ces revenus, la Ruffiepeut faire la
guerre aux Turcs, mais elle ne fauroit, fans recevoir
des fubfides, la faire en Europe ; fes fonds n’y firffi.
roient pas : la paie du militaire eft très-modique dähs
cet empire. Le foldat ruffe n’a point par ioiir lè tiers
id e/ a ,H ie de 1 allemand, ni même du françois;
lonqu il fort de fon pa ys, il ne peut fubfifter faits
augmentation de paye; & ce font lespuiflànces alliées
de la Ruffie, qui fourniffent chèrement cette augmentation.
°
La couronne de Ruffie eft héréditaire, les filles
peuvent fucceder, & le fouverâin a un pouvoir ab-
W , tous ‘ es fuiets »frns rendre compte de fa conduite
à perfonne. L ’air de la plus grande partie de la
Ruffie elt extrêmement froid, les neiges & les glaces
y régnent la meilleure partie de l’année^ le grain
qu on y ferne n’y meürit jamais bien , excepté diu
cote de la Pologne j où on fait la récolte trois m.ois
apres la lemaille. Il n’y croît point dé v in , mais beaucoup
de lin. Ses principales rivières font le Volga ,
le Don le Dnieper & le Dvina. Ses lacs donnent
du poiffon en abondance. Les forêts font pleines de
gibier, & debetes fauves. Le commerce des Ruffes
eft avantageux à la France , utile à la Hollande, &
défavorable à l’Angletèrre. Il confifte en martres
zibelines , hermines , & autres fourrures, cuirs de
boeufs appelles cuirs de Ruffie, lih, chanvre, fuif,
goudron9 cire, poix-réfine, layon, poiffon falé
6*c. Extrait de la defcripiion de la Ruffie, par M. de
Voltaire. Geneve , i7 ó.9 . in-8°. toni. /. Voyez auffi
dtjeription de l’empire de Ruffie, par Perri, Amfterd,
1 7 20 ,2 . vol. in-i 2. & la defcripiion hifloriq. de T empire
rufficn, traduit de Callemand,àxx baron de Stralemberg,
Holl. ,7 6 7 , 2. vol. in ;2. (L e chevalier DÉ
J A U C Ó Ü R T .')
RUST AN , ( Géog. mod. ) petit pays de France,
aux èônfiris duBigorre & de l’Aftarac. Son chef-lieu
eft S. Sever de R u f an.
RUSTICANA, (Géog. anc.) ville de la Lufitanie.
Elle eft placée dans les terres par Ptolomée , /. //.
c. v. &c marquée entre Talabriga & Mtndtculia. Cel-
larius , Géogr.ant. I. II. c. j . croit que c’ eft la même
ville que l’itinéraire d’Antonin nomme Ruftidana, &C
qii’il place fur la route d’Emérita à Saragoffe, entré
Turmuli & Cappara, à vingt-deux milles de la première
de ces villes * & à égale diftanee de la fécondé.
(O . J.)
RUSTICITÉ, f. f. (Gram.) terme à l’ufage des ha-
bitans des villes , par lequel ils défignent la groffié-
reté , fimplieité , rüdeffe des moeurs ; ducaradere
du di Roufs des gens de la campagne.
RUSTIQUE, adj. (Gram.) qui appartient à la campagne.
La maifon rufiique ; l’economie ruflique ; les
chofes rußiques : il fe prend auffi dans le même fens
que rufticité. Je fuis rufiique & fier.
Rustique, adj. ( A refit.) épithete qu’on donne à
la maniéré de bâtir-, dans l’imitation plutôt de la nature
que de l’ârt.
Rustique, ordre, (Architect.) ce mót fe dit du
premier de cinq ordres d’architechire , c’eft-à-dire ,
de l’ordre tofean, qui eft le moins orné * & celui
qui approche le plus de la fimplieité de la nature.
On dit auffi un ouvrage rufiique, en terihe d’archi-
tedure, quand les pierres ne font qüe piquées, ait
lieu d’être travaillées poliment & uniment. ( D . J .)
Rustiques , dieux, (Mythol.) les dieux rujhqücs
chez les Romains, étoient les dieux de la campagne,
& qui préfidoient à l’agriculture. Ôn diftinguoit les
dieux rußiques en grands & en petits. Les grands dieux
K k k iij