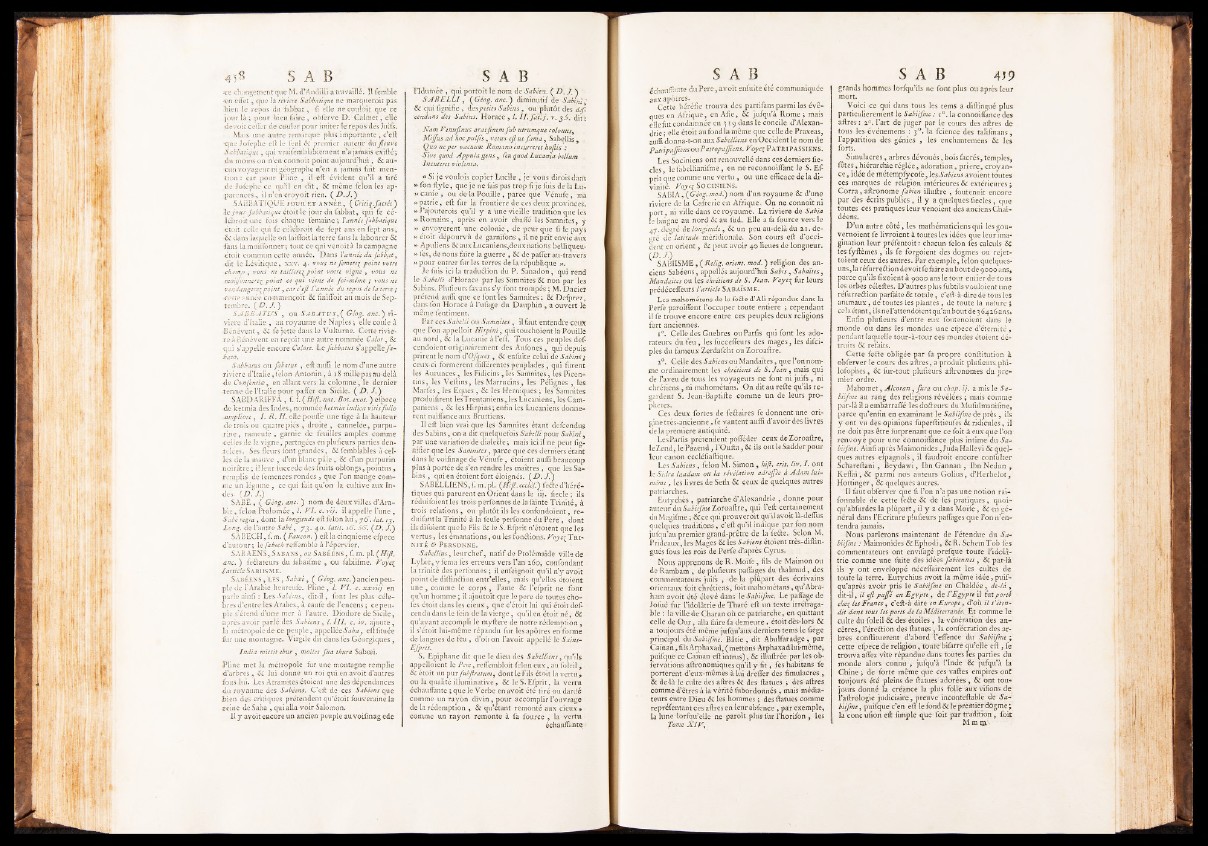
«e changement que M. d’Andilli a travaillé. Il femble
-en effet -, que la rivière Sabbatique ne marquèrent pas
bien le repos du fabbat, fi elle ne cou loi t que ce
.jour là ; pour bien faire , oblèrve D. Galmét, elle
devoir ©effet de couler pour imiter le repos des Juifs.
Mais une autre remarque plus importante ; c’eft
■ que Jofephe eft le fetd & premier auteur du jleuve
vSabbatique, qui vraisemblablement n’a jamais exifté;
du moins on n’en connoit point-aujourd’hui , & au-
•ciin voyageur ni géographe n’en a jamais fait mention
: car pour Pline , il eft évident qu’il a tiré
de Jofephe ce qu’il en d it , & même félon lés apparences
il n’en croyait rien. ( D. J. )
SABBATIQUE JOUR et ANNÉE, ( Critiq.facrée)
Je jour jabbaûque étoit le jour du fabbat, qui fe cé-
lébroit une fois chaque fe-maine ; Vannée fa bba tique
«étoit celle qui fe eélébroit de fept ans en fept ans ,
-& dans laquelle on laiffoit la terre fans la labourer &
•fans la moifionner ; tout ce qui venoit à la campagne
«toit commun cette année. Dans Vannée du fabbat,
dit le Lévitique, xxv. 4. vous ne femtre{ point votre
champ , vous ne tailUre’ point votre vigne > vous ne
moiijonnerc£ point ce qui vient de foi-même ; vous ne
v e ;i da ngerc^point, car c eft L'année du repos de la terre ;
cette année commençoit & finiffoit au mois de Septembre.
{.D. J. )
SABBATUS , ou S^BATUS,{ Géog. anc.) rivière
d’Italie , au royaume de Naples ; elle coule à
.Bénévent, fe jette dans le Vulturne. Cette rivie-
.re à Bénévent en reçoit une autre nommée Calor, &
qui s’appelle encore Calorc. Le fabbatus s’appelle fa-
batà. V-.,- - /
Sabbatus ou fabatas , eft aufli le nom d’une autre
riviere d’Italie, félon Antonin, à 18 mille pas au-delà
de Confentice, en allant vers la colomne, le dernier
-terme de l’Italie pour pafler en Sicile. ( D . J. )
SABDARIFFA , f. f. ( HiJi.nat. Boé.exot. ) efpece
de ketmia des Indes, nommée ketmia indica vitisfolio
.amphore , I. R. H. elle poufié une tige à la hauteur
de trois ou quatre pies , droite , cannelée, purpurine
, rameufe, garnie de feuilles amples comme
celles de la vigne, partagées en plufieurs parties dentelées.
Ses fleurs font grandes, & femblables à celles
de la mauve , d’un blanc pâ le, & d’un purpurin
noirâtre ; il leur fuccede des fruits oblongs, pointus,
remplis de femences rondes , que l’on mange comme
un légume , ce qui fait qu’on la cultive aux Indes
(D . Z.)
SABÉ , ( Géog. anc. ) nom de deux villes d’Arabie
, félon Ptolomée , l. VI. c. vij. il appelle l’une,
Sabé régla , dont la longitude eft félon lui, y 6. lat. ly.
Long, de l’autre Sabé, 73. 40. la tic. 16.56". (D. J.')
SABECH, f.m. ( Faucon. ) eft la cinquième efpece
d’autour ; le fabech reffemble à l’épervier.
SABAENS, S abans, ou Sabéens , f. m. pl. ( Hift.
■ anc. ) feâateurs du fabaïfme , ou fabiifme. Voye{
ƒarticle SaBIISME.
Sabéens, les , Saboei, ( Géog. anc.') ancien peuple
de l’Arabie heureufe. Pline, /. VI. c. xxviij en
parle ainfi : Les Sabéens, dit-il, font les plus célébrés
d’entre les Arabes, à caufe de l’encens ; ce peuple
s’ étend d’une mer à l’autre. Diodore de Sicile,
après avoir parlé des Sabéens, L III. c. iv. ajoute ,
la métropole de ce peuple, appellée^a^Æ, eftfituée
fur une montagne. Virgile dit dans fes Géorgiques ,
India mittu ebur , molles fua thura Saboei.
Pline met la métropole fur une montagne remplie
d ’arbres , &c lui donne un roi qui en avoit d’autres
fous lui. Les Atramites étoient une des dépendances
du royaume des Sabéens. C ’eft de ces Sabéens que
bien des critiques prétendent qu’étoit fouveraine la
teine de Saba , qui alla voir Salomon.
I l y avoit encore un ancien peuple au voifinag ede
l’ïdufnèë , qui portoit le nom de Sabéen. { D . j ) '
S A B E L L I , (Géog. anc.) diminutif de Sàbinï '
& qui fignifie , Aespecics Sabins , ou plutôt des def-
cendans des Sabins. Horace, L I f . faî!-j. v .$ 5 . dit't
Nam Venufi'nus aralfinemfub utrurnque colonus,
Mijfus ad hoc pulfis, vêtus eflut fama, Sabellis , ..
Quo ne per vacuum Romanp incurreret hoftis :
Sive quod Appulagens , leu quod Lucania bellum
Incuteret violenta-.
« Si je voulois copier Lucilê , je vous dirois dariS
» fon ftyle, que je ne fais pas trop fi je fuis de la Lu-
» eanie , ou de la Fouille , parce qitè Vénufe, ma
»patrie, eft fur la frontière de ces deux provinces.
» J’ajouterois qu’il y a une vieille tradition que les
»Romains, après en avoir chaffé lesSamnites, y
» envoyèrent une colonie, de peur que fi le pays
» étoit dépourvu de garnifons, il ne prît envie aux
» Apuliens & aux Lucaniens,deux nations belliqueü-
» fes, de nous faire la guerre , & de paffer au-travers
» pour entrer fur les terres de la république ».
Je fuis ici la traduftion du P. Sanadon, qui rend
le Sabelli d’Horace par les Samnites & non par les
Sabins. Plufieurs favans s’y font trompés ; M. Dacièf
prétend aufli que ce font les Samnites ; & Defprez,
dans fon Horace à l’ufage du Dauphin, a ouvert le
même fentiment.
Par ces Sabelli ou Samnites , il faut entendre ceux
que l’on appelloit Hirpini, qui touchoient la Pouillê
au nord, & la Lucanie à l’eft. Tous ces peuples défi
cendoient originairement des Àufonés , qui depuis
prirent le nom à'OfqueS , & enfuite celui de Sabins ;
ceux-ci formèrent différentes peuplades, qui furent
les Aurunces , les Fidicins, les Samnites, les Picen-
tins, les Veftins, les Marrucins, lès Pélignes , les
Marfes, les Eques , & les Herniques ; les Samnites
produifirent lesTrentaniens, les Lucaniens, les Cam-
paniens , & les Hirpins ; enfin les Lucaniens donnèrent
naiffance aux Bruttiens.
Il eft bien vrai que les Samnites étant defeeridus
des Sabins, on a dit quelquefois Sabelli pour Sabini.
par une variation de dialefte ; mais ici il ne peut lignifier
que les Samnites, parce que ces derniers étant
dans le voifinage de V énufe, étoient aufli beaucoup
plus à portée de s’en rendre les maîtres , que les Sabins
, qui en étoient fort éloignés. ( D. J.)
SABELLIENS,f. m. pl. {Hift. eccléf.) fefte d’hérétiques
qui parurent en Orient dans le iij. fiecle; ils
réduifoient les trois perfonnes de lafainte Trinité, à
trois relations, ou plutôt ils les confondoient, re-
duifant la Trinité à la feule perfonne du Pere , dont
ils difoient que le Fils & le S. Efprit n’étoient que les
vertus, les émanations, ou les fondions. Voyer Trinité
& Personne.
Sabellius, leur chef, natif de Ptolémaïde ville de
Lybie,yfema fes erreurs vers l’an 260; confondant
la trinité des perfonnes-; il enfeignoit qu’il n’y avoit
point de diftin&ion entr’elles, mais qu’elles étoient
une , comme le corps , l’ame & l’efprit ne font
qu’un homme ; il ajoutoit que le pere de toutes cho-
fes étoit dans les cieux, que c’étoit lui qui étoit défi
cendu dans le fein de la vierge, qu’il en étoit né,; ôi
qu’ayant accompli le myftere de notre rédemption ,
il s’etoit lui-même répandu fur les apôtres en forme
de langues de feu , d’oii on l’avoit appellé le Saint-
Efprit.
S. Epiphane dit que le dieu des Sabelliens, qu’ils
appelloient le Pere, reffembloit félon eux, au foleil,
& étoit un pur fubftratum, dont le Fils étoit la vertu >
ou la qualité illuminative, & le S .Efprit, la vertu
échauffante ; que le Verbe en avoit été tiré ou dardé
comme un rayon divin, pour accomplir l’ouvrage
de la rédemptiçm , & qu’étant remonté aux cieux ,
comme un rajron remonte à fa fource , la vertu
échauffante ;
échauffante du Pere, avoit enfuite été communiquée
aux apôtres. ‘ ‘-'‘f
Cette héréfie trouva des partifans parmi les eve-
ques en Afrique, en Afie, & jufqu’à Rome ; mais
elle fut condamnée en 319 dans le concile d’Alexandrie;
elle étoit au fond la même que celle de Praxeas,
aufli donna-t-on aux Sabelliens en Occident le nom de
Patripa(ftensowPatropaftiens. Voyez P a t r ï PASSIENS.
Les Sociniens ont renouvelle dans ces derniers fie-
cles le fabellianifme, en ne reconnoiffant le S. Efi
prit que comme une vertu., ou une efficace de la divinité.
Voyeq_ Sociniens.
SABIA, (Géog. mod.) nom d’un royaume & d’une
riviere de la Cafrerie en Afrique. On ne connoît ni
port, ni ville dans ce royaume. La riviere de Sabia
le baigne au nord & au fud. Elle a fa fource vers le
47. degré de longitude , & un peu au-delà du 21. de-
eré de latitude méridionale. Son cours eft d’occident
en orient, & peut avoir 40 lieues de longueur.
(D . J.)
SABIISME, ( Relig. orient, mod. ) religion des anciens
Sabéens, appellés aujourd’hui Sabis, Sabaïtes,
Mandaïtes ou les chrétiens de S . Jean. Voye{ fur leurs
prédéceffeurs l'article Sabàïsme.
Les mahométans de la fefte d’Ali répandus dans la
Perfe paroiffent l’occuper toute entière ; cependant
il fe trouve encore entre ces peuples deux religions
fort anciennes.
i° . Celle des Guebres ou Parfis qui font les adorateurs
du feu , les fucceffeurs des mages, les difei-
ples du fameux Zerdafcht ou Zoroaftre.
20. Celle des Sabiens ou Mandaïtes, que l’on nomme
ordinairement les chrétiens de S. Jean, mais qui
de l’aveu de tous les voyageurs ne font ni juifs , ni
chrétiens , ni mahométans. On dit au refte qu’ils regardent
S. Jean-Baptifte comme un de leurs prophètes.
Ces deux fortes de fe&aires fe donnent Une origine
très-ancienne, fe vantent aufli d’avoir des livres
de la première antiquité.
Les Parfis prétendent pofféder ceux de Zoroaftre,
leZend, le Pazend, l ’Oufta, & ils ont leSadder pour
leur canon eccléfiaftique.
Les Sabiens, félon M. Simon, hift. crit. liv. I. ont
le Sidra laadam ou la révélation adrejfie à Adam lui-
même , les livres deSeth St ceux de quelques autres
patriarches.
Eutychès , patriarche d’Alexandrie , donne pour
auteur du Sabiifme Zoroaftre, qui l’eft certainement
du Magifme ; St ce qui prouveroit qu’il avoit là-deffus
quelques traditions, c’eft qu’il indique par fon nom
jufqu’au premier grand-prêtre de la feéie. Selon M.
Prideaux, les Mages St les Sabiens étoient tres-diftin-
gués fous les rois de Perfe d’après Cyrus.
Nous apprenons de R. Moife, fils de Maimon ou
de Rambam , de plufieurs paflagès du thalmud , des
commentateurs juifs , de la plupart des écrivains
Orientaux foit chrétiens, foit mahométans, qu’Abrâ-
ham avoit été élevé dans le Sabiifme. Le paffage de
Jofué fur l’idolâtrie de Tharé eft un texte irréfragable
: la ville de Charan oîi ce patriarche, en quittant
celle de O u r, alla faire fa demeure > étoit dès-lors St
a toujours été même jùfqu’aux derniers tems lé fiege
principal du Sabiifme. Bâtie , dit Abulfaradge -, par
Cainan, fils Arphaxad, ( mettons Arphaxàd lui-même,
puifquè ce Caïnan eft intrus), & illuftrée par lès ob-
fervations aftronomiques qu’il y f i t , fes habitans fe
portèrent d’eux-mêmes à lui dreffer des fimulacres ,
& de-là le culte des aftres & des ftatues ; dès aftres
comme d’êtres à la vérité fubordonnés , mais médiateurs
entre Dieu & les hommes ; des ftatUes comme
repréfentant çes aftres en leur abfenee , pdr exemple,
la lune lôrfqu’elle ne paroît plus fur l’horifon , les
Tome X IV y
grands hommes lorfqu’ils ne font plus ou après leur
mort.
Voici ce qui dans tous les tems a diftingué plus
particulièrement le Sabiifme : i° . la connoiffance des
aftres : 20. l’art de juger par le cours des aftres de
tous les événemens : 30. la fcience des talifmans,
l’apparition des génies , les enchantemens & les
•' forts.
Simulacres, arbres dévoués, bois facrés, temples,
fêtes, hiérarchie réglée, adoration, priere, croyance,
idée de métempfycofe, les Sabiens avoient toutes
ces marques de religion intérieures & extérieures ;
Corra, aftronome fabien illuftre , foutenoit encore
par des écrits publics , il y a quelques fiecles , que
toutes ces pratiques leur venoient des anciens Chal-
déens.
D ’un autre côté, les mathématiciens qui les gou-
vernoient fe livroient à toutes les idées que leur imagination
leur préfentoit : chacun félon les calculs &
les fyftèmes, ils fe forgoient des dogmes ou rejet-
toient ceux des autres. Par exemple, félon quelques-
uns, la réfurreftion devoit fe faire au bout de 9000 ans,
parce qu’ils fixoient à 9000 ans le tour entier de tous
les orbes céleftes. D’autres plus fubtils vouloient une
réfurreftion parfaite & totale, c’eft-à-dire de tous les
animaux, de toutes les plantes , de toute la nature }
cela étant, ils ne l’attendoient qu’au bout de 3 64263ns*
Enfin plufieurs d’entre eux foutenoient dans le
monde ou dans les mondes une efpece d’éternité ,
pendant laquelle tour-à-tour ces mondes étoient détruits
& refaits.
Cette fefte obligée par fa propre conftitution à
obferver le cours des aftres, a produit plufieurs phi-
lofophes, & fur-tout plufieurs aftronomes du pre-
; mier ordre.
Mahomet, Alcoran, fura ou chap. ij. a mis le Sabiifme
au rang des religions révélées ; mais comme
par-là il a embàrraffé les do&eurs du Mufulmanifme,
; parce qu’enfin en examinant le Sabiifme de près , ils
y ont vu des opinions fuperftitieufes & ridicules, il
ne doit pas être lurprènant que ce foit à eux que l’on
renvoyé pour une connoiflance plus intime du Sa-
biifme. Ainfi après Maimonides, Juda Hallevi & quelques
autres efpagnols, il faudroit encore confulter
Schareftani , Beydawi, Ibn Gannan , Ibn Nedun ,
Keffai, & parmi nos auteurs Golius, d’Herbelot,
Hottinger, & quelques autres.
II faut obferver que fi l’on n’a pas une notion rai-
fonnable de cette le&e & de fes pratiques, quoi-
qu’abfurdes la plupart, il y a dans Moïfe, Sc en général
dans l’Ecriture plufieurs paffages que l’on n’entendra
jamais.
Nous parlerons maintenant dè l’étendue du Sabiifme
: Maimonides & Ephodi, & R. ScheinTob fes
commentateurs ont énvifagé prefqüe toute l’idolâtrie
comme une fuite des idées fàbiennes, & par-là
ils y ont enveloppé néceffairemènt lès cultes de
toute la terre. Eutychius avoit la même idée, puif-
qu’après avoir pris le Sabiifme en Chaldée, de-là,
dit-il, il eft paffé en Egypte , de l'Egypte il fut porté
cher les Francs, c’eft-à dire en Europe, d’où il s'étendit
dans tous les ports de la Méditerranée. Et comme le
culte du foleil & des étoiles , la vénération des ancêtres
, l’éreétion des ftatues la eonfécration des arbres
conftituerent d’abord f effence du Sabiifme ;
cette efpece de religion, toute bifarré qu’elle e ft , fe
trouva affez vîtë répandue dans toutes lés parties du
monde alors connu , jufqu’à l’Inde & jufqu’à la
Chine ; de forte même que ces vaftes empires ont
toujours été pleins fié ftatuès adorées, & ont toujours
donné la créance la plus folle aux vifions de
l’aftrologie judiciaire, preuve inèonteftablè de Sabiifme
, puifquè c’en eft le fond & le prèm.ierdôgme ;
la conc ufion eft fimple que foit par tradition, foit
• Mm