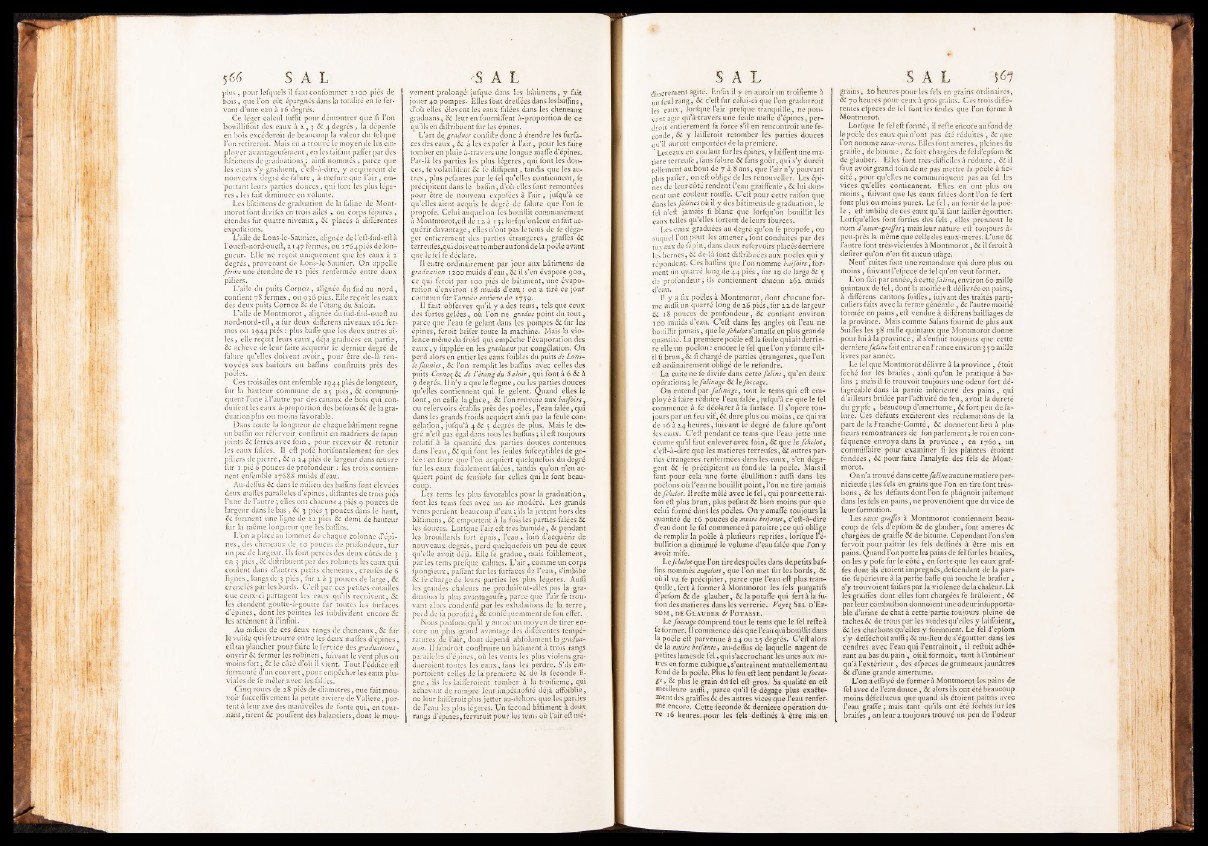
566 S A L
plus, pour lefquels il faut confommcr 2100 pies de :
bois, que l’on eut épargnés dans la totalité en lé fer-
vant d’une eau à 16 degrés.
Ce léger calcul luffit pour démontrer que fi l’on
bouillift'oit des eaux à 2 ,3 & 4 degrés, la dépenfe
en bois excédefoit de beaucoup la valeur du lél que
l’on retireroit. Mais on a trouvé je moyen de les employer
avantageufement, en les faifant palier par des
bâtimens de graduations : ainfi nommés, parce que
les eaux s’y-graduent, ceft-à-dire, y acquièrent de
nouveaux degré defalure, à mefure que l’air, emportant
leurs parties douces, qui font les plus légères
, les fait diminuer en volume.
Les bâtimens de graduation de la faline de Mont-
morot font divifés en trois ailes , ou corps féparés ,
étendus fur quatre niveaux, 8c placés à différentes
èxpofitions.
L’aîle de Lons-le-Saunier, alignée del’eft-fud-eftà
l ’oueft-nord-oueft, a 147 fermes, ou 1764 piés de longueur.
Elle ne reçoit uniquement que les eaux à 2
degrés, provenant de Lons-le-Saunier. On appelle
ferme une étendue de 12 pies renfermée entre deux
piliers.
L’aîle du puits Cornoz, alignée du fud au nord,
contient 78 fermes , ou 936 pies. Elle reçoit les eaux
des deux puits Cornoz 8c de l’étang du Saloir.
L’aîle de Montmorot, alignée du fud-fud-oueft au
bord-nord-eft, a fur deux différens niveaux 162 fermes
ou 1944 piés : plus baffe que les deux autres aile
s , elle reçoit leurs eaux, déjà graduées en partie,
8c achevé de leur faire acquérir le dernier degré de
falure qu’elles doivent avoir, pour être de-là renvoyées
aux baifoirs ou balîins conffruits près des
poêles.
Ces trois ailes ont enfemble 1944 piés de longueur,
fur la hauteur commune de 25 piés , 8c communiquent
l’une à l’autre par des canaux de bois qui con-
duifent les eaux à-proportion des befoins 8c de la graduation
plus ou moins favorable.
Dans toute la longueur de chaque bâtiment régné
un bafîin ou réfervoir conffruit en madriers de fapin
joints 8c ferrés avec foin , pour recevoir 8c retenir
les eaux falées. Il eft pofé horifontalement fur des
piliers de pierre, & a 24 piés de largeur dans oeuvre
fur 1 pié 6 pouces de profondeur : les trois contiennent
enfemble 17688 muids d’eau.
Au-deffus 8c dans le milieu des balîins font élevées
deux maffes parallèles d’épines, diftantes de trois piés
l’une de l’autre ; elles ont chacune 4 piés 9 pouces de
largeur dans le bas, & 3 piés 3 pouces dans le haut,
8c forment une ligne de 22 piés 8c demi de hauteur
fur la même longueur que les balfins.
L ’on a placé au fommet de chaque colonne d’épines
, des cheneaux de 10 pouces de profondeur,, fur
un pié de largeur. Ils font percés des deux côtés de 3
en 3 piés, & diftribuentpar des robinets les eaux qui
coulent dans d’autres petits cheneaux, creufésdeô
lignes, longs de 3 piés, fur 2 à 3 pouces de large, &
crénelés par les bords. C ’eff par ces petites entailles
que ceux-ci partagent les eaux qu’ils reçoivent, &
les étendent goutte-à-goutte fur toutes les furfaces
d’épines, dont les pointes les lubdivifent encore 8c
les atténuent à l’infini.
Au milieu de ces deux rangs de cheneaux, 8c fur
le vuide qui fe trouve entre les deux maffes d’épines,
eft un plancher pour faire le fervice des graduations,'
ouvrir 8c fermer les robinets, fuivant le vent plus ou
moins fort, & le côté d’oîi il vient. Tout l’édifice eft
lurmonté d’un couvert, pour empêcher les eaux pluviales
de fe mêler avec les falées.
Cinq roues de 28 piés de diamètres, que fait mou-,
voir fucceflivement la petite riviere de Valiere, portent
à leur axe des manivelles de fonte qui, en tournant,
tirent 8c pouffent des balanciers, dont le mou-
' S A L
vement prolongé jufque dans les bâtimens, y fait
jouer 40 pompes. Elles font dreffées dans les balîins ,
d’oii elles élevent les eaux falées dans les cheneaux
graduans, & leur en fourniffent à-proportion de ce
qu’ils en diftribuent fur les épines.
L’art de. graduer conlifte donc à étendre les furfaces
des eaux, & à les expofer à l’air, pour les faire
tomber en pluie à-travers une longue maffe d’épines.
Par-là les parties les plus légères, qui font les douces,
fe volatilifent 8c fe diflipent, tandis que les au-*
très, plus pefantes par le fel qu’elles contiennent, fe
précipitent dans le bafiin, d’où elles font remontées
pour être de nouveau expofées à l’air , jufqu’à ce
qu’elles aient acquis le degré de falure que l’on fe
propofe. Celui auquel on les bouillit communément
à Montmorot,eft de 12 à 13; lorfqu’onleur en fait acquérir
davantage, elles n’ont pas le tems de fe dégager
entièrement des parties étrangères, graffes 8c
terreufes,quidoiventtomberaufonddela poêle avant
que le lel le déclare.
Il entre ordinairement par jour aux bâtimens de
graduation 1200 muids d’eau, 8c il s’en évapore 900,
ce qui feroit par 100 piés de bâtiment, une évaporation
d’environ 18 muids d’eau4 : on a tiré ce jour
commun fur l’année entière de 1759.
Il faut obferver qu’il y a des tems, tels que ceux
des fortes gelées, où l’on ne gradue point du tout,
parce que l’eau fe gelant dans les pompes 8c fur les
epines, feroit brifer toute là machine. Mais la v iolence
même du froid qui empêche l’évaporation des
eaux, y fupplée en les graduant par congélation. On
perd alors en entier lès eaux foibles du puits de Lons-
lefaunier, 8c l’on remplit les balîins avec celles des
puits Corno^ 8c de Vétang du Saloir, qui font à 6 & à
9 degrés. Il n’y a que le flegme, ou les parties douces
qu’elles contiennent qui, le gelent. Quand elles le
font, on caffe la glace, 8c l’on renvoie aux baifoirs,
ou refervoirs établis près des poêles, l’eau falée, qui
dans les grands froids acquiert ainfi par la feule congélation,
jufqu’à 4 & 5 degrés de plus. Mais le degré
n’eft pas égal dans tous les balîins ; il eft toujours
relatif à la quantité des parties douces contenues
dans l’eau, 8c qui font les feules fufceptibles de gelée
: en forte que l’on acquiert quelquefois du degré
fur les ,eaux foiblement falées, tandis qu’on n’en acquiert
point de fenfible fur celles qui le font beaucoup.
Les tems les plus favorables pour la graduation,
font les tems fecs avec un air modéré. Les grands
vents.perdent beaucoup d’eau ; ils la jettent hors des
bâtimens, 8c emportent à la fois les parties falées 8c
les douces, Lorfque l’air, eft-très humide, & pendant
les brouillards fort épais, l’eau, loin d’acquérir de
nouveaux degrés, perd quelquefois un peu de ceux
qu’elle avoit déjà. Elle fe gradue, mais foiblement,
parles tems prefque calmes. L’air, comme un corps
îpongieux; paflànt fur les furfaces de l’eaus,,s’imbibe
& fe charge de leurs parties les plus légères. Aufii
les grandes chaleurs ne produilënt-elles pas la graduation
la plus avantageufe-, parce que l’air fe trouvant
alors condenfé par les exha.laifons de.'la> terre,
perd de fa porofité, 8c couféquemment de fon effet. ,
Nous p.enfons qu’il y auroit un moy en de tirer en-
. core un plus grand avantage des différentes températures
de. l’air, dont dépend abfolument la graduation.
Il faudroit conftruire un bâtiment à trois rangs,
parallèles d’épines, où les vents les plus violens gra-
: dueroienttoutes les,eaux, fans les perdre. S’ils emportaient
celles de ïa première 8c de la féconde lign
e, ils les laifferoiént tomber à la troifieme, qui
achevant de rompre leur impétuofité déjà affoiblie,
ne leur Iaifferoit plus jetter, au-dehors que les parties
de l’eau les plus légères.: Ijn fécond bâtiment à deux
rangs d’épines, ferviroit pour les tems où l’air eft me-
S A L
diocfemént àgité. Enfin il y en auroit un troifieme à
un feulrang, 8c c’eft fur celui-ci que l’on gradueroit
les eaux, lorfque l’air prefque tranquille, ne pou4
vant agir qu’à-travers une feule maffe d’épines, per-
droit entièrement fa force s’il en rencontrait urte fécondé
, 8c y Iaifferoit retomber lés parties douces
qu’ il auroit emportées de la première.
Les eaux en coulant fur les épin.eS, y laiffent une matière
terreufe, fans falure 8c fans goût, qui s’y durcit
tellement au bout de 7 à 8 ans, que l’air n’y pouvant
plus paffer, on eft obligé de les renouveller. Les épi4
nés de leur côté rendent-l’eau gfaiffeufe > 8c lui donnent
une couleur roufie. C’eft pour cette raifon que
dans les falinesoii il y des bâtimens de graduation, le
fel n’eft jamais fi blanc que lorfqu’on bouillit les
eaux telles qu’elles fortent de leurs fources.
Les eaux graduées au degré qu’on fe propofe , ou
auquel l’on peut les amener, font conduites par des
tuyaux de fapin, dans deux refervoirs placés derrière
les bernes, 8c de-là font diftribuées aux poêles qui y
répondent. Ces baflins que l’on nomme baifoirs, for4
ment un quarré long de 44 piés, fur 10 de large 8c 5
de profondeur ; ils contiennent chacun 262 muids
d’eau.
Il y a fix poêles à Montmorot, doilt chacune for4
me aufîi un quarré long de 26 piés, fur 22 de largeur
& 18 pouces de profondeur, 8c contient environ
100 muids d’eau» C’eft: dans les angles oii l’eau ne
bouillit jamais, que le fchelot s’amaffe en plus grande
quantité. La première poêle eft la feule qui ait derrière
elle un poêlon : encore le fel que l’on y forme eft-
il fi brun, 8c fi chargé de parties étrangères, que l’on
eft ordinairement obligé de le refondre.
• La cuite ne fe divife dans cette faline, qu’én deux
opérations ; 1 efalinage 8c le foccage.
On entend par Jalinage, to'ut le tems qui eft employé
à faire réduire l’eau falée, jufqu’à ce que le fel
commence à fe déclarer à fa furface. Il s’opère toujours
par un feu v if, ôedure plus ou moins, ce qui va
de 16 à 24 heures, fuivant le degré de falure qu’ont
les eaux. C ’eft pendant ce tems que l’eau jette une
écume qu’il faut enlever avec foin, 8c que le fchelot,
c’eft-à-dire quç1 les matières terreufes, 8c autres par*
ties étrangères' renfermées dans les eaux, s’en dégagent
8c fe précipitent au fond de la poêle. Mais il
faut pour cela une forte ébullition : aufîi dans les
poêlons où l’eau ne bouillit point, l’on ne tire jamais
de fchelot. Ilrefte mêlé avec le fel, qui pour cette raifon
eft plus brun, plus pefant & bien moins pur que
celui formé dans les poêles. On y amaffe toujours la
quantité de 16 pouces de /nuire bri/ante, c’eft-à-dire
d’eau dont le fel commence à paroitre ; ce qui obligé
de remplir la poêle à plufieurs reprifes, lorfque l’ébullition
a diminué le volume d’eau falée que l’on y
avoit mife.
Le fchelot que l’on tire des poêles dans depetits baflins
nommés augelots, que l’on met fur lès bords, 8c
où il va fe précipiter, parce que l’eau eft plus tranquille
, fort à former à Montmorot les fels purgatifs
d’pefom & de glauber, 8c la potaffe qui fort à la fu-
lion.des matières dans les verrerie. Voye{ Sel d ’E p-
som , de Glauber & Potasse.;
Le foccage comprend tout le tems que le fel refteà
fe former. Il commence dès que l’eau qui bouillit dans
la poêle eft parvenue à 24 ou 25 degrés. C’eft alors
de la muire bri/ante, au-deffus de laquelle nagent dé
petites lames de fe l, qui s’accrochant les unes aux au-*
très en forme cubique, s’entraînent mutuellement au
fond de la poêle. Plus le feu eft lent pendant 1 bfoct’di
§e 1 8c plus le grain dit fel eft gros.- Sa qualité en eft
meilleure aufîi, parce qu’il fe dégage plus exaéte*
ment des graiffes 8c des autres vices que l’eau renferme
encore. Cette fécondé 8c derniere opération dure
16 heures-pour les fols deftinés à être mis ert
$ À L i î 6?
grains, 10 néUrès pour les fels en grains ordinaires,
8c 70 heures pour ceux à groS grains. Ces trois différentes
efpeces de fel font lès feules que l’on forme à
Montmorot.
Lorfque le fel eft formé, il refte encore aü fond de
la poêle des eaux qui n’ont pas été réduites , & que
l’on nomme eaux-meres. Elles font atneres, pleines de
graiffe, de bitume, 8c fort chargées de feld’epfom 8c
de glauber. Elles font très-difficiles à réduire, 8c il
faut avoir grand foin de ne pas mettre la poêle à fie*
cité , pour qu’elles ne communiquent pas au fel les
vices qu’elles contiennent. Elles en ont plus ou
moins -, fuivant que les eaux falées dont l’on fe fert
font plus ou moins pures. Le fe l, au fortir de la poêle
, eft imbibé de ces eaux qu’il faut laiffer égoutter.
Lorfqu’elles font fortiès des fels , elles prennent le
nom d'eaux-graffes ; mais leur nature eft toujours à-
peu-près la même que celle des eaux-meres. L ’une 8c
l’autre font très-vicieufes à Montmorot, 8c il feroit à
defirer qu’on n’en fît aucun ufage.
Neuf cuites font une remandure qui dure plus ou
moins, fuivant l’efpece de fel qu’on veut former.
L’on fait par année, à cette faline, environ 60 mille
quintaux de fel, dont la moitié eft délivrée en pains,
à differens cantons fuiffes, fuivant des traités particuliers
faits avec la ferme générale , & l’autre moitié
formée en pains , eft vendue à différens bailliages de
la province. Mais comme Salins fournit de plus aux
Suiffes les 3 8 mille quintaux que Montmorot donne
pour lui à la province, il s’enfuit toujours que cette
derniere faline fait entrer en France environ 350 mille
livres par année.
Le lel que Montmorôt délivre à la province , étoit
féché fur les braifes , ainfi qu’on le pratique à Salins
; mais il fe trouvoit toujours une odeur fort dé-
fagréable dans la partie inférieure' des pains, qui
d’ailleurs brûlée par i’a&ivité du feu, avoit la dureté
du gypfe , beaucoup d’amertume, 8c fort peu de falure.
Ces défauts excitèrent des réclamations de la
part de la Franche-Comté, 8c donnèrent lieu à plu4
fieurs remontrances de fon parlement; le roiencon-
féquence envoya dans la province, en 1760, un
commiffaire pour examiner fi les plaintes étoient
fondées, & pour faire l’analyfe des fels de Montmorot.
On n'a trouvé dans cette faline aucune matière per*
nicieufe ; les fels en grains que l’on en tire font très-
bons , 8c les défauts dont l’on fe plaignoit juftement
dans les fels en pains, ne provenoient que du vice de
leur formation.
Les eaux graffes à Montmorot contiennent beau4
coup de fels d’epfom & de glauber, font ameres 8c
chargées de graiffe 8c de bitume. Cependant l’on s’en
fervoit pour paîtrir les fels deftinés à être mis en
pains. Quand l’on porte les pains de fel fur les braifes,
on les y pofe fur le côté, en forte que les eaux graf4
fes dont ils étoient imprégnés, defeendant de la par-*
tie- Supérieure à la partie bàffe qui touche le brafier,
s’y trouvoient faifies par la violence de la chaleur. Là
les graiffes dont elles font chargées fe brûLoient, 8c
par leur cômbuftion donnaient une odeur infupporta-
ble d’urine de chat à cette: partie toujours pleine de
taches 8c de trous par les vuides qu’elles y laiffoient,
& les charbons qu’elles y formoient. Le fel d’epfom
s’y defféchoit aiiflî ; 8c au-lieu de,s’égoutter dans les
cendres avec l’eau q u il’entraînoit, il reftoit adhérant
au bas du pain , .où il formoit, tant: à l’intérieur
qu’à l’extérieur, des efpeces de grumeaux jaunâtres
8c d’une grande amertume.
L’on à effayé de former à Montmorot les pains de
fel avec de l’eau douce , & alors ils ont été beaucoup
moins défeûueux que quand ils étoient paîtris aveç
l’eau graffe ; mais -tant qu’ils ont été féchés lîir les
braifes , on leur a toujours trouvé un peu de l’odçur