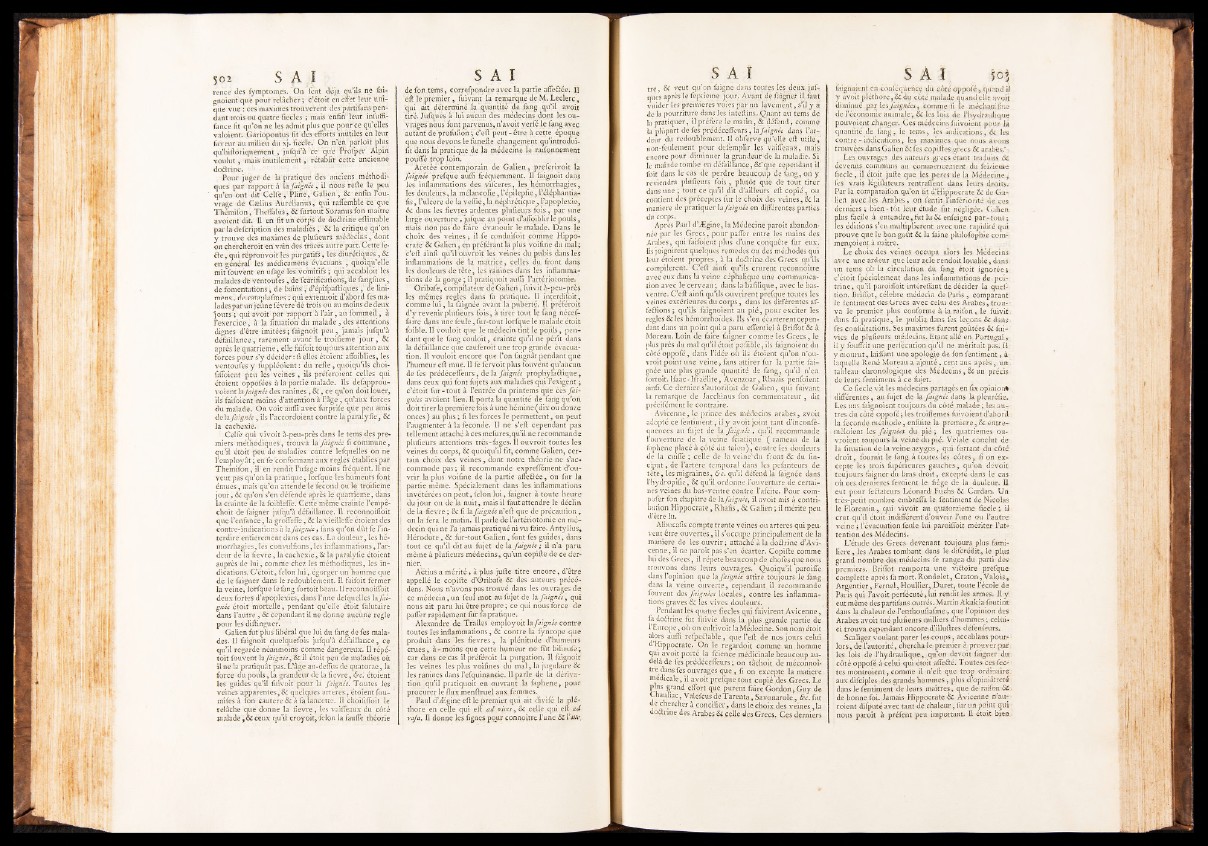
Vence des fymptomes. On fent déjà qu’ils, ne fai-
cnoientquë pour relâcher ; c’étoit en enet leur unique
vue : ces maximes trouvèrent des partifans pendant
trois'ovï quatre ïiecle^^ mais enfin''lëur inl'uffi-
fance fit qu’on ne les admit plus que ppurce qu’elles
valoient. Garioponïus fit des efforts inutiles eù leur
faveur au milieu du xj. fie'cle. On n’éft parloit plus
qu’hiffôriqUéinent jùlqtï’à ce1 qu'è iPrôipér Alpin
voulut, mais inutilerhent, rétablir cette ancienne
do&rme. ‘ ' 1 x ci "
•Pour juger de la pratique des anciens méthodiques
par rapport à '1# faignée, il hbiïs relie le peu
qu’en ont dit C e lle , Pline, Galien ,' 6c enfin l’ouvrage
de Cælïus Aurdlanùs, qui raffembl'e te que
Thémifon, Thêffalîis; dc furtqut Soranusfôn paître
avoient dit. Il en* fit un cbrpè de doélrifie eftimable
par la defcriptio'n des maladiés ju8cla critique qd’on
y trouve des maximes, de plufieurs liiédecïnS,' dont
on cherchëfoit eiî vain des traces autre lpart. Cette'fe-
â e , qui féproüvoit lés purgatifs, les diurétiques , 8c
en général les médïcaméns évacuant , qfi'oiqu’elle
mît fouvërtt en ufagë les vomitifs ;: qui aètàbioït les
malades-de' ventoufes, de Tcaiincariohs1, de farigfùes,
de fomentations ', de: bains d’épifpàlliques• de lini-
mens, de Càtaplafmès ; qui extèniioit d’abord fes malades
par un jeune févere dé trois ou au moins de deux
jours’;'qui a-voit par rapport à l’air, au fomméil, à
l’exercice , à la fituâtion du malade, des attentions
dignes d’être imitées; faignoit peu, jam’ais jùfqu’à
défaillance, 1 rarement- avant le troifieme jour , 8c
après lé quatrième, elle faifoit toujours attention aux
forces pour s’y décider : fi elles’étoient affoiblies, les
ventoufeS y luppléoient : du relie, quoiqu’ils choi-
frffôient peù îès veines , ils préferoient celles qui
étoient opp'ôfées à la partie malade. Ils defapprou-
voientla faignée des ranines, 8c , ce qu’on doit louer,
ils faifoi'ent moins d’attention à l’âge , qu’aux forcés
du malade.1 Oiï voit auffi avec furprife que peu' amis
delà faignée, ils l’accordoient contre la paralyfie, 8c
la cachexie.
Celle' qüi vivoit à-peu-près dans le tems des premiers
méthodiques1, ' trouva là faignée fi commune,
qu’il étoît peti de maladies contre lesquelles on ne
l’employât ; en fe conformant aux réglés établies par
Themifont, il: en rendit l’ufage moins fréquent. Ii ne
veut pas qu’on la pratique, lorfque les humeurs font
émuês, mais qù’ôn attende le fécond ou le troifieme
jour, 8c qu’on s’en défende après le' quatrième, dans
la crainte de la foibléffe. Cette même crainte l’empê-
choit de faigner jüfqu’à défaillance. Il reconnoiflbit
que l’enfance, la groffeffe, 8c la vieilleffe étoient des
eontre-indications à la faignée, fans qu’on dût fe l’inter
dire entièrement dans Ces cas. La douleur, les hémorrhagies,
les convulfions, lès inflammations, l’ardeur
de la fievre, la cachexie, 8r la pafalÿfie étoient
auprès de lui, comme*chez les méthodiques, les indications.
C’étoit, félon lui, égorger un homme que
de le faigner dans le redoublement. Il faifoit fermer
la veine, lorfque le fang fortoit beau. Il reconnoiflbit
deux fortes d’apoplexies, dans l’une defquelles la faignée
étoit mortelle, pendant qu’elle étoit falutaire
dans l’autre, 8c cependant il ne donne aucune réglé
pour les dillinguer.
Galien fut plus libéral que lui du fang de fes malades.
Il faignoit quelquefois jufqu’a défaillance, ce
qu’il regarde néanmoins comme dangereux. Il répé-
toit louvent la Jàigriée, il étoit peu de maladies ou
il ne la pratiquât pas. L’âge au-deffus dé quatorze, la
forcé du pouls, la grandeur de la fievre. (S-c.- étoient
les guides qti’il fuivoit’ pour là faignée. Toutes les
veines apparentes, 8c quelques artères, étôièrif fou-
mifes à fôn cautere 8c à fa lancette. Il ch'oififfoit le
relâche que donne la fievre, les vaiffeaux du côté
jnalade ,8c ceux qu’il croyoit,-félon la fauffe théorie
de fon,tems, çoryefpOjndre avec lg partie affeôée. Il
efl lé premier, fuivant ,1a Remarque de M. Leclerc,
qui ait déterminé la "quantité de fang .qu’il avofr
tiré. Jûfquês à lui aucun des médecins dont les qu-
vrages'nous font parvenus, n’avoit y erfe le fang avec
autant de’profùfion ; c’eîl peut - être à cette époque
que nous devons le fupeffe changeaient qu’introdui-
fit daiislà pratique de la médecine leraffQnnement
pouffé trop loin.
Àrëtëe contemporain de Galien, prçfcriyoit la
faignée prefqiie auffi fréquemment. U iaignoit dans
les inflammations des vifceres, les hémorrhagies,
lès douleurs, la mélancolie, l’épilepfie, l’éléphantia-
fis, l’ülcerè de là velfié, la néphrétique , l’apoplexie,
8c dans les fievfes ardentes plufièurs fois, par une
large ouverture, jufque au point d’affpiblir le pouls,
mais ïiôn pas de faite évanouir le malade. Dans le
choix des veines.; il fe cpnduilbit comme Hippocrate
8c G alien, en préférant la plus voifine du niai;
c’ell ainfi qu’il ouvibit les veines du pubis dans les
inflammations dé la matrice, celles du front dans
les douleurs de tête j lés ranines dans lés inflammations
de la gorgé ; il pratiquoit aufîi l’arténptomie;
Oribafe, compilateur dé Galien ; fuivit à-peu-près
les mêmes réglés dans la pratique. Il interdiloit,
comme lu i, la faignée avant la puberté. Il préféroit
d’y revenir plufieurs fois, à tirer tout l.é fang néçefr
faire dans une feule, fur-tout lorfcjue le malade étoit
foible. Il voùloit que le médecin tint le poyls, pendant
que te fang couloit, crainte qu’il ne pérît dans
la défaillance que eaufereif une trop grande évacuation.
Il vouloit encoré que l’on faignât pendant que
l’humeur eft mue. Il fe fervoitplus loiiVent qu’aucun
de fes prédéceffeurs, de la faignée prophÿiaftique ,
dans ceux qui font fujets aux maladies qui l’exigent ;
c’étoit fur-tout à l’entrée du printems qite cès fai-
gnées avoient lieu. Il porta la quantité de farig qu’ofi
doit tirer la première fois à une hemine (dix ou douze
onces) au plus ; fi les forces le permettent, on peut
l’augmenter à la fécondé. II ne s’ell cependant pas
tellement attaché à ces mefures,qu’il ne recommande
plufieurs attentions très-fages. Il ouvroit toutes les
veines du corps, 8c quoiqu’il fît, comme Galien, certain
choix des veines, dont notre théorie ne s’accommode
pas; il recommande expreflement d’ouvrir
la plus voifine de la partie affeûée, ou fur la
partie même. Spécialement dans les inflammations
invétérées on peut, félon lu i, faigner à toute heure
du jour ou de la nuit, mais il faut attendre le déclin
de la fievre ; 8c fi la faignée n’ efl que de précaution ,
on la fera le matin. Il parle de l’artériotomie en médecin^
qui ne l’a jamais pratiqué ni vu faire. Antyllus,
Hérodote, 8c fur-tout G alien, font fes guides, dans
tout ce qu’il dit au fujet de la faignée ; il n’a paru
même à plufieurs médecins, qu’un copifle de ce dernier.
Aëtius a mérité, à plus jufle titre encore, d’être
appellé le. copifle d’Oribafe 8c des auteurs précé-
dens. Nous n’avons pas trouvé dans les ouvrages de
ce médecin, un feul mot au fujet de la faignée, qui'
nous ait paru lui être propre ; ce qui nous force de
palier rapidement fur 1a pratique.
Alexandre de Tralles employoit la faignée contre
toutes les inflammations, 8c contre la fyricope que
produit dans les fievres, la plénitude d’humeurs
crues, à.-moins que cette humeur ne fut bilieufe;
car dans ce cas il préféroit, la purgation. Il faignoit
les veines les plus voifines du mal, la jugulaire 8c
les ranines dans refquinançie. Il parle de la dérivation
qu’il pratiquoit en ouvrant la faphene, pour
procurer le flux menflruel aux femmes.
Paul d’Ægine efl le premier qui ait diyifé la .pléthore
en celle qui efl ad vires, oc celle qui efl ad
vafa. Il donne les lignes pour connoître l’une 8c l’an-.
tre, 8c veut qu’op faigne dans toutes les deùx.Juf-r
ques après le feptieme jour. Avant de faigner il, faut
vuider les premier.es voies jlàr'ùh lavement, s’il y a
de la pourriture dans les inteilins..Quant au tems ,dé |
la pratiquer, il préféré ie matin, & défend ; comme
la plupart de fes prédéceffeuj-s, faignée dans Par-- ]
deur du redoublement. Il obferve qü’elle eflutile f
non-feulement pour defemplir les vaifleaux, mais I
encore pour diminuer la grandeur de la maladie. Si |
le malade tombe en défaillance, 8c*que cependant il !
foit dans lè cas 4^ perdre beaucoup de fang, ori y
reviendra plnfieurs fois., plutôt que de tout tirer >
dans une ; tout ce qu’il dit d’ailleurs efl copié, ou
contient des préceptes fur le choix des veines, 8c la
maniéré de pratiquer la faignée en différentes parties
du corps.
Après Paul d’Ægine, la Médecine paroit abandonnée
par les Grecs, pour palier entre les mains des
Arabes, qui faifoient plus d’une conquête fur ëux. '
lis joignirent quelques remedes' ou des méthodes qui
leur étoient p.ropïes, à la dofrrine, des Grecs qu’ils
compilèrent. C’efl ainfi qu’ils crurent reconnoître
avec eux dans la veine céphalique une communication
avec le cerveau; dans la bafilique, avec le bas-
ventre. C’efl ainfi qu’ils ouvrirent prefque toutes les
veines extérieures du corps, dans les différentes af-
feftions ; qu’ils faignoient au pie., pour exciter les
réglés 8cles hémorrhoïdes. Ils s’en écartèrent cependant
dans un point qui a paru elïentiel à Briflbt 8c à
Moreau. Loin de faite faigner comme les G recs, le
plus près du mal qu’il étoit pofljble, ils faignoient du
côté oppofé, dans l’idée où ils étoient qù’on n’ou,-
vroit point une veine, fans attirer fur la partie faignée
une plus grande quantité de fang, qu’il n’ en
lèrtoit. Ifaac-lfraëlite , Avenzoar, Rhazis pcnfoient
ainfi. C e dernier s’autorifoit de Galien, qui fuivant
la remarque de Jacchinus fon commentateur , dit
précifément le contraire.
Avicenne, le prince des médecins arabes, avoit
adopté ce fentiment, il y avoit joint tant d’inconfé-
quences au fujet de faignée., qu’il recommande
l’ouverture de. la veine fciatique ( rameau de la
faphene placé à côté du talon), contre les douleurs
de la cuifle ; celle de la veine^du front 8c du fin-
ciput, de l’artere temporal dans les pefanteurs de
tête, les migraines, &c. qu’il défend la faignée dans
l’hydropifie, 8c qu’il ordonne l’ouverture de certair
iies veines du bas^ventre contre l’afçite. Pour com-r
pofer fon chapitre de là faignée, il avoit mis à contribution
Hippocrate, Rhafis, Sc Galien ; il mérite peu
d’être l i i .^ '
Albucafis compte trente veines ou arteres qui peuvent
être ouvertes, il s’occupe principalement de la
maniéré de les ouvrir ; attaché à la doélrine d’Avicenne
, il ne paroit pas s’en écarter. Copifle comme
lui des Grecs, il répété beaucoup de chofes que nous
trouvons dans leurs ouvrages. Quoiqu’il paroiffe
dans l’opinion que la faignée attire toujours le fang.
dans la veine ouverte,.cependant il recommande
fouyent des fa ignées locales, contre les inflamma-r
lions graves Sc les vives douleurs.
Pendant les quatre_fiecl.es qui fuivirent Avicenne,
fa cloftrine fut fuivie dans la plus.grande partie de
l’Europe, où on cuitivoit la. Médecine. Son nom étoit
alors aufîi refpeélable, que l’efl de np,s jours celui
d Hippocrate» On le regàrdç>it comm,e un . homme
qui avoit porté la fcience médicinale b,eaucpiip au-
delà de fes prédéceffeurs ; on tâchoit de mé.connoî-
tre dans fes ouvrages que,, fi on excepte la matière
medicale, il avoit prefque tout copié,desGreçs. Le
plus grand effort que. purent faire Gordon.; Guy de
Chauhac, ValeTcùs de Tarenta , Savonaroie, <&r. fut
de chercher à concilier, dans le choix des veines, la
dotlrine des Arabes 84 celle dps Grecs. Ces derniers
faigiipiep^ en çonféqüefiçç du çôté ôppofe, qiiànd il
y avoit pléthore ,& du côté njalade quand elle avoit
dimiimé par les faignées y.commç- fi le méchaflifiue
de l’économie animale-,. les lois de l’hydraulique
pouvpient changer; Ces médecins fui voient pour la
quantité de fang ; le tems; les indications, & les
contre - i^diçations ; les maximes, que nous, avons
trouvées dans Galien 8c fes copiiles .grecs & arabes.' -,
. Les oiiyrages des auteurs grogs étant traduits 8i
devenus .communs au commencement du feizietne
fieçle, il étoit juile que les peres de la Médecine
fes vrais légiflateurs rentraient dans leurs .drQits.-
Par la comparaifon qu’on fit d’Hippocrate & de Ga-
1 lieU avec lès Arabes, on ferait,l’infériorité de.ccs
derniers ; bien - tôt leur étude fut négligée. Galien
plus facile a entendre, fut lu 8c enfeigné par,-tout;
les éditions s’en ,multiplièrent avec une rapidité qui
prpuve que le bon goût 8ç la faine philofophie com-
mençoient à naître.
Le choix des veines .occupa alors les Médecins
avec une ardeur que leur zele rendoit louable ; dans
un tems où la .circulation du fang étoit ignorée;
c’étoit fpécialement dans lés inflammations de poitrine,
ejubj paroiffoit intéreflant de décider la question.
Briffât, célébré médecin de Paris , comparant1
le fentiment des Grecs, avec celui des Arabes ; troue :
va le premier plus conforme à la raifon, le fuivit.
dans fa pratique, le publiai dans fes leçons & dans»
fes confuitations. Ses maximes furent goûtées 8c fui-
vies de plufieurs médecins. Etant aile en. Portugal.,,
il y fouffrit une p.erfécution qu’il ne méritoit pasi II
y mourut, laiffant une apologie de fon fentiment, à-
laquelle René Moreau a ajputé j- cent ans apres, u n .
tableau’ chronologique des Médecins, 8c un précis
de leurs ifentimens à ce fujet.
Ce fiecle-yit les médecins partagés en fix opinionl
différentes , au fujet de la faignée dans la pleuréfie.
Les uns, faignoient toujours du côté malade ; les aur
tres du côte oppofé j les troifiemes fuivoient d’abord
la fécondé méthode; enfuite la première, 8c entre-
mêloient les faignée's du pie-; les quatrième?) o.u-
vroient-toujours la yeine du pié. Ve laie conclut de-
la fituâtion de la veine-azygp.s , qui fortant du côté
droit, fournit le fang: à toutes les cotes, fi on excepte
les trois fupérieures- gauches j q,u?on dévoit
toujours faigner du bras droit, excepte-dans le cas
où ces, dernieres feroient le: fiége de la douleur» Il
eut pour fe&ateurs Léonard FuchS'8c Cardan". Un
très-petit nombre- embraffa le fentiment de Nicolas
le Florentin,.quii vivoit au quatorzième fieçle ; il
crut qu’il étpif indifférent d’ouvrir l’une ou l’autre
veine ; l’évacuation Feule lui- paroiffoit mériter Fat-
tention.des Médecins.
L’étude des Grecs devenant toujours plus familière
, les Arabes tombant dans le difcréëit, le plus
grand nombre^deS; médecins fe rangea du parti des
premiers. Briffot remporta, une- vifroire prefque
compiette après fa mort* Rondelet, Craton , Valois;
Argentier, Fernel, Houllier, Duret, toute l’école de
Paris qui l’a voit perféeuté; lui renditdes armes; Il y
eut même des partifans .outrés.- Martin Akakia foutint
dans la chaleur, ded’enthoufiafme-, .que l’opinion des
Arabes avoit tué-plufieurs milliers -d’hommes ; celui-
ci, trouva cependant encore jd’iUuffres défenfeurs.
Scaliger voulant parer les.coups, aecablans pourf
lors, d,e l’autorité., cherchale pÿemier à prouver-par*
les. lois de l ’hydraulique, qw’on de voit faigner rdin
côté oppofé à-celui qui .étoit -affe&e. Toutes ces fec- •
tes montroiént, .conïme -il : n’efl que trop ordinaire:
aux- difeiples ,des grands hommes, plus d’opiniâtreté
dans le fentiment de leurs maîtres, que de raifon-8fii
de bonne foi. Jamais Hippocrate 8c Avicenne rt?au-j
roient difputé avec tant de.chaleur, fur un point qui’
nous paroît à préfent peu important. Il étoit bien
I