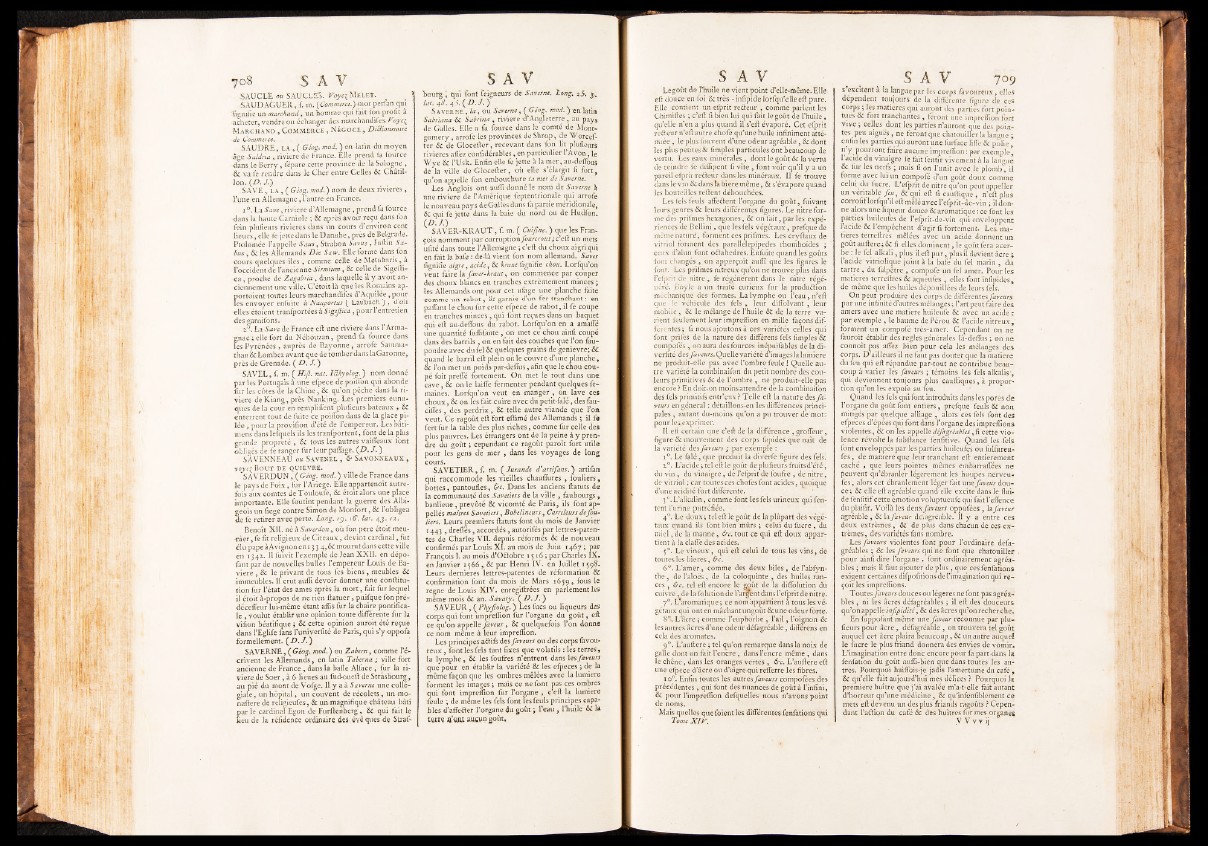
5
7°8 S A V
-SAUCLE «*a S AU CLES. Fq^MÉLET-. ?
SAUDAGUER, 1'. m. (Commerce.) -mot perfan qui ;
fignifie un marchand., un homme qui fait fon profit à
^acheter, vendre ou échanger des marchandifes.Voye\
Marchand , Com m er c e , Nég o ce, Dictionnaire
de Commèree,
SAUDRE, LA , ( Géog. mod. ) en latin du moyen
âge Saldria y riviere de France. Elle prend la fource ■
dans.le Berry, fépare cette province de la Sologne , ;
& va fe rendre dans le Cher entre Celles & Châtil-
ïon. (D . J.)
SAVE, la , ( Géog. mod.) nom de deux rivières , ,
l ’une-en Allemagne, l’autre en France» -
i ° . La Save, riviere d’Allemagne, prend la fource
■ dans la haute Carniole ; & après avoir reçu dans Ion
fein phifieurs rivières dans un cours d’environ cent
lieues, elle fe jettedans le Danube, près de Belgrade.
Ptolomée l’appelle Saus, Strabon Savus, Juftin Sa-
bus , & les Allemands D ie Saw. Elle forme dans fon
cours quelques îles y comme celle de Metubaris., à
l’occident de l’ancienneSirmium, & celle de Sigefti-
ca, proche de Zagabna| dans laquelle il y avoit anciennement
une ville. C’étoit-là que les Romains ap-
portoient toutes leurs marchandifes d’Aquilee, pour
les envoyer enfuite à Nauportus ( Lauhach ) , d’où
elles étoient transportées kSigeJlica, pour l’entretien
des garnifons.
2°-» La Save de France eft une riviere dans l’Armagnac
; elle fort du Nébouzan, prend fa fource dans
les Pyrénées , auprès de Bayonne, arrofe Samma-
than & Lombez avant que de tomber dans la Garonne,
près de Grenade. ( D . J . )
SAVEL, f. m. ( Hift. nat. Icthyolog. ) nom donné
par les Portugais à une efpece de poiffon qui abonde
fur les côtes de la Chine, & qu’on pêche dans la riviere
de Kiang, près Nanking. Les premiers eunuques
de la cour en rempliffent plufieurs bateaux , &
enterrent tout de fuite ce poiffon dans de la glace pilée
, pour la provifion d’été de l’empereur. Lesbâti-
mens dans lelquels ils les tranfportent, font de la plus
grande propreté , & tous les autres vaiffeaux font
obligés de fe ranger fur leur paffage. (D . J . )
SAVENNEAU ou Savenel , & Sàvonneaux ,
voye{ Bout de quievre.
S AVERDUN, ( Géog. mod. ) ville de France dans
le pays de Foix, fur l’Ariege. Elle appartenoit autrefois
aux comtes de Touloule, & étoit alors une place
importante. Elle foutint pendant la guerre des Albigeois
un fiege contre Simon de Monfort, & l’obligea
de fe retirer avec perte. Long. tg . iC. lac. 4 3 . 12.
Benoît XII. né à Saverdon, oh fon pere étoit meu-
•nier, fe fit religieux de Cîteaux, devint cardinal, fut
élu pape à Avignon en 1 3 3 4, & mourut dans cette ville
en 1342.. Il fuivit l’exemple de Jean XXII. en dépor
fant par de nouvelles bulles l’empereur Louis de Bavière
, & le privant de tous fes biens, meubles &
immeubles. Il crut auffi devoir donner une conftitu-
tion fur l’état des âmes après la mort, fait fur lequel
il étoit à-propos de ne rien ftatuer, puifque fon pré-
décèffeur lui-même étant affis fur la chaire pontificale
, voulut établir une opinion toute différente fur la
vifion béatifique ; & cette opinion auroit été reçue
dans l’Eglife lans l’univerfité de Paris, qui s’y oppofa
formellement. ( D . J . )
SAVERNE, ( Géog. mod.) ou Zabern, comme l’écrivent
les Allemands, en latin Taberna ; ville fort
ancienne de France, dans la balle Alface , fur la riviere
de Soer, à 6 lieues au fud-oueft de Strasbourg,
au pié du mont de Vofge. Il y a à Saverne une collégiale
, un hôpital, un couvent de récolets, un mo-
naftere de religieufes, & un magnifique château bâti
par le cardinal Egon de Furftenberg, & qui fait le
Heu de la réfidence ordinaire des- éyê ques de Straf-
S A V
bourg ^ qui font feigneurs de Saverne. Long. 2$.
lat. 48. 46. ( D . J . )
Saverne, la , ou Sèveme, ( Géog. 'mod. ) en latin
Sabriana & Sabrina , riviere d’Angleterre, au pays
de Galles. Elle a fa fource dans le comté ’de Montgomery
, arrofe les provinces de Shrop, de Worcef-
ter & de Glocefter, recevant dans fon lit plufieurs
rivières allez confidérablés, eh particulier l’Avon, le
Wye & l’Usk. Enfin elle le jette à la mer, au-deffous
de la ville de Glocefter, où elle s’élargit fi fort,
qu’on appelle fon embouchure la mer de Saverne.
Les Aftglois ont auffi donné le nom de Saverne à
une riviere de l’Amérique feptentrionale qui arrofe
le nouveau pays de Galles dans fa partie méridionale,
&: qui fie jette dans la baie du nord ou de Hudfon»
( d , j .) I
SAVER-KRAUT, f. m. ( Cuifine. ) que les François
nomment par corruption fourcrout; c’eft un mets
ufité dans toute l’Allemagrie ; c’eft du choux aigri qui
en fait la bafe ■: de-là vient fon nom allemand. Saver
lignifie aigre, acide, & kraut lignifie chou. Lorfiqu’on
veut faire la faver-kraut, on commence par couper
des choux blancs en tranches extrêmement minces ;
les Allemands ont pour cet ufage une planche faite
comme un rabot, & garnie d’un fer tranchant : en
paffant le chou fur cette efpece de rabot, il fe coupe
en tranches minces, qui font reçues dans un baquet
qui eft au-deffous du rabot. Lorfqu’on en a amaffé
une quantité fuffifante , on met ce chou ainfi coupé
dans des barrils , on en fait des couches que l'on fau-
poudre avec dufel & quelques grains de genievre; &
quand le barril eft plein on le couvre d’une planche,
& l’on met un poids par-deffus, afin que le chou coupé
foit preffé fortement. On met le tout dans une
cave, & on le laiffe fermenter pendant quelques fe-
maines. Lorfqu’on veut en manger , on lave ce*
choux, & on les fait cuire avec du petit-falé, des faucilles
, des perdrix, & telle autre viande que l’on
veut. Ce ragoût eft fort eftimé des Allemands ; il f«
fert fur la table des plus riches, comme fur celle de*
plus pauvres. Les étrangers ont de la peine à y prendre
du goût ; cependant ce ragoût paroît fort utile
pour les gens de mer , dans les voyages de long
cours.
SAVETIER, f. m. ( Jurande d'artifans. ) artifan
qui raccommode les vieilles chauffures , louliers,
bottes, pantoufles, &c. Dans les anciens ftatuts de
la communauté des Savetiers de la ville , faubourgs ,
banlieue, prévôté & vicomté de Paris, ils font ap-
pellés maîtres Savetiers, Bobelineurs, Carreleurs de fou-
tiers. Leurs premiers ftatuts font du mois de Janvier
1443 , dreffes, accordés, autorifés par lettres-patentes
de Charles VII. depuis réformes & de nouveau
confirmés par Louis XI. au mois de Juin 1467; par.
François I. au mois d’Oftobre 15 16 ; par Charles IX.
en Janvier 1566, & par Henri IV. en Juillet 1598.
Leurs dérnieres lettres-patentes de réformation &
confirmation font du mois de Mars 1659, fous le
régné de Louis XIV. enregiftrées en parlement les
meme mois & an. Savary. ( D . J . )
SAVEUR, ( Phyjiolog. ) Les fucs ou liqueurs des
corps qui font impreflion fur l’organe du goût, eft
ce qu’on appelle faveur, & quelquefois l’on donne
ce nom même à leur impreflion.
Les principes aâifs des faveurs ou des corps favou-
reux , font les fels tant fixes que volatils : les terres 9
la lymphe, & les foufres n’entrent dans les faveurî
que pour en établir la variété & les efpeces ; de la
même façon que les ombres mêlées avec la lumière
forment les images ; mais ce ne font pas ces ombres
qui font impreflion fur l’organe , c’eft la lumière
feule ; de même les fels font les feuls principes capables
d’affeéier l’organe du goût ; l’eau , l’huile & la
terre u’wtf aucun goût,
S A V
Le goût de l’huile ne vient point d’elle-même. Elle
eft douce en foi & très - inlipide lorfqu’elle eft pure.
Elle contient un efprit refteur , comme parlent les
Chimiftes ; c’eft li bien lui qui fait le goût de l’huile,
qu’elle n’en a plus quand il s’eft évaporé. Cet efprit
reôeur n’eft autre chofe qu’une huile infiniment atténuée
, le plus foüvent d’une odeur agréable, & dont
les plus petites & Amples particules ont beaucoup de
vertu. Les eaux minérales , dont le goût & la vertu
de teindre fe diflipent li vîte , font voir qu’il y a un
pareil efprit refteur dans les minéraux. Il fe trouve
dans le vin & dans ta biere même, & s’évapore quand
les bouteilles relient débouchées.
Les fels feuls affeûent l’organe du goût, fuivant
leurs genres & leurs différentes figures. Le nitre forme
des prifmes hexagones, & on fait, par les expériences
de Bellini, que les fels végétaux, prefque de
mêmenaturé, forment ces prifmes. Les cryftaux de
vitriol forment des parallelepipedes rhomboïdes ;
ceux d’alun font o&ahedres. Enfuite quand les goûts
font changés , on àpperçoit auffi que les figures le
font. Les prifmes nitreux qu’on ne trouve plus dans
l’efprit de nitre , fe régénèrent dans le nitre régénéré.
Boy le a un traité curieux fur la produ&ion
méchanique des formes. La lymphe ou l’eau, n’eft
que le véhicule des fels , leur diffolvant , leur
mobile, & le mélange de l’huile & de la terre varient
feulement leur impreflion en mille façons différentes
; li nous ajoutons à ces variétés celles qui
font prifes de la nature des différens fels Amples &
compofés , on aura des fources inépuifables de la di-
verfité des faveurs. Quelle variété d’imagesla lumière
ne produit-elle pas avec l’ombre feule ! Quelle autre
variété la combinaifon du petit nombre des couleurs
primitives & de l’ombre , ne produit-elle pas
encore? En doit-on moins attendre de la Combinaifon
des fels primitifs entr’eux? Telle eft la nature des fa veurs
en général : détaillons-en les différences principales,
autant du-moins qu’on a pu trouver de mot;
pour les exprimer.
Il eft certain que c’eft de la différence , groffeur,
figure & mouvement des ebrps fapides que naît de
la variété dés faveurs ; par exemple :
i°. Le falé, que produit la diverfe figure des fels.
20. L’acide ; tel eft le goût de plufieurs fruitsd’été,
du vin , du vinaigre, de l’efprit de foufre , de nitre,
de vitriol ; car toutes ces chofes font acides, quoique
d’une acidité fort différente.
30. L’alkalin, comme font les fels urineux qui fen-
tent l’urine putréfiée.
40. Le doux ; tel eft le goût de la plûpart des végétaux
quand ils font bien mûrs ; celui du fucre , du
miel, de la manne, &c. tout ce qui eft doux appar-r
tient à la claffe des acides.
50. Le vineux, qui eft celui de tous les vins, de
toutes les bierés, &c.
6°. L’amer, comme des deux biles, de l’abfyn-
the, de l’aloës, de la coloquinte , des huiles rances
, &c. tel eft encore le goût de la diffolution du
cuivre, de la folutionde l’argentdans l’efprit de nitre.
7°. L’aromatique ; ce nom appartient à tous lés végétaux
qui ont en mâchant ungoût&;u.ne odeur forte.
8°». L’âcre ; comme l’eùphorbe , l’ail, l’oignon &
les autres âcres d’une odeur défagréable, differens en
cela des aromates.
90. L’auftere ; tel qu’on remarque dans la noix de
galle dont on fait l’encre, dans l’encre même , dans
le chêne, dans les oranges vertes , &c. L’auftere eft
une efpece d’âcre ou d’aigre qüi' refferre les fibres.
io°. Enfin toutes les autres faveurs compofées.des
précédentes, qui font des nuances de goût à l’infini,
& pour l’impreflion defquelles nous n’avôns point
de noms.
Mais quelles quefoientles différentes fenfations qui
Tome X IV .
S A V 709
s’excitent à la langue par les corps favoureux, elles
dépendent toujours de la différente figure de ces
corps ; les matières qui auront des parties fort pointues
& fort tranchantes , feront une impreflion fort
vive ; celles dont les parties n’auront que des pointes
peu aiguës, ne feront que chatouiller la langue ;
enfin les parties qui auront une furface liffe & polie ,
n’y pourront faire aucune impreflion: par exemple,
1 acide du vinaigre fe fait fentir vivement à la lanme
& fur les nerfs ; mais Aon l’unit avec le plomb° il
forme avec lui un compofé d’un goût doux comme
celui du fucre. L’efprit de nitre qu’on peut appeller
un véritable feu , & qui eft A cauftique , n’eft plus
corrofif lorfqu’il eft mêlé avec l’efprit-de-vin ; il donne
alors une liqueur douce & aromatique : ce font les
parties huileufes de l’efprit-de-vin qui enveloppent
l’acide & l’empêchent d’agir fi fortement. Les. matières
terreftres mêlées avec un acide donnent un
goût auftere; & fi elles dominent, le goût fera acerbe
: le fel alkali, plus il eft pur, plus il devient âcre ,
l’acide vitriolique joint à la bafe du fel marin , du
tartre , du falpêtre , compofe un fel amer. Pour les
matières terreftres & aqueufes , elles font infipides,
de même que les huiles dépouillées de leurs fels.
On peut produire des corps de différentes faveurs
par une infinité d’autres mélanges ; l’art peut faire des
amers avec une matière huïleufe & avec un acide r
par exemple , le baume de Pérou & l’acide nitreux,
forment un compofé très-amer. Cependant on ne
fauroit établir des réglés générales là-deflits ; on ne
connoît pas affez bien pour cela les mélangés des
corps. D’ailleurs il ne faut pas douter que la matière
du feu qui eft répandue par-tout ne contribue beaucoup
à varier les faveurs ; témoins lés fels alkalis',
qui deviennent toujours plus cauftiques, à proportion
qu’on les expofe au feu.
Quand les fels qui font introduits dans les porés de
l’organe du goût font entiers, prefque' feuls & non
mitigés par quelque alliage , aloirs Ces fèls font des
efpeces d’épees qui font dans l’organe des impreffions
violentes, & on les appelle défagréables, fi cette violence
révolte la fubftance fenfitive. Quand les rfels
font enveloppés par les parties huileules ou fulfureu-
fes, de maniéré que leur tranchant eft entièrement
caché , que leurs pointes mêmes embarraffées ne
peuvent qu’ébranler légèrement les houpes nerveu-
fes, alors cet ébranlement léger fait une faveur douce;
& elle eft agréable quand elle excite dans le fluide
fenfitif cette émotion voluptueufe qui fait l'effence
du plaifir. Voilà les deux faveurs oppofées , la;faveur
agréable, Scia faveur defagréable. Il y a entre ces
deux extrêmes, & de plus dans chacun de ces extrêmes
, des variétés fans nombre.
Les faveurs violentes font pour l’ordinaire defa-
gréables ; & les faveurs qui ne font que chatouiller
pour ainfi dire l’organe.., font ordinairement agréables
; mais il faut ajouter de plus ,;que ces fenfations
exigent certaines difpofitions de l’imagination qui reçoit
les impreffions.
Toutqs faveurs douces ou légères né font pas agréables
, ni les âcres défagréables ; il eft des douceurs
qu’on appelle infpiditè, & des âcres qu’on recherche.
En fuppofant même une faveur reconnue par plufieurs
pour âcre, défagréable, on tfoUvera tel goût
auquel cet âcre plaira beaucoup, & un autre auquel
le fucre le plus friand donnera des envies de vomir.
L’imagination entre donc encore pour fa part dans la
fenfation du goût auffi-bien que dans toutes les autres.
Pourquoi haiffois-je jadis l’amêrtume du café ,
& qu’elle fait aujourd’hui mes délices ? Pourquoi la
première huître que j’ai avalée m’a-t-elle fait autant
d’horreur qu’une médicine , & qu’jnfenfiblement ce
mets eft devenu un des plus friands ragoûts ? Cependant
l’aûion du café & des huîtres fur mes organes