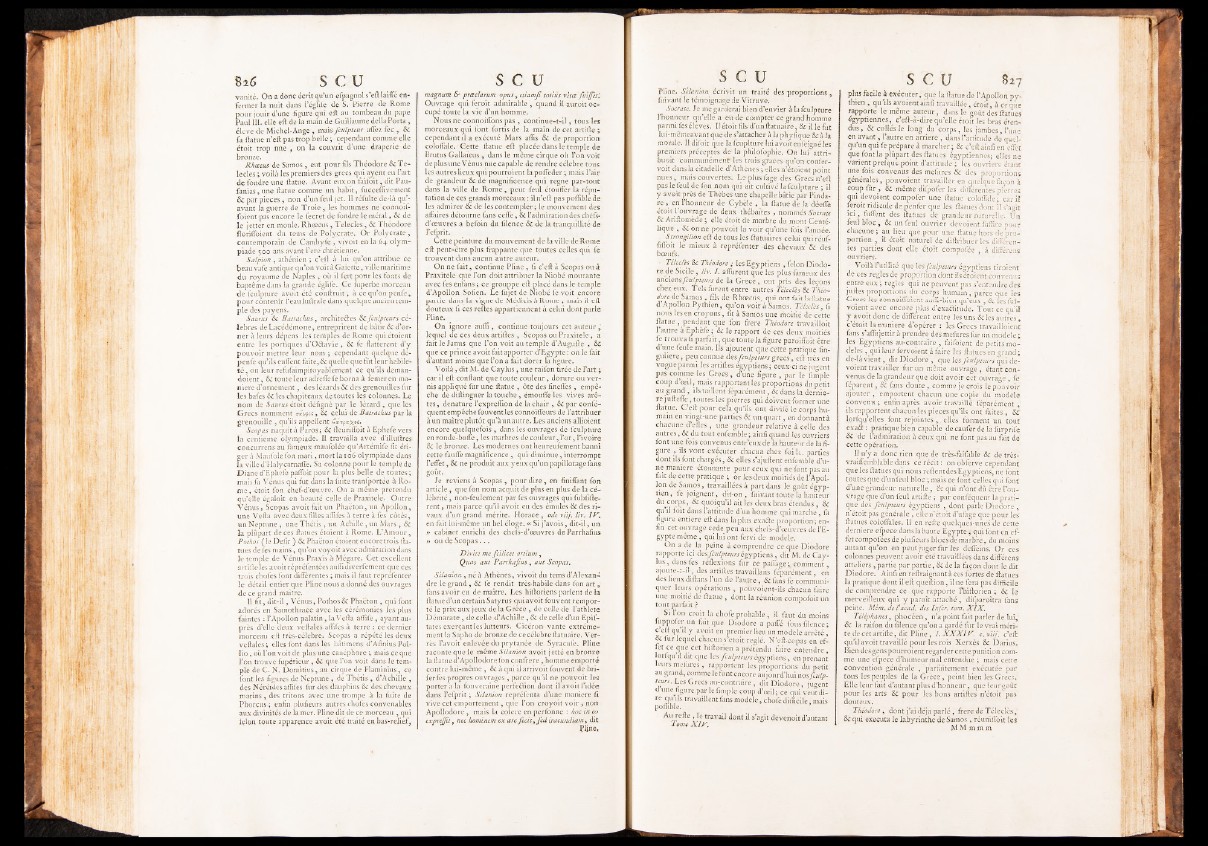
vanité. On a donc écrit qu’un efpagnols’eftlaiffé enfermer
la nuit dans l’églile de S. Pierre de Rome
pour jouir d’une figure qui eft au tombeau du pape
Paul III. elle eft de la main de Guillaume délia Porta ,
éleve de Michel-Ange , mais Jculpteur allez fec , 8c
fa ftatue n’eft pas trop belle ; cependant comme elle .
étoit trop nüe , on la couvrit d’une draperie de
bronze.
Rhoecus de Samos, eut pour fils Théodore 8c Te-
lecles ; voilà les premiers des grecs qui ayent eu l’art
de fondre une ftatue. Avant eux on faifoit, dit Pau?
fanias,une ftatue comme un habit, fucceffivement
& par pièces, non d’un feul jet. Il réfulte de-là qu’avant
la guerre de T ro ie , les hommes ne connoif-
foient pas encore le fecret de fondre le métal, 8c de
le jetter en moule. Rhoecus, Telecles, 8c Théodore
florifloient du tems de Polycrate. Or Polycrate,
contemporain de Cambyfe, vivoit en la 64 olympiade'
500 ans avant l’ere chrétienne.
Salpion , athénien ; c’eft à lui qu’on attribue ce
beau vafe antique qu’on voit à Galette, ville maritime
du royaume de Naples , oh il fert pour les fonts de
baptême dans la grande églife. Ce fuperbe morceau
de fculpture avoit été conftruit, à ce qu’on penfe,
pour contenir l’eau luftrale dans quelque ancien temple
des payens.
Sauras 8c Batrachus, archite&es 8c fculpteurs célébrés
de Lacédémone, entreprirent de bâtir 8c d’o rner
à leurs dépens les temples de Rome qui étoient
entre les portiques d’O & a v ie, 8c fe flattèrent d’y
pouvoir mettre leur nom ; cependant quelque de-
penfe qu’ils euffent faite, 8c quelle que fût leur habilet
é , on leur refufaimpitoyablement ce qu’ils deman-
doient, 8c toute leur adrefl'e fe borna à femer en maniéré
d’ornement, des lézards 8c des grenouilles fur
les bafes 8c les chapiteaux de toutes les colonnes. Le
nom de Saurus étoit défigné par le lézard , que les
Grecs nomment ovivpcç , Sc celui de Batrachus par la
grenouille , qu’ils appellent
S copas naquit à Paros ; 8c fleurifîbit à Ephefe vers
la centième olympiade. Il travailla avec d’illuftres
concurrens au fameux maufolée qu’Artémife fit ériger
à Maufole fon mari, mort la 106 olympiade dans
la ville d’Halycarnaffe. Sa colonne pour le temple de
Diane d’Ephefe paffoit pour la plus belle de toutes ;
mais fa Vénus qui fut dans la fuite tranfportée à Rome
, étoit fon chef-d’oeuvre. On a même prétendu
qu’elle égaloit en beauté celle de Praxitèle. Outre-
Yénus, Scopas avoit fait un Phaëton, un Apollon,
une Vefta avec deux filles aiïifes à terre à fes côtés,
un Neptune , une Thétis , un Achille, un Mars , 8c
la plupart deces ftatues étoient à Rome. L’Amour,
Pothos ( le Defir ) 8c Phaëton étoient encore trois ftatues
de les mains, qu’on voyoit avec admiration dans
le temple de Vénus Praxis àMégare. Cet.excellent
artifteîesavoit répréfentéesauffidiverfement que ces
trois choies font différentes ; mais il faut reprefenter
le détail entier que Pline nous a donné des ouvrages
de ce grand maître.
Il fit, dit-il, Vénus, Pothos 8c Phaëton , qui font
adorés en Samothrace avec les cérémonies les plus
faintes : l’Apollon palatin, la Vefta aflife, ayant auprès
d’elle deux veftales aflifes à terre : ce dernier
morceau eft très-célebre. Scopas a répété les deux
veftales ; elles font dans les bâtimens d’Afinius Pol-
lio , oh l’on voit de plus une canéphore ; mais ce que
l’on trouve fupérieur , 8c que l’on voit dans le temple
de C. N. Domitius, au cirque de Flaminius, ce
font les figures de Neptune , de Thétis , d’Achille ,
des Néréides aflifes fur des dauphins 8c des chevaux
marins, des tritons avec une trompe à la fuite de
Phorcus ; enfin plufieurs autres chofes convenables
aux divinités de la mer. Pline dit de ce morceau , qui
lelon toute apparence avoit été traité en bas-relief,
magnum & proeclarum opus, ctiamji toùiis vitcefulffetl
Ouvrage qui feroit admirable , quand il auroit occupé
toute la vie d’un homme.
Nous ne connoiffons pas , continue-t-il, tous les
morceaux qui font fortis de la main de cet artifte ;
cependant il a exécuté Mars aflis 8c de proportion
coloffale. ■ Cette ftatue eft placée dans le temple de
Brutus Gallaïcus , dans le même cirque oh l’on voit
de plus une Vénus nue capable de rendre célébré tous
les autres lieux qui pourroient la poffeder ; mais l ’air
de grandeur 8c de magnificence qui régné par-tout
dans la ville de Rome, peut feul étouffer la réputation
de ces grands morceaux : il n’eft pas pofliblede
les admirer 8c de les contempler ; le mouvement des
affaires détourne fans ceffe, & l’admiration des chéfs-
d’oeuvres a befoin du lilence 8c de la tranquillité de
l’efprit.
Cette peinture du mouvement de la ville de Rome
eft peut-être plus frappante que toutes celles qui fe
trouvent dans aucun autre auteur.
On ne fait, continue Pline , fi c’eft à Scopas ou â
Praxitèle que l’on doit attribuer la Niobé mourante
avec fes enfans ; ce grouppe eft placé dans le temple
d’Apollon Sofien. Le fujet de Niobé fe voit encore
partie dans la vigne de Médicis à Rome ; mais il eft
douteux fi ces reftes appartiennent à celui dont parle
Pline.
On ignore aufli, continue toujours cet auteur
lequel de ces deux artiftes , Scopas ou Praxitèle, a
fait le Janus que l’on voit au temple d’Augufte , 8c
que ce prince avoit fait apporter d’Egypte : on le fait
d’autant moins que l’on a fait dorer la figure.
Voilà, dit M. de Caylus, une raifon tirée de l’art ;
car il eft confiant que toute couleur, dorure ou vernis
appliqué fur une ftatue , ôte des fineffes , empêche
de diftinguer la touche, émouffe les vives arêtes
, dénaturé l’expreflion de la chair , 8c par confé-
quent empêche fouvent les connoiffeurs de l’attribuer
à un maître plutôt qu’à un autre. Les anciens allioient
encore quelquefois , dans les ouvrages de fculpture
en ronde-boue, les marbres de couleur, l’or, l’ivoire
8c le bronze. Les modernes ont heureufement banni
cette faillie magnificence , qui diminue, interrompt
l’effet, 8c ne produit aux yeux qu’un papillotage fans
goût.
Je reviens à Scopas , pour dire, en finiffant fon
article, que fon nom acquit de plus en plus de la célébrité
, non-feulement par fes ouvrages qui fubfifte-
rent, mais parce qu’il avoit eu des émules 8c des rivaux
d’un grand mérite. Horace , ode viij. liv. IV .
en fait lui-même un bel éloge. « Si j ’avois, dit-il, un
» cabinet enrichi des chefs-d’oeuvres de Parrhafius
» ou de Scopas. . .
Divile me fdit cet artium ,
Quas aut Parrhafius , aut Scopas.
Silanion, né à Athènes, vivoit du tems d’Alexandre
le grand, & fe rendit très-habile dans fon a r t ,
fans avoir eu de maître. Les hiftoriens parlent de la
ftatue d’un certain Satyrus qui avoit fouvent remporté
le prix aux jeux de la Grece , de celle de l’athlete
Démarate , de celle d’Achille , 8c de celle d’un Epif-
tates exerçant les lutteurs. Cicéron vante extrêmement
la Sapho de bronze de ce célébré ftatuaire. Verrès
l’avoit enlevée du prytanée de Syracufe. Pline
raconte que le même Silanion avoit jetté eu bronze
la ftatue d’Apollodorç fon confrère, homme emporté
contre lui-même , 8c à qui il arrivoit fouvent de bri-
ferfes propres ouvrages , parce qu’il ne pouvoit les
porter à la fouveraine perfection dont il avoit l’idée
dans l’efprit ; Silanion repréfenta d’une maniéré fi
vive cet emportement, que l’on croyoit voir , non
Apollodore , mais la colere en perfonne : hoc ineo
exprejfit, me hominem ex are fecit, fed iracundiatn, dit
Çljne,
Pline. Silanion écrivit un traité des proportions,
fuivant le témoignagè de Vitruve.
Socrate. Je me garderai bien d’envier à la fculpture
l’honneur qu’elle a eu de compter ce grand homme
parmi fes éleves. Il étoit fils d’un ftatuaire, & il le fut
lui-mêmeavant que de s’attacher à la phiyfique 8c à-ia
morale. Il difoit que lafcuplture lui avoit enfèiené les
premiers préceptes de la philofophie. On lui attri-
buoit communément? les trois grâces qu’on confer-
voit dans la citadelle d’Athènes ; elles n’étôient point
nues, mais couvertes, Leplusfage des Grecs n’eft
pas le feul de fon .nom qui ait cultivé la fculpture ; il
y avoit près de Thèbes une chapelle bâtie par Pinda-
r e , en l’honneur de Cybèle , la ftatue de la déeffe
étoit l ’ouvrage de deux thébaïtes , nommés Socrate
8c Ariftomède; elle étoit de marbre du mont Centé-
lique , 8c on ne pouvoit la voir qu’une fois l’année.
Strongilion eft de tous les ftatuaires celui qui réuf-
fifloit le mieux à repréfenter -des chevaux 8c des
boeufs.
- Telecles Sc Théodore ; les Egyptiens , félon Diodo-
re de Sicile, liv. 1. afliirent que les plus fameux des
anciens fculpteurs de la Grece, ont pns des leçons
chez eux. Tels furent entre autres Téléc lès 8c Théodore
de Samos , fils de Rhoecus, qui ont fait la ftatue
d’Apollon Pythien, qu’on voir à Samos. Tcleclès, fi
nous les en croyons , fit à Samos une rhoitié de cette
ftatue , pendant que fon frere Théodore travaillât
l’autre à Ephèfe ; 8c le rapport de c es deux moitiés
fe trouva fi parfait, que toute la figure paroifloit être
d’une feule main. Ils ajoutent que cette pratique fin-
guliere, peu connue des fculpteurs grecs, eft très en
vogue parmi les artiftes égyptiens ; ceux-ci ne jugent
pas comme les Grecs , d’une figure , par lé fimple
coup d’oeil, mais rapportant les proportions du petit
au grand , ils taillent féparément, 8c dans la dernière
juftefîc , toutes les pierres qui doivent former une
ftatue. C’eft pour cela qu’ils ont divifé le corps humain
en vingt-une parties 8c un quart, en donnant à
chacune d’elles , une grandeur relative à celle des
autres, 8c du tout enfemble ; ainfi quand les ouvriers
font une fois convenus entr’euxde la hauteur de la figure
, ils vont exécuter chacun chez foi le. parties
dont ils font chargés, 8c elles s’ajuftent enfemble d’une
maniéré étonnante pour ceux qui ne font pas ait
fait de cette pratique ; or les deux moitiés de l’Apollon
de Samos, travaillées à part dans le goût égyptien
, fe joignent, dit-on , fuivant toute la hauteur
du corps, 8c quoiqu’il ait lès deux bras étendus , 8c
qu’il foit dans l’attitude d’un homme qui marche, fa
figure entière eft dans la plus exaéle proportion\ enfin
cet ouvrage cede peu aux chefs-d’oeuvres de l’Egypte
même , qui lui ont fervi de modèle.
On a de la peine à comprendre ce que Diodore
rapporte ici lies fculpteurs égyptiens, dit M. de.Cay-
lus , dans fes reflexions fur ce paffage ^ epmment,
ajoute-t-il, des artiftes travailla ns féparément, en
des lieux diftans l’un de l’autre, 8c fans fe communiquer
leurs opérations , potivoient-ils chacun faire
une moitié de ftatue , dont la réunion compofoit un
tout parfait ?
Si l’on croit la chofe probable, il faut du moins
fuppofer un fait que Diodore a paflé fousfilence;
c eft qu il y avoit en premier lieu un modèle arrêté ,
& fur lequel chacun s’etoit réglé. N’eft-cepas en effet
ce que cet hiftorien a prétendu faire entendre ,
lorfqu il dit que les fculpteurs égyptiens, en prenant
leurs mefures , rapportent les proportions du petit
au grand, comme le font encore aujourd’hui nosfulp-
tcurs. Les Grecs au-contraire , dit Diodore, jugent
d une figure.par le fimple coup d’oeil; ce qui veutdi-
re qu’ils travaillent fans modèle, chofe difficile, mais
poffible.
Au refte , le travail dont il s’agit devenoit d’autant
Tome XIV.
plus facile k exécuter, que la ftatue de l’Apollon pythien
, qu’ils avoient ainfi travaillée, étoir, à ceqiie
rapporte le même auteur, dans le goût desftatues
égyptiennes,^ c’eft-à-direqu’elle étoit les bras étendus
, & collés le long du corps, les jambes, l’une
en avant, l’autre en arriéré , dans l’attitude de quelqu’un
qui fe prépare à marcher ; & c’eft ainfi en effet
que font la plûpart des ftatues égyptiennes; elles ne
varient prefque point d’attitude ; les ouvriers étant
une fois convenus des mefures & des proportions
générales, pouvoient travailler en queloue façon à
coup fûr , & même difpôfer lès différentes pierres
qui dévoient, compofer une ftatue coloffale; car il
leroit ridicule de penfer que les ftatues dont il s’agit
ic i , fuffent des ftatues de grandeur naturelle. Un
feul bloc, & un feul ouvrier dévoient fuffire pour
chacune ; au lieu que pour' une ftatue hors de proportion
, il étoit naturel de diftribuer les différentes
parties dont elle étoit compofée , à différens
Ouvriers.'
Voilà l’utilité que les fculpteurs égyptiens tiroient
de ces réglés de proportion dont ils é'toient convenus
entre eux ; réglés qui ne peuvent pas s’entendre des
juftes proportions du corps humain, parce que les
Grecs les connoiflbient auifi-bien qu’eux , 8c les fui-
voient avec encore plus d’exa&itude. Tout ce qu’il
ÿ avoit donc de différent entre les uns 8c les autres,
c’étoit la maniéré d’opérer : les Grecs travailloient
fans s’affujettir à prendre des mefures fur un modèle ;
les Egyptiens au-êôntràire , faifoient de petits modèles
, qui leur fervoient à faire les ftatues en grand;
de-là vient, dit D iodore', que les fculpteurs qùi dévoient
travailler fur un même ouvrage , étant convenus
de la grandeur que doit avoir cet ouvrage , fe
féparent, 8c fans doute, comme je crois le pouvoir
ajouter / emportent chacun une copie du modèle
convenu ; enfin après avoir travaillé féparément ,
ils rapportent chacun les pièces qu’ils ont faites , 8c
lorfqq’elles font rejointes , / elles forment un tout
exa& : pratique bien capable de caufer de la furprife
8c de l’admiration à ceux qui ne font pas au fait dé
cette opération.
Il n’y a donc rien que de très-faifable 8c de très-
vraiffemblable dans ce récit : on obferve cependant
que les ftatues qui nous reftent des Egyptiens, ne font
toutes que d’unfeul bloc ; mais ce font celles qui font
d’une grandeur naturelle, 8c qui n’ont dû être l’ouvrage
que d’un feul artifte ; par conféquent la pratique
des fculpteurs égyptiens , dont parle Diodore ,
n etoit pas générale , elle n’étoit d’ufage que pour les
ftatues coloflales. Il en refte quelques-unes de cette
derniere efpece dans la haute Egypte ; qui font en effet
compofées de plufieurs blocs ae marbre, du moins
autant qu’on en peut juger fur les deffeins. Or ces
colonnes peuvent avoir été travaillées dans différens
atteliers , partie par partie, 8c de la façon dont le dit
Diodore. Ainfi en reftraignant à ces fortes de ftatues
la pratique dont il eft queftion, il ne fera pas difficile
de comprendre ce que rapporte Phiftorien ; 8c le
merveilleux qui y paroît attaché , difparoîtra fans
peine. Mém. de Vacad. des Infer. tom. X IX .
T éléphants, phocéen, n’a point fait parler de lui,'
8c la raifon du filence qu’on a gardé fur le vrai mérite
de cet artifte, dit Pline, l. X X X IV . c. viij. c’eft
qu’il avoit travaillé pour les rois Xerxès Sc Darius.
Bien des gens pourroient regarder cette punition comme
une efpece d’humeur mal entendue ; mais cette
convention générale , parfaitement exécutée par
tous les peuples de la Grèce, peint bien les Grecs.
Elle leur fait d’autant plus d’honneur, que leur goût
pour les arts 8c pour les bons artiftes n’étoit pas
douteux.
Théodore , dont j’ai déjà parlé, frere de Téleciès,
8c qui exécuta le labyrinthe de Samos, réuniffoit les
M M m m m