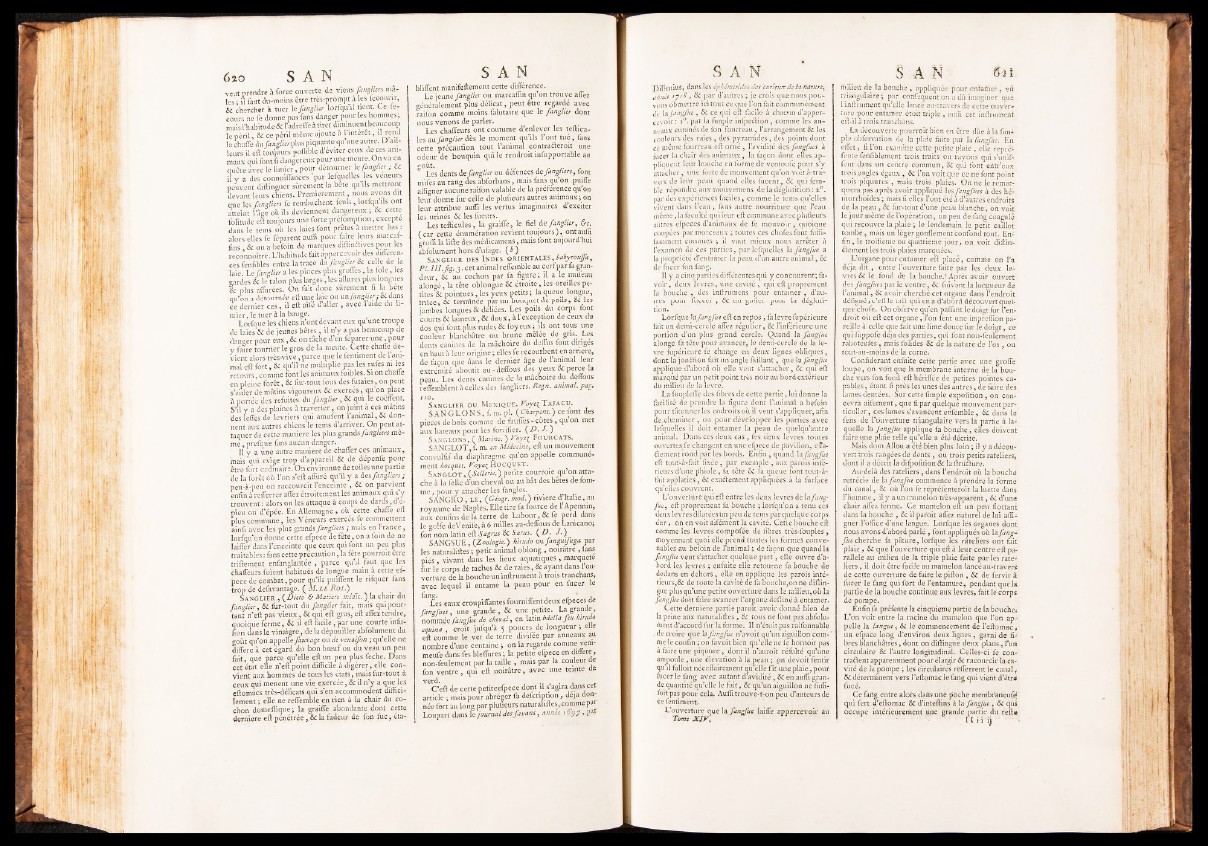
■ veut prendreI force ouverte de vieuxfangUcrs H
les ; il faut du-tnoins être très-prompt;| les tecourir,
St chercher à tuer 1 efanglier lorfqu’il tient. Ce dey
cours ne fe donne pas fans danger pour les hommes; 1
thaïs l^abitude&fadrede à tirer diminuentbeaiieoup
le péril, 8c ce péril même ajoute à 1 intérêt, il_reni
la chafle du fanglier plus piquante qu une autre. U n i
leurs il eft toujours poffible d’éviter ceux d e c e s aH H
maux qui font fi dangereux pour une meute. On va en
quête avec le limier I pour détourner \é fanglier ; 8C
il y a des connoilVances -par lefcjuelles les venevttS
peuvent diftinguer sûrement la bctc qu'ils mettront
devant leurs chiens. IVcr.üeremcr.t, nous avons dit
H fangliers fe rembuchent feuls , lorfquils ont
atteint H H deviennent dangereux ; 8c cette
m m eu toiijours une forte préfomption, excepte
dans le teins où les laies font prêtes à mettre bas :
alois elles fe féparent aufli poui faire leuis marcaf-
fins & on a befêin de marques diftinSives H |
rccomioître. L'habitude fait appercevoir tics différences
ïenfibles entre là trace i l— HUM& H B U
laie. L efanglier a lés pinces plus greffes, M ç lp ,les
garcles 8c le talon plus larges, les allures p lt^mgsies ,
& plu affurée On fait donc tnement fi la bete
qu’on a détournée eftune laie ou unfanglier; &.dans
•ce dernier ê#» >1 eft aSS d’aller , ayec l’aide du knii’â
i le tuer à la bauge. , .
1 : Ldrfqüëlês chiens n’cr.t devant eux qu une troupe
‘de laies 8c de jeunes bêtes , il n’y a pas beaucoup de
danger peur eux, & on tâche d’en féparer une , pour
y faire tourner le gros vie la meute. Cette chalié devient
alors îfèsjyive, parce que le fentiment de l’aniy
mai èft fë r t, 8c qu’il ne multiplie pas les raies n i les
retours, comme font icsar.iinaux foibles. Si on chalié
en pleine fOfêt, 8c futetout fijùsifles futaies, on peut
s%iâèi de mâtins vigoureux 8c exercés, qu’on place
‘à portée dès refuites du fanglier, Sc qui le coëffent.
;S’il y a dès plaines à traverfer, on joint à ces mâtins
des leffes de lévriers qui amufent l’animal, Sc donnent
aux autres chiens le tems d’arriver. On peut attaquer
de cette maniéré les plus grand s fangliers même
, prefque fans aucun danger.
Il y a une autre maniéré de chafler ces animaux,
mais qui exige trop d’appareil Sc de dépenfe pour
être fort ordinaire. On environne de toiles une partie
de la forêt où l ’on s’eft afiùré qu’il y a d es fangliers;
beu-à-peu on raccourcit l’enceinte , Sc on parvient
enfin à refferrer aflez étroitement les animaux qui s 'j
trouvent : alors on les attaque à coups de dards, d’e-
pieu où d’épée. En Allemagne , où cette chafle eft
plus commune, les Véneurs exerces fe commettent
ainfi avec les plus grands fangliers ,* mais en France,
lorfqu’on donne cette efpece de fête, on a foin de ne
laifler dans l’enceinte que ceux qui font un peu plus
traitables : fans cette précaution, la fête pourroit être
triftement enfanglantée , parce qu’il faut que les
chaflëurs foient habitués de longue main à cette efpece
de.combat,pour qu’ils puiflent le rifquer fans
trop de defavantage. ( M .le Ro i .') •
SANGLIÉR , ( Dieu & Matière médic. ) ta chair du
fanglier, & fur-tout du fanglier fait, mais qui pourtant
ri’ eft pas v ieu x , Sc qui eft gras, eft aflez tendre,
quoique ferme, & il eft facile, par une courte infù-
fion dans le vinaigre, de la dépouiller abfolument du
ooCit qu’on appelle fauvuge ou de venaifon ; qu’elle ne
différé à cet égard du bon boeuf ou du veau un peu
fait, que parce qu’elle eft un peu plus feche. Dans
cet état elle n’eft point difficile à digérer, elle convient
aux hommes de tous les états, mais fur-tout à
ceux qui mènent une vie exercée, Sc il n’y a que les
eftomacs très-délicats qui s’en accommodent difficilement
; elle ne reflemble en rien à la chair du cochon
domeftique; la graiffe abondante dont cette
derniere eft pénétrée, & la fadeur de fon fuc, établiffent
manifeftement cette différence.
Le jeune fanglier ou marcaflin qu’on trouve aflez
généralement plus délicat, peut être regardé avec
raifon comme moins falutaire que le fanglier dont
nous venons de parler.
Les chaffeurs ont coutume d’enlever les teftica-
les nu fanglier dès le moment qu’ils l’ont tué, fans
cette précaution tout l’animal contraéferoit une
odeur de bouquin qui le rendroit infupportable au
°°Les dents d efanglier ou défences f e fangliers, font
mifes au rang des abforbans, mais fans qu’on piaffe
affigner aucune raifon valable de la préférence qu’on
leur donne fur celle de plufieurs autres animaux; on
leur attribue aufli lès vertus imaginaires, d’exciter
les urinés 8c les lueurs, ; , ’ i, ■ ■ : .
Les tefticples, là graiffe, lé-fiel de fanglier, &c,
(car cetté énumération revienttoujtprs), ontauffi
grofii la lifte des médicamens, mais font aujourd’hui
abfolument'hors d’ufage. ( é ) .
i Sa n g l i e r d e s In d e s , o r i e n t a l e s , b a b y m u j ja ,
PL îll.Jig. g. cet animal reflemble au cerf par fa grandeur,
8c au cochon par fa figure; il a lepnufrau
I ïjp n g ê , la tête oblor.gue 8c étroite, les oreilles petites
8c pointues, les yeux petits; la queue longue,
frifée, 8c terminée par un bouquet de poils, 8c les
jambes longues 8r deuces. Lès poils du corps font
courte & laineux, 8ç doux, à F exception de ceux du
dos qui font,plus rudes 8c joyeux; ils ont tous, une
■ couleur blanchâtre ou brune mêlée de gris. Les
dents canines de la mâchoire du deflits fon: dirigés
en haut i leur origine ; ellés fe reçouibent en arriéré,
de façon que dans le dernier âge de l’animal leur
extrémité aboutit au-deffou'% des yeux 8c perce la
peau. Les dents canines dBjgmâchoire du deffous
reffemblent à celles dçs fangliéis. Regn. animal, pagi
Sanglier du Mex iq u e . Voye{ T a ja c u . , •
S A N G L O N S , fi m, pL> ( des
piece.ide boisgconime de faillies - cotes, qu on met
aux bateaux nourries fortifier. (D . J .)
Sanglons , ! Marine. ) Veyen F o u r c a t s .
SANGLOT,f. m, en Médecine, eft un mouvement
cpnyulfif du. diaphragme qu’on appelle communément
hocqUft. Poyei H(k ;QL:e t .
S a n g l o t , p e t it e c o u r r o ie q u o n R tfac
h e à la fe lle ,d ’u n c h e v a l o u au b â t d e s b ê te s de fom-
m e , p o u r y a t ta ch e r le s fan g le s . v
SANGRO, I.E, (Giogr. mad.'j riviere d’Italie, au
royaume de Naples. Elle tire fa fource de l’Apennin*
aux confins dé-la terre de L à h tt r , 8c fe perd dans
le golfe deYenife, à 6 milles au-deffous deLanicano;
fon nom latin eü Sàgrus ècSarus. (Z*. / .)
SANGSUE, (Zookgie.') hirudo,«»fnnguifugamt
les naturaliftes ; petit animal oblong , noirâtre , fans
piés , vivant dans les . lieux aquatiques , marqué»
fur le corps de taches 8c de raies p a y a n t dans l’.qte
verture de la bouche un inftrument à trois tranchars,
avec lequel il entame la peau pour en fucef .le
Les eaux" croupiflantes fou.rniffent deux efpeces de
fangfues, une grande, 8c une petite. La grande,
nommée fangfie de cheval, en latin bdella fen hirudq
equina , croît jufqti’à 5 pouefs, de longueur;. Ole
eft comme le, ver çle .terre, divifee par anneaux au
nombre d’une centaine ; on la regarde comme vem-
meufe dans fes bieffures ; la petite efpece en diffère,
nonffeulemeht par la taille , mais par la couleur de
bfon‘ventre, qui eft noirâtre, avec une teinte de
verd. . .
C ’eft de cette petiteefpece dont il s agira dans cet
article ; thaïs pour abréger fa defeription, déjà donnée
fort au long par plufieurs naturaliftes, .comme par
Loupart dans le journal desfavans, année ifre/y, H h!
Dillenius, dans les éphémerides des curieux de h nature;
àànct >yi8, & par d’autres ; je crois que nous pouvons
obmettre ici tout ce que l ’on fait communément
de la Jangfue, & ce qui eft facile à chacun d’àpper^
cévoir : i°. pal* la Ample infpecfion , cômrne les anneaux
cutanés de fon Fourreau, l’arrangement & les
couleurs des raies , des pyramides, ‘des points dont
cè même fourreau eft orné, l’avidité fes fangfues a
fùcer la chair des animaux, la façon dont elles appliquent
leur bouche en forme de ventoufe pour s’y
attacher, une forte de mouverhent qu’on voit à-travers
de leur peau quand elles fucent, & qui fem-
ble répohdre aux mouvemeris de la déglutition : i° .
p'ar des expérièhcès faciles, comme le tems qu’elles
vivent dans l’eau j fans autre nourriture que l’eau
ihême, la faculté qui leur eft comhiuhé aveeplufieufs
autres efpeces d’animaiix de fe mouvoir, quoique
coupées par morceaux ; toutes ces chofes font füffi-
famment connues ; il vaut mieux nous arrêter à
fexamen dé ces pârties, par lefquelles la fangfue a
la propriété d’êntainer la peau d’un autre animal, St
de fucer fon fan g-.
Il ÿ a cinq parties différentes qui y contolifent; fa-
voir, deux levres, une cavité , qui eft proprement
là bouche , des inftrùmens pour entamer , d’aü-
ïres - pour fuccef , St uii goner pour la déglutition.
Lorfqüè Va fangfue éft èq repos , fa levreuipérieùre
fait un demi-cercle aflez régulier, & l’inférieure une
portion d’un plus grand cercle. Qiiand la fangfue
alongê fà tête pouf avancer, le demi-cercle de la le-
vre uipérieüre fé change en deiix lignes obliques,
dont la jonûiqn fait un angle faillant, que la fangfue
applique d’abord où elle veut s’attacher, Sc qui eft
marqué par un petit poirit très noir au bord extérieur
du milieii de là levre.
La foupiéfté des fibres de cette partie, lui donne la
facilité de pfélidre la figure dont l’animal a bèfoin
pour tâtonner les endroits où il veut s’appliquer, afin
de,cheminer, ou polir développer les parties avec
lèfqùeilës il doit entamer la peau de qiielqu’autre
animal. Dans ces deux cas , fes deux levres toutes
ouvertes fe changent en une efpece de pavillon, exactement
rond paf lés bords. Enfin , quand 1 à fangfue
eft tout-à-fait fixée , par exemple , aux parois inférieurs
d’une phiole, fa têtë & fa queue font tout-à-
fhit applaties, Sc exactement appliquées à la furfacè
qu’elles .couvrent.
L’ouvèrtiirë tjüiëft entre les deux levres dè la fangfue,
eft proprement fà bouche ; lorfqu’on a tenu ces
deux levres dilatées Un peu de teins par quelque corps
dur, on eh voit àifément la cavité. Cette boiiche eft
comme les levres compofée de fibres très-fouples ,
moyennant quoi elle prend toutes les formes convenables
au bel'oin de l’animal ; de façon que quand la
fangfue veüt's’attacher quelque part, elle Ouvre d’à-
bord les levres.; enfuite elle retourne fa bouche de
dedans en dehors, elle eh applique les parois intérieurs,&
de toute la cavité de fa bouche,on ne diftin-
gue plqs qu’une petite ouvef titre dans le milieu, où la
fangfue doit faire avancer l’organe deftiné à entamer;
Cette derniere partie paroit avoir donné bien de
là peine aux naturaliftes, Sc toits, ne font pas abfolu*
ment d’accord fiir la forme. Il n’étoit pas raiforinable
. de croire qite la fangfue n’a Voit qü’un aigùillon com-‘
me le coufin ; on favoit bien qu’elle ne le bornoit pas
à faire Une piquüre, dont il n’auroit réfulté qu’une
ampoule, une élévation à la peau ; on devo'it fentir
qu’il falloit néceflairement qu’elle fît' une plaie, pour
fucer le fang avec alitant d’avidité, Sc en aufli grande
quantité qu’elle le fait, & qu’un aiguillon ne fuffi-
foit pas pour Cela. Aufli trouve-t-on peu d’auteurs dé
ce fentiment;
L’oùverture que la fangfue laifle appercevoir au
Tome XÎVu
hùïieii de la bouche , appliquée pour enfaihef ^ çii
triangulaire ; par confequent on a dû imaginer que
l’inftrument qu’elle lance aurtfavers de cette ouverture
pour entamer étoit triple , auffi cét inftrument
eft-il à trois tranchâns.
, La découverte pourroit bien en être due à là flm*
pie obfervation de la plaie faite paf la Cangfae. En
effet, fi l’on examine cette, petite plaie , elle repré^
fente fenfiblement trois traits où rayons qui s’unifient
dans un centfe commuh, Sc qui font eritr’eux
trois angles égaux , Sc l’on voit, que ce ne font point
trois piquûrës , niais trois plaies. Ori ne le remarquera
pas après avoir appliqué les fangfues à des hé-
morrhoïdes ; mais fl elles, l’ont été à d’autreis endroits
dé la peaü, Sc fur-tout d’uiie peau blanche , on voit
le jour même de l’opération, un peu de fang coagulé
qui récouvre la plaie ; le lendemain le petit caillot
tombe > mais un léger gonflement confond tout, Enfin
j le troifieme ou quatrième jour > on voit diftin-
élement les trois plaies marquées!
L’organe pour entamer eft placé, comme On l’a
déjà dit , entre rouverture faite par les deux levres
& le fond f e la bouche.? Après avoir ouvert,
des fangfues par le ventre, St fuivarit la longueur de
l’animal, Sc avoir cherché'Cet organe dans l’endroit
défigné * e’eft le ta£l qui en a d’abord découvert quelque
chofe. On obferve qu’en paflant le doigt fur l’endroit
où eft cet organe, l’on fent une impreflion pa^J
reille à celle que fait une. lime douce fur ië doigt, cé
qui fuppofe déjà des parties, qui font non-feulement
ràboteufes, pais foiides & de la nature de l’os , ou "
toùt-au-moins de là corné*
Confidefant enftiitè cette partie avec une grofle
loupe j on voit qué la membrane interne de la bouche
vers fon fond eft hériflee de petites pointes capables,
étant fi près lés unes des autres, de faire dés,
lames dentées. Sur cette fimple expofition , on con-
. Cevrà aifement, que fi par quelque mouvement particulier
, ces lames s’avancent enfemble , Sc dans lé
fens de l’ouverture triangulaire Vers la partie à la-*
quelle la Jangfue applique fa bouche, elles doivent
faire une plaie telle qu’elle a été décrite.
Mais dom AIlôu a été bien plus loin ; il y à découvert
trois rangées dé dents , ou trois petits râteliers*
dont il à décrit la difpofitiôn Sc la ftrù&ure.
Au-delà des râteliers , dans l’ endroit où la bouché
rétrécie de la fangfue commence à prendre la formé
du canal, Sc où l’on fe répréfenteroit la luette dans
l’homme, il y a un mamelon très-apparent, Sc d’une
chair aflez ferme; Ge marhelon eft un pëü flottant
dans la bguche , St il paroit aflez naturel de lui affigner
l’office d’une langue. Lorfque iés organes dont
rious avons d’abord parlé , font appliqués où \a fangfue
cherche fa pâture, lorfqite les râteliers ont fait
plaie * Sc que l’ôuvèrture qui éft à leur centre eft parallèle
ait milieu de la triplé plaie faite par les râteliers
, il doit être facile au mamelon lancé aù-travers
de cette ouverture de faire le piftôri , Sc de fervir à
fucer le fang qui fort de l’entamiiré, pendant que là
partie dé là bouche continue aux levres, fait lé corps
dé pompé!
Enfin fe préfente la cinquième partie de la hou che;
L’on volt entre la racine du mamelon que l’on appelle
la langue $ Sc le commencement de l’eftomac *
itn efpace long d’environ deux lignes , garni de fibres
blanchâtres, dont on diftingué deux plans * l’uni
circulaire' Sc l’autre longitudinal; Celles-ci fe con-
tfa&erît apparemment pouf élargir & racouréir la cavité
de la pompe ; les circulaires réflerrent le canal,
Sc déterminent vers l’eftomâe le fang qui vient d’êtré
füeé;
Ce farîg entre alors daris une poche merribr'aneufë
qui fert d’eftomac Sc d’intéftins à la fangfue , Sc qui
occupe intérieurement une grande partie du refte
m i i j