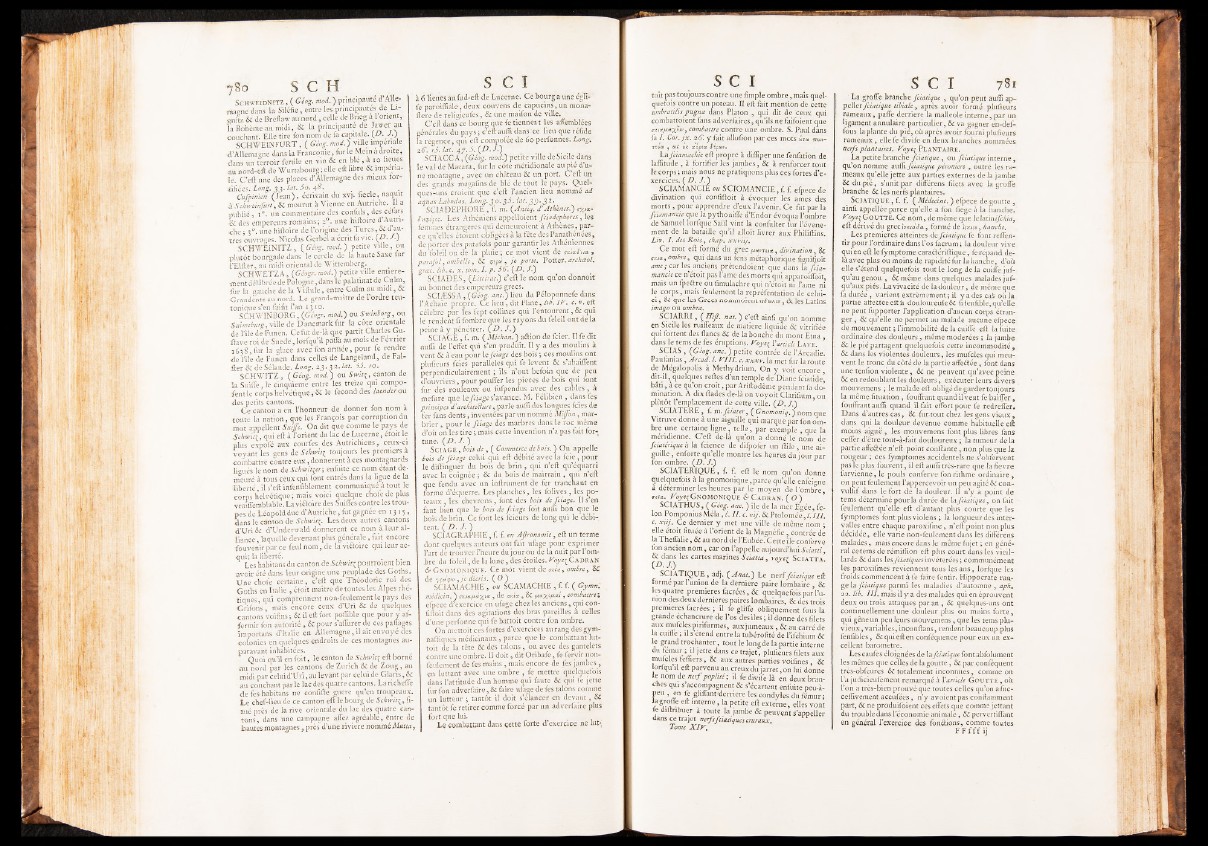
SchwEIDNITZ , ( Géog. moi. ) principauté d’Alle- |
magne dans la Siléfie, entre les principautés de Li-
finitz & de Breflaw au nord, celle de Brieg à 1 orient,
la Bohème au midi, & la principauté de Jawer au
touchant. Elle tire fort nom de fa capitulé. { D . J . )
SCHVEINFURT, ( Géog. mod.) ville impériale
d’Allemagne dans la Francpnie, fur le Mem à droite,
dans un terroir fertile en vin 6c en ble , à 10 lieues
M nord-eft de Vurtzbourg ; elle eft libre & impériale.
C’eft une des places d’Allemagne des mieux fortifiées.
Long. 3 3 . éat. 60. 4 8 •
Cufpinicn (Jean), écrivain du xvj. fiecle, naquit
àSchweinfurt, & mourut à Vienne en Autriche. Il a
publié ., i°. un commentaire des confuls, des^cefars
& des empereurs romains; z°. une hiftoire d’Autriche
; 30. une hiftoire de l'origine des T u r c s d autres
ouvrages. Nicolas Gerbel a écrit fa vie. (D . /.)
SCHWEINITZ , ( Géog. mod. ) petite ville, ou
.plutôt bourgade dans le cercle de la haute Saxe fur
TElfter, au midi oriental de "Wittemberg.
SCHWETZA , {Gêogr. mod.) petite ville entièrement
délâbrée de Pologne, dans le palatinat de Culm,
fur la gauche de la Viftule, entre Cuhn.au midi, &
Graudentz au nord. Le grand-maitrèdelordreteu-
•tonique s’en faifit l’an 13 ïo.
SCHWINBORG, {Géogr, mod.) ou Swinborg, ou
Suimeburg, ville de D anemark fur la côte orientale
de l’île de Funen. Ce fut de-là que partit Charles Gu-
dtave roi de Suede, lorfqu’il paffa au mois de Février
1638,fur la glace avec fon armée, pour fe rendre
de l’île dé Funen dans celles de Langèland, de Fal-
fler & de Sélande. Long. 2 3 .3 2 . lat. 65. 10.
SCHWITZ, {Géog. mod.) ou Sw it i, canton de
la Suiffe, le cinquième entre les treize qui composent
le corps helvétique, & le fécond des laender ou
■ des petits cantons. x
Ce canton a eii l’honneur de donner fon nom a
toute la nation, que les François par corruption du
mot appellent S u f fi. On dit que comme le pays de
Schmu t, qui eft à l’orient du lac de Lucerne, etoit le
plus expofé aux cotirfes des Autrichiens, ceux-ci
voyant les gens de Schwh{ toujours les premiers à
combattre contre eux, donnèrent à ces montagnards
ligués le nom de Schwii^er-, enfuite ce nom étant demeuré
à tous ceux qui font entrés dans la ligue de la
liberté, iLs’eft infenfiblement communiqué à tout le
corps helvétique ; mais voici quelque chofe de plus
vraiffemblable. La vi&oire des Suiffes contre les troupes
de Léopold duc d’Autriche, fut gagnée en 1315 ,
dans le canton de Sckwit{. Les deux autres cantons
d’Uri & d’Underwald donnèrent ce nom à leur alliance
, laquelle devenant plus générale, fait encore
fouvenir par ce feul nom, de la vi&oire qui leur acquit
la liberté. .
Les hâbitans du canton de Schwit{ pourroient bien
^voir été dans leur origine une peuplade des Gôths.
Une choie certaine, c’eft que Théodoric roi des
Goths en Italie , étoit maître de toutes les Alpes rhé-
îiquès, qui comprennent non-feulement le pays des
Grifons, mais encore ceux d’Uri & de quelques
cantons voifins; & il eft fort poflible que pour y affermir
fon autorité , & pour s’affurer de ces paflages
importans d’Italie en Allemagne, il ait envoyé des
colonies en quelques endroits de ces montagnes auparavant
inhabitées.
Quoi qu’il en foit, lé canton de Schwit[ eft borne
au nord par les cantons de Zurich & de Zoug, au
.midi par celui d’Uri, au levant par celui de Glaris,&
au couchant par le lac des quatre cantons. La richeffe
-de fes habitans ne confifte guère qu’en troupeaux.
Le chef-lieu de ce canton eft le bourg de S c h w i t fi-
tué près de la rive orientale du lâc des quatre cantons,
dans une campagne affez agréable, entre de
hautes montagnes, près d’une rivière nommé Mutta,
à 6 lieues àûfud-eft de Lucerne. Ce bourg a urié églî-
fe paroifliale, deux couvens de capucins, un mona-
ftere de religie.ufes, & une maifon de ville.
C’eft dans ce bourg que fe tiennent les affemblées
générales du pays ; c’eft auffi dans ce lieu que réfide
la régence., qui eft compofée de 60 perfonnes. Long,
zG. i j . lat. 4 7 , 5 . { D .J . )
SCIACCA, {Géog. mod.) petite ville de Sicile dans
le val de Mazara, fur la côte méridionale au pié d’une
montagne, avec un château & un port. C’eft un
dés grands magafins de blé de tout le pays. QueÇ
ques-uns croient que c’eft l’ancien lieu nommé ad
aquas Labodas. Long. 3 0 .3 5. lat. 3 9 .3 2 .
SCIADEPHORE, f. m. {Antiq. d‘ Athènes.) (ryia-
S'iupiccç. Lés Athéniens appelloient fciadephores, les
femmes étrangères qui demeuroicnt à Athènes, parce
qu’elles étoient obligées à la fête desPanathenees,.
de porter des parafols pour garantir les Athéniennes
du foleil ou de la pluie ; ce mot vient de a-AaS'ua ,
parafol, ombelle, & tpipd , je porte. Potter. archotol,
grcec. U b. c. x . torn. I. p. 5 G. {D . J .)
SCIADES, {Littèrat.) c’eft le nom qu’on donnoif
aü bonnet des empereurs grecs.
SdÆSSA, {Géog. <znc. j lieu du Péloponnefe dans
\ TAchaïe propre. Ce lieu , dit Pline, lib. IV . c. v. eft
célèbre par les fept collines qui l’entourent, & qui
I le rendent fi fombre que les rayons du feleil ont de la
peine à y pénétrer. { D . J . ) ^
SCIAGE , f. m. ( Méchan. ) aâion de fcier. Il fe dit
aufli de l’effet qui s?en produit. Il y a des moulins à
vent & à eau pour le fciage des bois ; ces moulins ont
plufieurs fcies parallèles qui fe lèvent & s’abaiffent
perpendiculairement ; ils n’ont befoin que de peu
d’ouvriers, pour pouffer les pièces de bois qui font
fur des rouleaux ou fufpendus avec des cables , à
mefure que le fciage s’avance. M. Félibien , dans fes
principes d'architecture, parle aufli des longues fcies de
fer fans dents, inventées par un nommé Mijfon, marbrier
, pour le fciage des marbres dans le roc même
d’oîi on les tire ; mais cette invention n’a pas fait fortune.
{ D . J . )
Sciage , bois de , ( Commerce de b ois.) On appelle
bois de fciage celui qui eft débité avec la foie, pour
le diftinguer du bois de brin, qui n’eft qu’équarri
avec la coignée ; & du bois de mairrain , qui n’eft
que fendu avec un infiniment de fer tranchant en
forme d’équerre. Les planches, les folives, les poteaux
, les chevrons , font des bois de fciage. Il s’en
faut bien que le bois de fciage foit auffi bon que le
bois de brin. Ce font les fcieurs de long qui le débitent.
{ D . J . )
SCIAGRAPHIE, f. f. en AJlronomie, eft un terme
dont quelques auteurs ont fait ufage pour exprimer
l’art de trouver l’heure du jour ou de la nuit par l’ombre
du foleil, de la lune, des étoiles. Voye^ Cadran
6* Gnomonique. Ce môt vient de «/<*, ombre, &C
de y P dq>M , j e décris. { O )
SCIAMACHIE, ou SCAMACHIE , f. f. ( Gymnl
médicin. ) mayAyjct, de mia. , & > combattre;
efpece d’exercice en ufage chez les anciens, qui con-
fiftoit dans des agitations des bras pareilles a celles
d’une perfonne qui fe battoit contre fon ombre.
On mettoit ces fortes d’exercices au rang dès gym-
naftiques.médicinaux, parce que le combattant lut-
toit de la tête Sc des talons, ou avec dés gantelets
contre une ombre. Il doit, dit Oribafe, fe fervir non-
feulement de fes mains, mais encore de fes jambes ,
en luttant avec une ombre , fe mettre quelquefois
dans l’attitude d’un homme qui faute & qui fe jette
fur fon adverfaire, & faire ufage de fes talons comme
un lutteur ; tantôt il doit s’élancer en devant, &C
tantôt fe retirer comme forcé par un adverfaire plus
fort que lui.
Le combattant dans cette forte d’exercice ne lut--
toit pas toujours contre une fimple ombre, mais quelquefois
contre un poteau. Il eft fait mention de cette
umbratilis pugna dans Platon , qui dit de ceux qui
combattoient fans adverfaires, qu’ils ne faifoient que
(TKia^a-xjiv, combattre contre une ombre. S. Paul dans
fa I. C o r .jx . 2 G. y fait allufion par ces mots «™ mx.-
TSva , as w. atpiet S'tpav.
La fciamachie eft propre à diflïper une fenfation de
laflitude , à fortifier les jambes, & à renforcer tout
le corps ; mais nous ne pratiquons plus ces fortes d’exercices.
{ D . J . )
SCIAMANCIE ou SCIOMANCIE, f. f. efpece de
divination qui confiftoit à évoquer les âmes des
morts, pour apprendre d’eux l’avenir. Ce fut par la
fciamantie que la pythoniffe d’Endor évoqua l’ombre
de Samuel lorfque Saiil vint la confulter fur l’évene-
ment de la bataille qu’il àlloit livrer aux Philiftins.
Liv. I . des R o is , chap. x xv iij.
Ge mot eft forme du grec peavraa, divination, &
cv.itt, ombre, qui dans un fens métaphorique fignifioit
ame ; car les anciens prétendoient que dans la fcia -
mancie ce n’étoit pas Tarne des morts qui apparoiffoit,
mais un fpedlre ou fimulachre qui n’étoit ni Tarne ni
le corps, mais feulement la repréfentation de celui-
ci , & que les Grecs nommoient uS'uXov, & les Latins
imago ou umbra,.
SCIARRI, ( Hiß. nat. ) c’eft ainfi qu’on nomme
en Sicile les ruifleaux de matière liquide & vitrifiée,
qui fortent des flancs & de la bouche du mont Etna ,
dans le tems de fes éruptions. Voye^ Varticle L ave.
SCIAS, {Géog.anc.) petite contrée de l’Arcadie.
Paufanias, Arcad, I. V I I I . c. x x x v . la met fur la route
de Mégalopolis à Methydrium. On y voit encore
dit-il, quelques reftes d’un temple de Diane fciatide,
bâti, à ce qu ’ on croit, par Ariftodème pendant fa domination.
A dix ftades de-là on voyoit Clarifium ou
plutôt l’emplacement de cette ville. {D .J . )
SCIATERE, f. m. fciater, ( Gnomoniq, ) nom que
Vitruve donne à une aiguille qui marque par fon ombre
une certaine ligne, telle, par exemple , que la
méridienne. C’eft de-là qu’on a donné le nom de
fciatérique à la fcience de difpofer un ftile , une aiguille
, enforte qu’elle montre les heures du jour par
fon ombre. {D . J.)
SCIATERIQUE, f. f. eft le nom qu’on donne
quelquefois à la gnomonique, parce qu’elle enfeigne
à déterminer les heures par le moyen de l’ombre
«■ /.ta. Voyt{ Gnomonique & Cadran. { O ) *
SCIATHUS, ( Géog. anc. ) île de la mer É^ée, félon
Pomponius Mêla, l. I I . c. vij. & Ptolomée, l. I I I .
c. x iij. Ce dernier y met une ville de même nom ;
elle étoit fituée à l’orient de la Magnéfie, contrée de
la Theffalie, & au nord de l’Eubée. Cette île conferve
fon ancien nom, car on l’appelle aujourd’hui Sciatti,
& dans les cartes marines Sciatta, voyez Sciat ta
{ D .J . )
SCIATIQUE, adj. {A n a t .) Le nerffciatique eft
formé par l’union de la derniere paire lombaire &
les quatre premières facrées, & quelquefois par l’union
des deux dernières paires lombaires, & des trois
premières facrées ; il le gliffe obliquement fous la
grande échancrure de l’os desiles; il donne des filets
aux mufcles piriformes, aux jumeaux, & au carré de
la cuiffe ; il s’étend entre la tubérofité de Tifchium &
le grand trochanter, tout le long de la partie interne
du fémur ; il jette dans ce trajet, plufieurs filets aux
mufcles fefliers, & aux autres parties voifines &
lorfqu’il eft parvenu au creux du jarret, on lui donne
le nom de nerf popltti-, il fedivife là en deux branches
qm s’accompagnent & s’écartent enfuite psIS
peil, en fe gliffantiderriere les condvtes du femurl
la grolle eft interne , la petite M externe, elles vont
le diftnbuer à toute la jambe & peuvent s’appelle:'
dans ce trajet nerfsfeiatiquescruraux%
Tome X IV ,
La greffe branche fciatique , qu’on peut aufli ap-
peller fciatique tibiale, après avoir formé plufieurs
rameaux, paffe derrière la malléole interne, par un
ligament annulaire particulier, & va gagner en-def-
fous la plante du pié,, où après avoir fourni plufieurs
rameaux, elle fe divife en deux branches nommées
nerfs plantaires. V oye{ PLANTAIRE.
La petite branche fciatique, ou fciatique interne ,
qu’on nomme auffi fciatique péronière , outre les rameaux
qu’elle jette aux parties externes de la jambe
& du pié, s’unit par différens filets avec la greffe
branche & les nerfs plantaires.
_ Sciatique , f. f. ( Médecine. ) efpece de goutte,
ainfi appellée parce qu’elle a fon fiege à la hanche.
Voyc{G outte. Ce nom, de même que le latin ifehia,
eft dérivé du grechy.iJ.Sa, formé de Umov, hanche.
Les premières atteintes de fciatique fe font reffen-
tir pour l’ordinaire dans l’os facrum; la douleur vive
qui en eft le fymptome caraélériftique, fe répand delà
avec plus ou moins de rapidité fur la hanche, d’oîi
elle s’étend quelquefois tout le long.de la cuiffe juf-
qu’au genou , & même dans quelques malades jusqu’aux
piés. La vivacité de la douleur, de même que
fa durée , varient extrêmement ; il y a des caS où la
partie affeéléeeftfi douloureufe & fi fenfible, qu’elle
ne peut fupporter l’application d’aucun corps étranger
, & qu’elle ne permet au malade aucune efpece
de mouvement ; l’immobilité de la cuiffe eft la fuite
ordinaire des douleurs, même modérées ; la jambe
& le pié partagent quelquefois cette incommodité ,
& dans les violentes douleurs , les mufcles qui meuvent
le tronc du côté de la partie affeélée , font dans
une ténfion violente, & ne peuvent qu’avec peine
& en redoublant les douleurs, exécuter leurs divers
mouvemens ; le malade eft obligé de garder toujours
la même-fituation, fouffrant quand il veut fe baiffer ,
fouffrant auffi quand il fait effort pour fe redreffer.
Dans d’autres cas, & fur-tout chez les gens vieux,
dans qui la douleur devenue comme habituelle eft
moins aiguë , les mouvemens font plus libres fans
ceffer d’être tout-à-fait douloureux la tumeur de la
partie affeélée n’eft point confiante, non plus que la
rougeur ; ces fymptomes accidentels ne s’obfervent
pas le plus, fouvent, il eft auffi très-rare que la fievre
furvienne, le pouls conferve fon rithme ordinaire ,
on peut feulement l’appercevoir un peu agité & con-
vulfif dans le fort de la douleur. Il n’y a point de
tems déterminé pour la durée de la fciatique, on fait •
feulement- qu’elle eft d’autant plus courte que les
fymptomes font plus violens ; la longueur des intervalles
entre chaque paroxiftne, n’eft point non plus
décidée, elle varie non-feulement dans les différens
malades, mais encore dans le même fujet ; en général
ce tems de rémiflïon eft plus court dans les vieillards
& dans \esfeiatiques invétérées; communément
les paroxifmes reviennent tous les ans, lorfque les
froids commencent à fe faire fentir. Hippocrate range
la fciatique parmi les maladies d’automne , aph.
22. lib. I I I . mais il y a des malades qui en éprouvent
deux ou trois attaques par an , & quelques-uns ont
continuellement une douleur plus ou moins forte,
qui gêne un peu leurs mouvemens , que les tems pluvieux,
variables, inconftans, rendent beaucoup plus
fenfibles, & qui eft en conféquence pour eux un excellent
baromètre.
Les caufes éloignées de la fciatique fontabfolument
les mêmes que celles de la goutte., & par conféquent
très-obfcures & totalement inconnues, comme on
Ta judicieufement remarqué à Tarticle Goutte , où
Ton a très-bien prouvé que toutes celles qu’on afuc-
ceflivement accufées, n’y avoient pas conftamment
part, & ne produifoient ces effets que comme jettant
du trouble dans l ’économie animale, & pervertiffant
en général l’exercice des fonctions, comme toutes
FFf f f ij