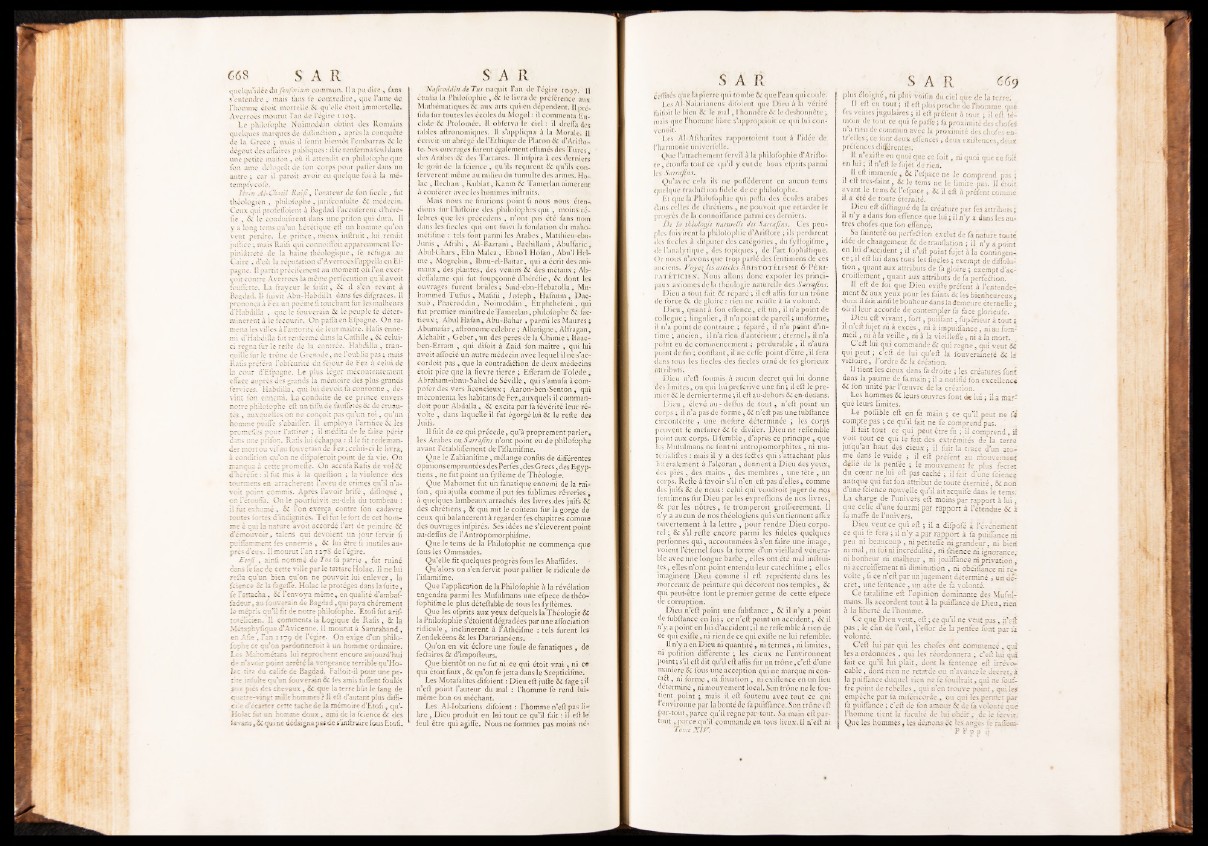
quclqu'idée du /«v.7>Vi.vw commun. Il a pu dire , fans
s entendre , mais tans le contredire, que l’a me île
l'homme étoit mortelle & qu'elle étoit imiuortelle.
Averroès mourut l'an de Fégiro t 103.
L.e philosophe Noimoddm obtint des Romains
quelques marques de diilindion , après la conquête
de la Grece ; mais il Sentit bientôt l'embarras ïk le
dégoût des affaires publiques : il Se renferma Seul dans
une petite maiSon , oh il attendit en philotophc que
Son ame déloqeàt de Son corps pour palier dans un
autre ; car il paroit avoir eu quelque foi à la n\é-
templvcole.
Jèr*n jil-ChatÙ R tiijt, l'orateur de fon fiecle , fut
théologien , philofophe, jnrifconfulte & médecin.
Ceux qui proteil'oient à Bagdad l'acculèrent d’heré-
lie , éc le conduilirent dans une prijfon qui dura. Il
y a long tems qu'un hérétique eft un homme qu'on
veut perdre. Le prince, mieux inllruit, lui rendit
julîice ; mais Raiù qui connoiflbit apparemment l'o-
pinidtrete de la haine théologique, lé réfugia au
Caire , d’oh la réputation d'Averroès Fappella en El-
pagne. Il partit preeiiëment au moment oit l’on exer-
çoitcontre Averroès la même perlécution qu'il avoit
iouâèrte. La frayeur le lai fit, <k il s’en revint à
Bagdad. Il fui vit Abu-Habdiila dans les dilgraces. Il
prononça à Fez un poëme ii touchant fur les malheurs
d'Habdilla , que le l'ouverain S: le peuple le déterminèrent
à le lecourir. On palîaen Elpagne. On ramena
les villes à l’autorité de leur maître. Hafts ennemi
d'Habdilla tut renfermé dans la Caftille , & celui-
ci régna fur le relie de la contrée. Habdilla , tranquille
fur le trône de Grenade, ne l’oublia pas ; mais
Rafis préféra robfcuriié du léjour de Fez a celui de
la cour d'Elpagne. Le plus léger mécontentement
efface auprès des grands la mémoire des plus grands
Services. Habdilla. cui lui dcvoitfa couronne , devint
fon ennemi. La conduite de ce prince envers
notre philofophe eft un tifiu de fauftetés Ck de cruautés
, auxquelles on ne conçoit pas qu’un roi, qu’un
homme puille s’abaiflèr. Il employa l’artifice & les
premefies peur i'attirer ; il médita de le taire périr
dans une prilon. Rafis lui échappa : il le fit redemande:
mort ou vifau Souverain de Fez; celui-ci le livra,
à condition qu'au ne difpoferoit point de fa vie. On
manqua à cenc promeffe. On accufa Ralîs de vol 6c
d'herélîe : il lut mis à la queftion ; la violence des
tourmens en arrachèrent l’aveu de crimes qu'sl n’a-
voit point commis. Après l’avoir brifé, difïoqué ,
on l'étouffa. On le pourluivit au-delà du tombeau :
il fut exhumé , & l’on exerça contre fon cadavre
toutes fortes d’indignités. Tel fut le fort de cet homme
à qui la nature avoit accordé l’art de peindre &
d’émouvoir, talens qui dévoient un jour fervir fi
puiftamment fes ennemis , & lui être li inutiles auprès
d’eux. Il mourut Fan 1278 del’égire.
Etoji , ainû nommé de Tos fa patrie , fut ruiné
dans le fac de cette ville par le tartare Holac. Il ne lui
relia qu’un bien qu’on ne pouvoir lui enlever, la
Science & la fageffe. Holac le protégea dans la fuite,
fe l’attacha, & l’envoya même, en qualité d’ambaf-
fadeur, au Souverain de Bagdad, qui paya chèrement
le mépris cull fit de notre philofophe. Etofi fut arif-
tpîélkien. 11 commenta la Logique de Rafis , & la
Métaphyficue d’Avicenne. 11 mourut à Samrahand ,
en Afie , Fan 1179 de l’égire. On exige d’un philofophe
ce qu’on pardonneroit à un homme ordinaire.
Les iMabométans lui reprochent encore aujourd’hui
de n’avoir point arrêté la vengeance terrible qu’Ho-
lac tira du calife de Bagdad. Falloiï-il pour une petite
infuhe qu’un Souverain & fes amis fu fient foulés
aux pies des chevaux, & que la terre bût le fang de
cua:re-vingî mille hommes ? Il eft d’autant plus diffi-
o e d'écarter cette tache de la mémoire d’Etofi , qu’-
Holac fut un homme doux , ami de la Science 6c des
la vans, ôc qui ne dédaigna pas de s anftrair c fous Etofi.
Nafîroddin de T u s naquit Fan de Fégirc 1007. U
étudia la Philofophie , & le livra de préférence aux
Mathématiques 6c aux arts oui en dépendent. Ilpré-
fida fur toutes les écoles du Mogol : il commenta Eu-
clide <k Ptolomée. Il obfervale ciel: il dreffa des
tables allronomiques. Il s’appliqua à la Morale. Il
écrivit un abrégé de l’Ethique de Platon £k d’Arifto-
te. Ses ouvrages furent également c Ai mes des T lires
des Arabes 6c des Tartares. Il infpira à ces derniers
le goût de la Science , qu’ils reçurent 6c qu’ils con-
lerverent même au milieu du tumulte des armes. Ho-
lac , Uechan , Kaiblat, Kanm 6c Tanierlan aimèrent
à conférer avec les hommes inllruits.
Mais nous ne finirions point fi nous nous éten-v
dions lu r l’hiftoire des philofophcs qui , moins célébrés
que les précedens , n’ont pas été fans nom:
dans les liecles qui ont fuivi la fondation du maho-
métilme : tels font parmi les Arabes, Matthieu-ebn-
Junis , Afrihi , Al-Bazrani, Bachillani, Abulfaric y
Abul-Chars , Ebn Malca , Ebno’l Hofan , Abu’l H cime
, Mogrebin, lbnu-el-Baitar, qui a écrit des animaux
, des plantes, des venins 6c des métaux ; Ab-
deilalamc qui fut foupçonné d’héréfie, 6c dont les
ouvrages furent brûlés ; Said-ebn-Hebatolla, Mu-
hammed Tufius, Malifii , Joteph, Hafnum , Dac-
xu b , Phacroddin, Noimoddin , Ettphthel’en i, qui
fut premier minillredeTamerlan,philofophe & factieux
; Abul Hafan, Abu-Bahar , parmi les Maures -;
Abumafar , aftronome célébré ; Albatigne, Alfragan,
Àlchabit, Geber, un des peres delà Chimie ; Ifaac-
ben-Erram , qui difoit à Zaid fon maître , qui lui
avoit aflocié un autre médecin avec lequel il ne s’ac-
cordoit pas , que la contradiction de deux médecins
étoit pire que la fievre tierce ; Efferam de Tolede ,
Abraham-ibnu-Sahel de Séville, qui s’amufa àcom-
pofer des vers licencieux ; Aaron-ben-Senton , qui
mécontenta les habitans de Fez, auxquels il comman-
doit pour Abdalla, 6c excita par fa l’évérité leur révolte
, dans laquelle il fut égorgé lui 6c le refte des
Juifs.
Il fuit de ce qui précédé, qu’à proprement parler,
les Arabes ou Sarrajîns n’ont point eu de philofophe
avant Fétabliflement de l’iflamifme.
Que le Zabianifme, mélange confus de différentes
opinions empruntées des Perfes, des Grecs, des Egyptiens
, ne fut point un fyftème de Théologie.
Que Mahomet fut un fanatique ennemi de la rai-
fon, qui ajufla comme il put fes fublimes rêveries -y
à quelques lambeaux arrachés des livres.des juifs 6c
des chrétiens , & qui mit le couteau fur la gorge dés
ceux qui balancèrent à regarder fes chapitres comme
des ouvrages infpirés. Ses idées ne s’élevèrent point
au-defîus de l’Antropomorphifme.
Que le tems de la Philofophie ne commença que
fous les Ommiades.
Qu’elle fît quelques progrès fous les Abafîides. *
Qu’alors on s’en fervit pour pallier le ridicule de
l’iflamifme.
Que l’application de la Philofophie à la révélation
engendra parmi les Mufulmans une efpece de théo-
fophifme le plus déteftable de tous les fyftèmes.
Que les efprits aux yeux defquels la Théologie &
la Philofophie s’étoient dégradées par une aflociation
ridicule , inclinèrent à l’Athéifme : tels furent les
Zendekéens 6c les Dararianéens.
Qu’on en vit éclore une foule de fanatiques , de
feûaires & d’impofteurs.
Que bientôt on ne fut ni ce qui étoit v r a i, ni ce
qui étoit faux, & qu’on fe jetta dans le Scepticifme.
Les Motafalites difoient : Dieu eft jufte 6c fage ;il
n’eft, point l’auteur du mal : l’homme fe rend lui*
même bon ou méchant.
Les Al-Iobariens difoient : l’homme n’eft pas li-*;
bre , Dieu produit en lai tout ce qu’il fait : il eft le’
feul être qui agifle. Nous ne fommes pas moins nécc’flîtés
que. la pierre qui tombe 6c que l’eau qui coule:
Les Al-Naiarianens difoient que Dieu à la vérité
fiiifoit le bien 6c le mal, l’honnête 6c le deshonnête ;
niais que l’homme libre s’approprioit cc qui lui con-
L.cs Al-Afshnritcs rapportoient tout à l’idée de
l’harmonie univcrfclle.
Que l’attachement fervil à la philofophie d’Arifto-
ri‘ , étouffa tout ce qu’il y eut de bons efjprits parmi
les Sarrajîns.
Qu’avec cela ils ne pofléderent en aucun tems
quelque traduction fîdele de ce philofophe.
Et que là Philofophie qui pana des écoles arabes
dans celles de chrétiens , ne pouvoit que retarder le
progrès de la connoiflance parmi ces derniers.
De la Hièoiogie naturelle des Sarrajîns. Ces peuples
fuiyirent la philofophie d’Ariftote ; ils perdirent
des ficelés à difputer des catégories , du fyllogifme j
de l’analytique , des topiques , de l’art fophiltique.
Or nous n’avons que trop parlé des fentimens de ces
anciens. Voyel les articles A ristotélisme & PÉRI-
patét icien. Nous allons donc expofer les principaux
axiomes de la théologie naturelle des Sarrajîns:
Dieu a tout fait 6c réparé ; il eft affis fur un trône
de force 6c de gloire : rien ne réfifte à fa volonté.
D ieu , quant à fon eflence, eft un, il n’a point dé
collègue ; fingulier, il n’a point de pareil ; uniforme,
il n’a point de contraire ; féparé, il n’a point d’intime
; a ncien, il n’a rien d’antérieur ; éternel, il n’a
point eu de commencement ; perdurable , il n’aurà
point de fin ; cohftant, il ne Celle point d’être, il fera
dans tous les fieeles des fieclès orné de fes glorieux
attributs:
Dieu n’eft fournis A aucun decret qui lui donne
des limites, ou qui lui preferive une fin ; il eft le premier
6c le dernier terme ; il eft au-dehors 6c en-dedans.
Dieu , élevé. ai\ r defliis de to u t , ' n’eft point un
corps ; il n’a pas de forme, 6c n’eft pas une lubftance
circonfcrite s une mefure déterminée ; les corps
peuvent fe mèliirer 6c fe divifer. Dieu ne reflembie
point aux corps. Il femble, d’après ce principe , que
les Mufulmans ne font ni antropomorphites , ni ina-
tcrialiftes : mais il y a des feftes qui s’attachant plus
littéralement à l’alcoran , donnent à Dieu des yeux,
des pies , des mains , des membres , une tête , un
corps. Refte à favoir s’il n’en eft pas d’elles, comme
des juifs 6c de nous : celui qui vqudroit juger de nos
fentimens fur Dieu par les èxpreflions de nos livres,
6c parles nôtres, le tromperoit groflîerement. 11
h’y .a aucun de nos théologiens qui s’en tiennent allez
ouvertement à la lettre , pour rendre Dieu corporel
; 6c s’il réfte encore parmi les fideles quelques
perfonnes qui, accoutumées à s’en faire une image ;
voient l’éternel fous la forme d’un vieillard vénérable
avec une longue barbé, elles ont été mal inftrui-
tes j elles n’ont point entendu leur catéchifme ; elles
imaginent Dieu comme il eft repréfenté dans les
morceaux de peinture qui décorent nos temples, 6c
qui peut-être font le premier germe de cette efpece
de corruption.
Dieu n’èft point une fubftance , 6c il n’y a point
de fubftance en lui ; ce n’eft point un accident, 6c il
n’y a point en lui d’accident ; il ne reffemble à rien de
ce qui exifte, ni rien de ce qui exifte ne lui refemble.
11 n’y a en Dieu ni quantité, ni termes, ni limites,
hi pofiti’on différente ; les cieux ne l’environnent
point; s’il eft dit qu’il eft aflis fur un trône, c’eft d’une
maniéré 6c fous une acception qui ne marque ni con-
taft , ni forme , ni fituation , ni exiftence en un lieu
déterminé , ni mouvement local. Son trône ne le fou-
tient point ; mais il eft foutenu avec tout ce qui
l’environne par la bonté de fa pûiflanCe. Son trône eft
par-tout, parce qu’il régnépaï-tout. Sa main eft partout
, parce qu’il commande en tous lieux. Il n’eft ni
Tome X IV.
plus th if jh i, ni plus vbifin du ciel qtie de la terre.
fl eft en tout ; il eft plus proche de Fh omme qué
les veines jugulaires ; il eft préfent à tout ; il eft témoin
de tout ce cjui fe pafle ; fâ proximité des chofeé
n’a rien de commun avec la proximité des chofes en-
tr’cllcs; ce font deux cflences, deux exiftences,deux
préfën.ces différentes;
Il n’exifte en quoi que cc fo i t , ni quoi que cc fort
en lui ; il n’eft le fujét de rien.
Il eft immenfc, ô c l’efpacene le comprend pas ;
il eft tres-faiht, 6c le tems ne le limite pa ». Il étoit
avant le tems 6c l’efpace ; 6c il eft à préfent comme
il a été de toute éternité.
Dieu eft diftingue de la créature par fes attributs ;
il n’y a dans fon eflence que lui ; il n’y a dans les autres
chofes que fon effence»
Sa fainteté ou perfection exclut de fa nature toute
idée de changement 6c de trandation ; il n’y a point
en lui d’accident ; il n’eft point fujet à la contingen-.
ce ; il eft lui dans tous les fieeles ; exempt de difloUri
tion , quant aux attributs de fa gloire ; exempt d ’ac>
croifiement, quant aux attributs de fa perfection.
Il eft de fol que Dieu exifte préfent à l’entendement
& aux yeux pour les faints & les bienheureux *
dont il fait ainfi le bonheur dans la demeure éternelle,
où il leur accorde de contempler fa fkee glorieufe.
, £)iei1 çft vivant, fort, puiflànt, fupérieur à tout ;
il n c-ft fujet ni à excès, ni à impuiflance, ni au fonri
meil, ni à la veille, ni à la vieilleffe, ni à la mort.
C’eft lui qui commande & qui régné, qui veut &
qui peut ; c’eft de lui qu’eft la fouveralneté & la
victoire, l’ordre & la création.
Il tient les cieüx dans fa droite ; les créatures font
dans la paume de famain ; il a notifié fon exceiîenc«
6c fon unité par l’oeuvre de la création.
Les hommes 6c leurs oeuvres font de lui ; il a mar^
qiié leurs limites.
Le poflible eft en là main ; ce qu’il peut ne fô
compte pas ; ce qu’il fait ne fe comprend pas.
Il fait tout ce qui peut etre fit ; il comprend, iî
voit tout ce qui fe fait des extrémités de la terre
jufqu’au haut des cieux ; il fuit la trace d’un ato-
me dans le vuide ; il eft préfent au mouvement
délié de la penfée ; le mouvement le plus fecret
du coeur ne lui eft pas caché ; il fait d’une fcieace
antique qui fut fon attribut de toute éternité, & non
d une fcience nouvelle qu’il ait acquife dans le tems."
La charge de runivers eft moins par rapport à lu i,
que celle .d’une fourmi par rapport à retendue Sc k
la mafle de l’univers.
Dieu veut ce qui eft ; il a dilpofe à l’événement
ce qui fe fera ; il n’y a par rapport à fa puiftance ni
peu ni beaucoup , ni petitefie ni grandeur, ni bien
ni m al, ni foi ni incrédulité, ni fcience n i ignorance;
ni bonheur ni malheur , ni jouiflance ni privation *
ni accroiflement ni diminution , ni obéiflance ni révolte
, fi ce n’eft par un jugement déterminé , un décret
, une fentence, un afte de fa volonté.
Ce fatalifme eft l’opinion dominante des Mufulmans.
Ils accordent tout à la puiftance de Dieu, rien
à la liberté de l’homme.
Ce que D ieu veut, eft ; ce qu’il ne veut pas, n’ eft
pas ; le clin de l’oe il, l’effor de la penfée font par ù
volonté.
C ’eft lui par qui les chofes ont commencé , qui
les a ordonnées , qui les réordonnera ; c’eft lui qui
fait ce qu’il lui plaît, dont la fentence eft irrévocable
, dont rien ne retarde ou n’avance le decrer, à
la puiftance duquel rien ne fe fouftrait, qui ne fout-
fre point de rebelles , qui n’en trouve point, qui les
empêche par la miféricorde , ou qui les permet par
fa puiftance ; c’eft de fon amour 6c de fa volonté que
l’homme tient la faculté de lui obéir ; de le fervir;
Que les hommes, les démons ik les anqes fe nafora-
£ P p p ii •