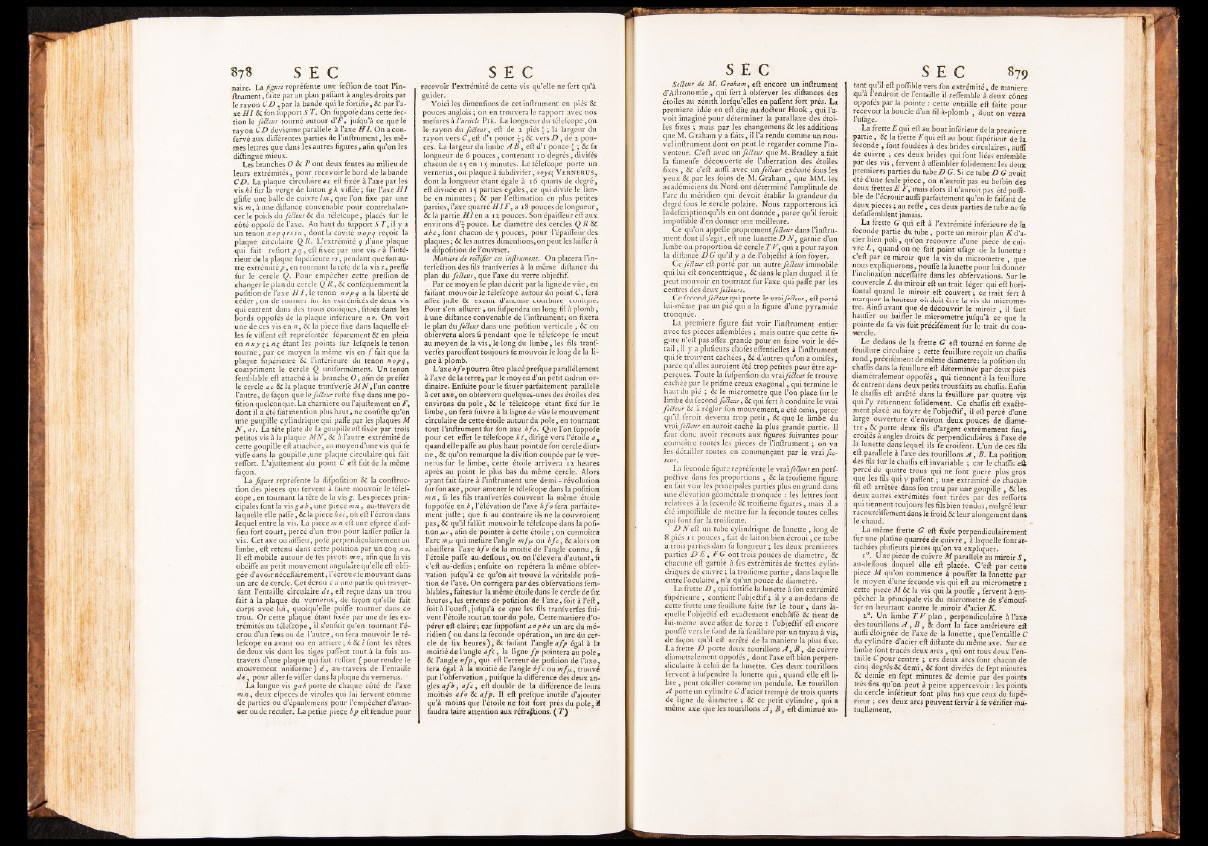
paire. La figure repréfente une feflion de tout Pin-
firument, faite par un plan paffent à angles droits par
le rayon C D , par la bande qui le fortifie, 6c par l’axe
H I 6c fon fupport S T. On fuppofe dans cette fec-
tion le fecleur tourné autour d’F , jufqü’à ce que le
rayon CD devienne parallèle à l’axe HI. On acon-
fervé aux différentes parties de l’inftrument, les mêmes
lettres que dans les autres figures, afin qu’on les
diftingue mieux.
Les branches O 6c P ont deux fentes au milieu de
leurs extrémités, pour recevoir le bord de la bande
CD . La plaque circulaire ac eft fixée à l’axe par les
vis hi fur fe verge de laiton g k viflèe ; fur l’axe H I
glifl'e une Dalle de cuivre Im, que l’on fixe par une
vis à une diftance convenable pour contrebalancer
le poids du fecleur 6c du télefcope, placés fur le
côté oppofé de l’axe. Au haut du fupport S T , il y a
tin tenon nopq r s tu , dont la cavité nopq reçoit la
plaque circulaire Q_R. L’extrémité q d’une plaque
qui fait refîbrt p q , efl fixée par une vis r à l’intérieur
d« la plaque fupérieure rs, pendant que fon autre
extrémité p , en tournant la tête de la vis t , preffe
fur le cercle Q. Pour empêcher cette preflion de
changer lé plan du cercle <2 R , 6c conféquemment la
pofition de l’axe H I , le tenon nopq a la liberté de
céder, ou de tourner fur les extrémités de deux vis
qui entrent dans des trous coniques, fitués dans les
bords oppofés de la plaque inférieure no. On voit
une de ces vis en » , 6c la piece fixe dans laquelle elles
fe vident eft repréfentée féparement & en plein
en n x y [ \ n^ étant les points fur lefquels le tenon
tourne, par ce moyen la même vis en f fait que la
plaque fupérieure 6c l’inférieure du tenon nopq,
compriment le cercle Q uniformément. Un tenon
femblable eft attaché à la branche O , afin de preffer
le cercle a c 6c la plaque tranfverfe M N , l’un contre
l’autre, de façon que le fecleur refte fixe dans une po->
fition quelconque. La charnière ou i’ajuftement en F,
dont il a été fait mention plus haut, ne confifte qu’en
une goupille cylindrique qui paffe par les plaques M
N , ac. La tête plate de la goupille eft fixée par trois
petites vis à la plaque M N , 6c à l’autre extrémité de
cette goupille eft attachée , au moyen d’une vis qui fe
vide dans la goupille,une plaque circulaire qui fait
reffort. L’ajuftement du point C eft fait de la même
façon.
La figure repréfente la difpofition 6c la conftruc-
tion des pièces qui fervent à faire mouvoir le télefcope
, en tournant la tête de la vis g. Les pièces principales
font la vis gab, une piece mn, au-travers de
laquelle elle paffe, 6c la piece hei, ou eft l’écrou dans
lequel entre la vis. La piece m n eft une efpece d’aif-
lieu fort court, percé d’un trou pour laiffer paffer la
vis. Cet axe ou aiffieu, pofé perpendiculairement au
limbe, eft retenu dans cette pofition par un coq no.
Il eft mobile autour de fes pivots mn, afin que la vis
obéiffe au petit mouvement angulaire qu’elle eft obligée
d’avoir néceffairement, l’écrou c fe mouvant dans
un arc de cercle. Cet écrou c a une partie quitraver-
fant l’entaille circulaire d e , eft reçue dans un trou
fait à la plaque du vernerus, de façon qu’elle fait
corps avec fui, quoiqu’elle puiffe tourner dans ce
trou. Or cette plaque étant fixée par une de fes extrémités
au télefcope , il s’ enfuit qu’en tournant l’écrou
d’un fe»s ou de l ’autre, on fera mouvoir le télefcope
en avant ou en arriéré ; h 6 c i font les têtes
de deux vis dont les tiges paftent tout à la fois au-
travers d’une plaque qui fait reffort ( pour rendre le
mouvement uniforme ) d , au-travers de l’entaille
d e , pour aller fe viffer dans la plaque du vernerus. •
La longue vis gab porte de chaque côté de l’axe
mn, deux efpeces de viroles qui lui fervent comme
de parties ou d’épaulemens pour l’empêcher d’avan-
eer ou de reculer. La petite piece bp eft fendue pour
recevoir l’extrémité de cette vis qu’elle ne fert qu’à
guider.
Voici les dimenfions de cet infiniment en piés 6c
pouces anglois ; on. en trouvera le rapport avec nos
mefures à L‘article PiÉ. La longueur du télefcope, ou
le rayon du fecleur, eft de i piés f ; la largeur du
rayon vers C, eft d’ i pouce Ÿ; 6c vers D , de î pouces.
La largeur du limbe A B , eft d’ i pouce•{ ; & fe
longueur de 6 pouces, contenant io degrés, divifés
chacun de 15 en 15 minutes. Le télefcope porte un
vernenis, ou plaque à fubdivifer, voyc{ V ernerus,
dont la longueur étant égale à 16 quarts de degré,
eft divifée en 15 parties égales, ce qui divife le limbe
en minutes ; 6c par l’eftimation en plus petites
parties, l’axe quarré H I F , a 18 pouces de longueur,
6c la partie H I en a 12 pouces. Son épaiffeur eft aux
.environs d’^ pouce. Le diamètre des cercles Q R 6c
abc, font chacun de 5 pouces, pour l’épaiffeur des
plaques ; Sc les autres dimenfions, on peut les laiffer à
la difpofition de l’ouvrier.
Manière de rectifier cet infirument. On placera l’in-
terfeâion des fils tranfverles à la même diftance dû
plan du fecleur, que l’axe du verre obje&if.
Par ce moyen le plan décrit par la ligne de vu e, en
feifant mouvoir le télefcope autour du point C , fera
affez jufte 6c exemt d’aucune courbure conique.
Pour s’en affurer, on fufpendra un long fil à plomb,
à une diftance convenable de l’inftrument; on fixera
le plan du fecleur dans une pofition verticale , 6c on
obfervera alors fi pendant que le télefcope fe meut
au moyen de la v is, le long du limbe, les fils tranfverles
paroiffent toujours le mouvoir le long de la ligne
à plomb.
L ’axe h f 0 pourra être placé prefque parallèlement
à l’axe de la terre, par le moyen d’un petit cadran ordinaire.
Enfuite pour le fituer parfaitement parallèle
à cet axe, on obfervera quelques-unes des étoiles des
environs du pôle, &c le télelcope étant fixé fur le
limbe, on fera fuivre à la ligne de vue le mouvement
circulaire de cette étoile autour du pôle, en tournant
tout l’inftrument fur fon axe hfo. Que l’on fuppofe
pour cet effet le télefcope k l , dirigé vers l’étoile a %
quand elle paffe au plus haut point de fon cercle diurne
, 6c qu’on remarque la divifion coupée par le vernerus
fur le limbe, cette étoile arrivera 12 heures
après au point le plus bas du même cercle. Alors
ayant fait faire à l’inftrument une demi - révolution
fur fon axe ,pour amener le télelcope dans la pofition
mn, fi les fils tranfverfes couvrent la même étoile
fuppofée en b, l’élévation de l’axe h f 0 fera parfaitement
jufte ; que fi au contraire ils ne la couvroient
pas, 6c qu’il fallût mouvoir le télefcope dans la pofition
(xv, afin de pointer à cette étoile ; on connoîtra
l’arc m p. qui meliire l’angle mfp. ou b fc , & alors on
abaiffera l’axe hfo de la moitié de l’angle connu, fi
l’étoile paffe au-deffous, ou on l’élevera d’autant, fi
c’eft au-deffus ; enfuite on repétera la même obfer-
vation jufqu’à ce qu’on ait trouvé la véritable pofition
de l’axe. On corrigera par des obfervations fem-
blables, faites fur la meme étoile dans le cercle de fix
heures, les erreurs de pofition de l’ax e, foit à l’eft,
foit à l’oueft, jufqu’à cë que les fils tranfverfes fui-
vent l’étoile tout au tour du pôle. Cette maniéré d’opérer
eft claire ; car fuppofant aopbc un arc du mé-
I ridien ( ou dans la fécondé opération, un arc du cer-
1 cle de fix heures ) , 6c feifant l’angle a fp égal à la
moitié de l’angle a fc , la ligne fp pointera au pôle 9
6c l’angle o fp , qui eft l’erreur de pofition de l’axe,
fera égal à la moitié de l’angle bfc ou mf/x, trouvé
j par l’obfervation, puifque la différence des deux angles
q fb , afe y eft double de la différence de leurs
moitiés afo 6c afp. Il eft prefque inutile d’ajouter
qu’à moins que l’étoile ne foit fort près du pôle, ü
faudra faire attention aux réfractions. ( T )
Secleur de M. Graham, eft encore un infiniment
d’Aftronomie , qui fert à obferver les diftances des
étoiles au zénith lorfqu’elles en paffent fort près. La
première idée en eft due au docteur Hook , qui l’a-
voit imaginé pour déterminer la parallaxe des étoiles
fixes ; mais par les changemens 6c les additions
que M. Graham y a faits, il l’a rendu comme un nou-
.vel infiniment dont on peut le regarder comme l’inventeur.
C’eft avec un fecleur que M.Bradley a fait
la femeufe découverte de l’aberration des étoiles
fixes , 6c c’eft aufli avec un fecleur exécuté fous les
yeux 6c par les foins de M. Graham , que MM. les
académiciens du Nord ont déterminé l’amplitude de
l’arc du méridien qui devoit établir la grandeur du
degré fous le cercle polaire. Nous rapporterons ici
la defeription qu’ils en ont donnée, parce qu’il feroit
impoflible d’en donner une meilleure.
Ce qu’on appelle proprement fecleur dans l’inftrument
dont il s’agit, eft une lunette D N , garnie d’un
limbe ou,proportion de cercle T V3 qui a pour rayon
la diftance D G qu’il y n de l’objeffif à fon foyer.
Ce fetleur eft porté par un autre fecleur immobile
qui lui eft concentrique, & dans le plan duquel il fe
.peut mouvoir en tournant fur l’axe qui paffe par les
centres des deux fecleur s.
Ce fécond fecleur qui porte le vraifecleur, eft porté
lui-même par un pié qui a la figure d’une pyramide
tronquée.
La première figure fait voir l’inftrument entier
avec fes pièces aflemblées ; mais outre que cette figure
n’eft pas, affez grande pour en faire voir le détail
, il y a plufieurs chofes effentielles à l’inftrument
qui fe trouvent cachées, 6c d ’autres qu’on a omifes,
.parce qu’elles auroient été trop petites pour être ap-
.perçues. Toute la fufpenfion du vrai fecleur fe trouve
gâchée par le.prifme creux exagonal, qui termine le
haut du pié 4 6c le micromètre que l’on place fur le
limbe du fécond fecleur, 6c qui fert à conduire le vrai
fecleur 6c à régler fon mouvement, a été omis, parce
.qu’il .feroit devenu trop petit, 6c que le limbe du
vrai fecleur en auroit cache la plus grande partie. Il
faut donc avoir recours aux figures fuivantes pour
(Coimoître toutes les pièces de l’inftrument ; on va
,lcs détailler toutes en commençant par le vrai fecteur.
La fécondé figure repréfente le vrai fecleur en perf-
periive dans fes proportions , 6c la troifieme figure
en fait voir les principales parties plus en grand dans
une élévation géométrale tronquée : les lettres font
relatives à la fécondé & troifieme figures, mais il a
été impoflible de mettre fur la fécondé toutes celles
qui font fur la troifieme.
D N eft un tube cylindrique de lunette , long de
8 piés .11 pouces , fait de laiton bien écroui ,.ce tube
a trois parties dans fe longueur ; les deux premières
parties D E , F G ont trois pouces de diamètre, 6c
chacune eft garnie à fes extrémités de frettes cylindriques
de cuivre ; la troifieme partie, dans laquelle
«entrei’oculaire, n’a qu’un pouce de diamètre.
La frette D , qui fortifie la lunette à fon extrémité
fupérieure , contient l’objeftif ; il y a au-dedans de
cette frette une feuillure faite fur le tour , dans la-
quelleTobje&if eft exaftement enchâffé 6c tient de
lui-même avec affez de force : l’objeflif eft encore
pouffé vers le fond de fa feuillure par un tuyau à vis,
de façon qu’il eft arrêté de la maniéré la plus fixe.
La frette D porte deux tourillons A , B , de cuivre
diamétralement oppofés, dont l’axe eft bien perpendiculaire
à celui de la lunette. Ges deux tourillons
fervent à fufpendre la lunette q ui, quand elle eft libre
, peut oicilier comme un pendule. Le tourillon
A porte un cylindre C d’acier trempé de trois quarts
de ligne de diamètre ; 6c ce petit cylindre, qui a
même axe que les tourillons A , B , eft diminue autant
qu’il eft poffible vers fon extrémité, de maniéré
qu’à 1 endroit de l’entaille il reffemble à deux cônes
oppofés par la pointe : cette entaille eft faite pour
recevoir la boucle d’un fil à-plomb , dont on verra
l’ufage.
La frette E qui eft au bout inférieur de la première
partie , 6c la frette i^qui eft au bout fupérieur de la
fécondé , font foudées à des brides circulaires, aufli
de cuivre ; ces deux brides qui font liées enfemble
par des v is , fervent à affembler folidement les deux
premières parties du tube D G. Si ce tube D G a voit
-été d’une feule piece, on n’auroit pas eu befoin deS
deux frettes E .F, mais alors il n’auroit pas été pofli-
ble de l’écrouir aufli parfaitement qu’en le feifant de
deux pièces ; au refte, ces deux parties de tube ne fe
defaffemblent jamais.
La frette G qui eft à l’extrémité inférieure de la
-fécondé partie du tube, porte un miroir plan K d’acier
bien poli, qu’on recouvre d’une piece de cuivre
L , quand on ne fait point ufage de la lunette :
-c’eft par ce miroir que la vis du micromètre , que
nous expliquerons, pouffe la lunette pour lui donner
l’inclinaifon néceffaire dans les obfervations. Sur le
couvercle L du miroir eft un trait léger qui eft hori-
fontal quand le miroir eft couvert ; ce trait fert à
marquer la: hauteur oh doit être lavis du micromètre.
Ainfi avant que de découvrir le miroir , il feut
hauffer ou baiffer le micromètre jufqu’à ce que la
pointe de fa vis foit précifément fur le trait du cou-
wrcle.
Le dedans de la frette G eft tourné en forme de
•feuillure circulaire ; cette feuillure reçoit un chaflis
-rond, precifément de même diamètre: la pofition du
chaflis dans la feuillure eft déterminée par deux piés
diamétralement oppofés, qui tiennent à la feuillure
6c entrent dans deux petits trousfaits au chaflis. Enfin
le chaflis eft arrêté dans la feuillure par quatre vis
qui l’y retiennent folidement. Ce chaflis eft exactement
place au foyer de l’objeCtif, il eft percé d’une
large ouverture d’environ deux pouces de diamèt
re , & porte deux fils d’argent extrêmement fins,
croifés à angles droits & perpendiculaires à l’axe de
ia lunette dans lequel ils fe croifent. L’un de ces fils
eft parallèle à l’axe des tourillons A , B . La pofition
des fils fur le chaflis eft invariable ; car le chaflis eft
perce de quatre trous qui ne font guere plus gros
que les fils qui y paffent ; une extrémité de chaque
fil eft arretee dans fon trou par une goupille , 6c les
deux autres extrémités font tirées par des refforts
qui tiennent toujours les fils bien tendus, malgré leur
racourciflèment dans le froid 6c leur alongcment dans
le chaud.
La meme frette G eft fixée perpendiculairement
fur une platine quarrée de cuivre, à laquelle font attachées
plufieurs pièces qu’on va expliquer.
i° . Une piece de cuivre M parallèle au miroir S f
au-deffous duquel elle eft placée. C ’éft par cett®
piece M qu’on commence à pouffer la lunette pat
le moyen d’une fécondé vis qui eft au micromètre ï
cette piece M 6c la vis qui la pouffe , fervent à empêcher
la principale vis du micromètre de s’émouf-
lèr en heurtant contre le miroir d’acier K .
20. Un limbe T V plan , perpendiculaire à l’aXè
des tourillons A , B , & dont la face antérieure eft
aufli éloignée de l’axe de la lunette, que l’entaille C
du cylindre d’acier eft diftantè du même axe. Sur ce
limbe font tracés deux arcs , qui ont tous deux l’entaille
C pour centre ; ces deux arcs font chacun dè
cinq degres 6c demi, & font divifés de fept minutes
& demie en fept minutes & demie par des points
très fins qu’on peut à peine appercevoir : les points
du cercle inférieur font plus fins que ceux du fupérieur
; ces deux arcs peuvent fervir à fe vérifier mutuellement.