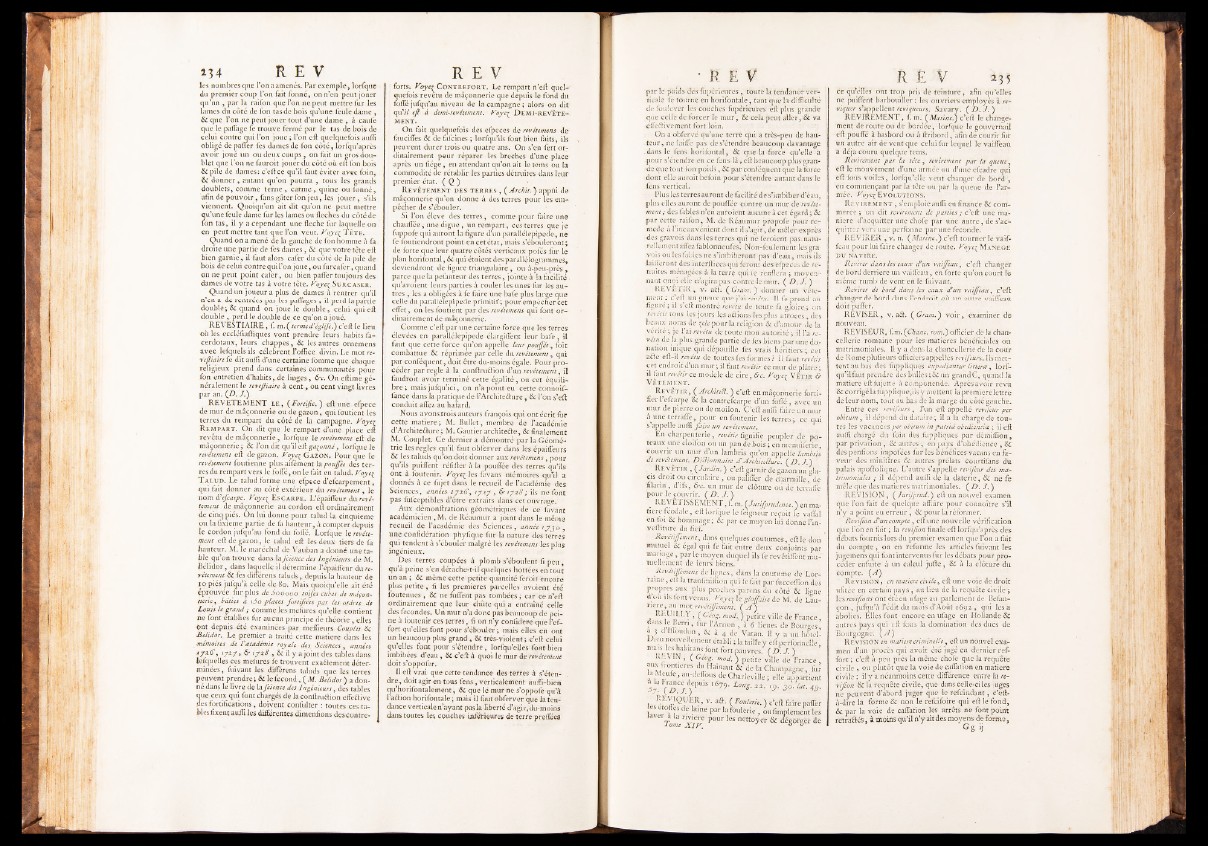
i 34 R E V R E V les nombres que l’on a amenés. Par exemple, lorsque
du premier coup l’on fait formé, on n’en peut jouer
qu’un , par la raifon que l’on ne peut mettre fur les
lames du côté de fon tas de bois qu’une feule dame ,
8c que l’on ne peut jouer tout d’une dame , à caufe
que le paflage le trouve fermé par le tas de bois de
celui contre qui l’on joue ; l’on eft quelquefois aufli
obligé de pafler les dames de fon côté, lorfqu’après
avoir joué un ou deux coups, on lait un gros doublet
que l’on ne fauroit jouer du côté où eft fon bois
8c pile de dames: c’eft ce qu’il faut éviter avec foin,
8c donner, autant qu’on pourra , tous les grands
doublets, comme terne , carme, quine ou lonné,
afin de pouvoir, fans gâter fon jeu, les jouer, s’ils
viennent. Quoiqu’on ait dit qu’on ne peut mettre
Îpi’une feule dame fur les lames ou fléchés du côté de
on tas, il y a cependant une fléché fur laquelle on
en peut mettre tant que l’on veut. Voye{ T ête.
Quand on a mené de la gauche de fon homme à fa
droite une partie de fes dames, 8c que votre tête elt
bien garnie, il faut alors cafèr du côté de la pile de
bois de celui contre qui l’on joue, ou furcafer, quand
on ne peut point caler, ou bien pafler toujours des
dames de votre tas à votre tête. Voye\ Surcaser.
Quand un joueur a plus de dames à rentrer qu’il
n’en a de rentrées par les pafîages , il perd la partie
double; 8c quand on joue le double, celui qui eft
double , perd le double de ce qu’on a joué.
REVESTIAIRE, f. m. ( terme d'églife.) c’eft le lieu
où les eccléfiaftiques vont prendre leurs habits fa-
cerdotaux, leurs chappes, 8c les autres ornemens
avec lefquels ils célèbrent l’office divin. Le mot re-
vefîiaire fe dit aulfi d’une certaine fomme que chaque
religieux prend dans certaines communautés pour
fon entretien d’habits, de linges, &c. On eftime généralement
le revefiiaire à cent, ou cent vingt livres
par an. (D . J .)
REVETEMENT l e , ( Fortifie. ) eftime efpece
de mur de mâçonnerie ou de gazon, qui foutient les
terres du rempart du côté de la campagne. Voye^
Rem pa rt . On dit que le rempart d’une place efl
revêtu de mâçonnerie, lorfque le revêtement efl de
mâçonnerie ; 8c l’on dit qu’il efl galonné, lorfque le
revêtement efl de gazon. Voye^ Gazon. Pour que le
revêtement foutienne plus aifément la pouffée des terres
du rempart vers le fofle, on le fait en talud. Voye^
T alud. Le talud forme une efpece d’efearpement,
qui fait donner au côté extérieur du revêtement, le
nom d'efearpe. Voye{ Esca rpe. L’épaiflëur du revêtement
de mâçonnerie au cordon eu ordinairement
de cinq piés. On lui donne pour talud la cinquième
ou la fixieme partie de fa hauteur, à compter depuis
le cordon jufqu’au fond du fofle. Lorfque le revêtement
efl de gazon, le talud efl les deux tiers de fa
hauteur. M. le maréchal de Vauban a donné une table
qu’on trouve dans la fcience des Ingénieurs de M.
Belidor, dans laquelle il détermine Pépaifl’eur du revêtement
8c fes drfterens taluds, depuis la hauteur de
1° piés jufqu’à celle de 8o. Mais quoiqu’elle ait été
éprouvée fur plus de 600000 toifes cubes de maçonnerie,
bâties à i5o places fortifiées par les ordres de
Louis le ffrand ; comme les meliires qu’elle contient
ne font établies fur aucun principe de théorie, elles !
Ont depuis ete examinées par meilleurs Couplet 6c
Belidor. Le premier a traité cette matière dans les
mémoires de l'académie royale des Sciences, années
4 7 x 6 , 1 7x 7 y & 1 7 x 8 , 6c il y a joint des tables dans
lesquelles ces meliires fe trouvent exa&ement déterminées
, fuivant les différons taluds que les terres
.peuvent prendre ; 6c le fécond, ( M. Belidor ) a donné
dans le livre de la fcience des Ingénieurs des tables
que ceux qui font chargés de la conftru&ion effective
des fortifications, doivent confulter : toutes ces tables
fixent aufli les différentes dimeniions des contreforts.
yjye? Contrefort. Le rempart n’efl quelquefois
revetu de mâçonnerie que depuis le fond du
fofle jufqu’au niveau de la campagne ; alors on dit
qu’i/ efi à demi-revêtement. Voyeç DEMI-REVÊTE-
MENT.
On fait quelquefois des efpeces de revêtemens de
faucilles 8c de fafeines ; lorfqu’ils font bien faits, ils
peuvent durer trois ou quatre ans. On s’en fert ordinairement
pour réparer les breches d’une place
après un liège, en attendant qu’on ait le tems ou la
commodité de rétablir les parties détruites dans leur
premier état. ( Q )
Revêtement des terres , (Archit.) appûi de
mâçonnerie qu’on donne à des terres pour les empêcher
de s’ébouler.
Si l’on éleve des terres, comme pour faire une
chauffée, une digue , un rempart, ces terres que je
fuppofe qui auront la figure d’un parallélépipède, ne
fe foutiendront point en cet état, mais s’ébouleront;
de forte que leur quatre côtés verticaux pofés fur le
plan horilontal, & qu i étoient des parallélogrammes,
deviendront de figure triangulaire , ou à-peu-près ,
parce que la pefanteur des terres, jointe à la facilité .
qu’avoient leurs parties à rouler les unes fur les autres
, les a obligées à fe faire une bafe plus large que
celle du parallélépipède primitif ; pour empêcher cet
effet, on les foutient par des revêtemens qui font ordinairement
de mâçonn.erie.
Comme c 'eftpar une certaine force que les terres
élevées en parallélépipède élargiflent leur bafe, il
faut que cette force qu’on appelle leur pouffée, foit
combattue 6c réprimée par celle du revêtement, qui
par conféquent, doit être du-moins égale. Pour procéder
par réglé à la conftruâion d’un revêtement, il
faudroit avoir terminé cette égalité, ou cet équilibre;
mais jufqu’ic i, on n’a point eu cette connoif-
fance dans la pratique de l’Archite&ure, 6c l’on s’eft
conduit aflez au hafard.
Nous avonstrois auteurs françois qui ont écrit fur
cette matière ; M. Bullet, membre de l’académie
d’Architecture ; M. Gautier architefte, 6c finalement
M. Couplet. Ce dernier a démontré par la Géométrie
les réglés qu’il faut obferver dans les épaifleurs
6c les taluds qu’on.doit donner aux revêtemens, pour
qu’ils puiflent réfifter à la pouffée des terres qu’ils
ont à foutenir. Voye^ les favans mémoires qu’il a
donnés à ce fujet dans le recueil de l’académie des
Sciences, années 17 x6 , 17x7 , & 17x8; ils ne font
pas fufceptibles d’être extraits dans cet ouvrage.
Aux démonftrations géométriques dé ce favant
académicien , M. de Réaumur a joint dans le même
recueil de l’académie des Sciences, année 1J30
une confidération phyfique fur la nature des terres
qui tendent à s’ébouler malgré les revêtemens les plus
ingénieux.
Des terres coupées à plomb s’éboulent fi peu,
qu’à peine s’en détache-t-il quelques hottées en tout
un an ; 6c même cette petite quantité feroit encore
plus petite, fi les premières parcelles avoient été
loutenues , 6c ne fuflent pas tombées ; car cè n’eft
ordinairement que leur chute qui a entraîné celle
des fécondés. Un mur n’a donc pas beaucoup de peine
à foutenir ces terres, fi on n’y confidere que l’effort
qu’ elles font pour s’ébouler ; mais elles en ont
un beaucoup plus grand , 8c très-violent ; c’eft celui
qu’elles font pour s’étendre, lorfqu’eUes font bien
imbibées d’eau , 8c c’eft à quoi le mur de revêtement
doit s’oppofer.
Il efl vrai que cette tendance des terres à s’étendre,
doit agir en fous fens , verticalement àuflî-bien
qu’horifontalement, 8c que lé mur ne s’oppofe qu’à
l’aélion horifontale ; mais il faut obferver que la tendance
verticale n’ayant pas la liberté d’agir, du-moins
dans toutes les couches inférieures de terre preflées
par lé poids dés fupérieures , toute la tendance verticale
fe tourne en horifontale, tant que la difficulté
de fouîever les couches fupérieutes efl plus grande
que celle de forcer le mur, & celap’eut aller, & va
etfeéHvement fort loin.
On a obfervé qu’une terre qui a très-peu de-hauteur
, ne laifle pas de s’étendre beaucoup davantage
.dans le fens horifontal, & que la force qu’elle a
pour s’étendre en ce fens-là, eft beaucoup plus grande
que tout fon poids, 6c par conféquent que la force
dont elle auroit befoin pour s’étendre autant dans le
fens vertical.
Plus les terres auront de facilité de s’imbiber d’éau,
plus elles auront de pouffée contre un mur d q revêtement
; des fables n’en aufoient aucune à cet égard ; &
par cette raifon, M. de Réatimur propofe pour remec!
e à l’inconvénient dont il s’agit, de mêler exprès
des gravois dans les terres qui ne feroient pas. naturellement
aflez fabïonneufes. Non-feulement les gravois
ou les fables ne s’imbiberont pas d’eaü, mais ils
laineront des interftices qui feront des ëfp'écds de retraites
ménagées à la terre qui le renflera ; moyennant
quoi elle n’agira pas contre le mur. ( D . J . }
REVE TIR , v. a£f. ( Gram. ) donner un vêtement
; c’eft un gueux que j’ai revêtu. Il fe prend au
figuré; il s’eft montré revêtu de toute fa gloire.; on
revêtit tous les jours lesaûions les plus atroces, des
heaux noms cle %ele pour la religion & d’amour de la
vente ; je l’ai revêtu de toute mon autorité ; ?il l’a revêtu
de la plus grande partie de fes biens par une donation
inique qui dépouille fes Vrais héritiers ; cet
ade eft-il revêtu de toutes fes formes ? 11, faut revêtir
cet endroit d’un mur ; il faut revêtir ce mur déplâtre ;
il faut revêtir ce modèle de cire, &c. Foyc^ VÊti# &
V êtement.
L -t cuiureicarpe a un a« vcv. uu
mur de pierre ou de moilon. C ’eft aufli faire v
^ une terràfle, pour en foutenir les terres ; ce qui
s’appelle aufli faire un revêtement.
En charpenterie, revêtir fignifie peupler cle poteaux
une cloifon ou un pan de bois ; en menuiferie,
couvrir un nuir d’un lambris qu’on appelle lambris
de revêtement. Dictionnaire d'Architecture. (D . J .) '
. Rev êtir , ( Jardin. ) c’eft garnir de gazon un glacis
droit ou circulaire, ou palifler de charmille, de
filarin , d’ifs, &c. un mur de clôture où de terrafle
pour le couvrir. ( Z>. J. )
REVÊTISSEMENT, (. m. Uurifprudence. ) en ma-
tiere feodale, efl lorfque le feigneur reçoit le vaflal
en foi 8c hommage; 8c par ce moyen lui donne l’in-
veftiture du fief.
Revêtijfemem, dans quelques coutume^, efl lé don
mutuel 6c égal qui fe fait entre deux conjoints par
mariage, par le moyen duquel ils fe revêtiflent mutuellement
de leurs biens.
Revêtijfernent de lignes, dans la Coutume de Lorraine
, efl la tranfmiflion qui fe fait par fticcefflon des
propres aux plus proches parons du côté 8c ligné
d ou ils lent venus. Voyeç le glofj'àirc de M. de Lau-
liere , au mot revêtiffeinent. ( A )
! ( GéoS- mod.,) petite ville de France,
I *ur l’Arnon , à 6 lieues de Bourges,
a 3 d Mbirdun, & à 4 ds Vàtan. Il y 4 un lïftd-
Dieu nouvellement établi ; la taille y èlt pefldiiricïié,
. . ’ . mod. ) petite ville dë France,
aux frontières du Haina„ t & de la Champagne, fur
la Meure, au-deffous de Charleville ; elle appartient
a ta W e touia i o „ g . jg,^.
v. àô. ( FoührU. ) c’eft fairepaïïër
H B m d? mm — g , ouflmp'lemënt les
H ld r™ «-e pour les ntttoy«■ & dêgôlgèf Së
ceqtféfles ont trop pris dé teinture, afin qu’elles
ne puiflent barbouiller : les ouvriers employés à rc-
viqtièr s’appellent reviqueurs, Savary. (D . J .)
REVIREMENT, f. m. (Marine.) e’eft le changement
de route ou de bordée, lorfque le gouverhail
•éft pouffé à basbord ou à ftribord, afin de courir fur
un autre air de vent que celui fur lequel le vaifleati
a déjà couru quelque tems.
Revirevient par la tête , tevirernent par la queue,
efl le mouvement d’une armée ou d’une efeadre qui
efl foiis voiles, lorfqu’elle veut changer de bord
en commençant par la tête ou par là queue de l’armée.
yoye^ Evolutions.
Revirement , s’emploieaufli en financé 8c commerce
; On dit revirement de parties ; c’eft une maniéré
d’acquitter une chofe par Une autre, de s’acquitter
vers une perfonne par une fécondé.
REVIRER , v. n. {M a r in e c’eft tourner le vaif-
feau pour lui faire changer de route. Voye^ Manege
DU NAVIRE.
Revirer dans les eaux d'un vaijfeau, c’eft changer
de bord derrière un vaifleau , en forte qu’on court le
même rumb de vent en le fuivant.
Revirer de bord dans les eaux d'un vaijfeau, c’eft
changer de bord dans l’endroit où un autre vaifleau
doit pafler.
REVISER, v, a£t. ( Gram. ) v o ir , examiner de
nouveau.
REVISEUR, f.m. (Chanc. rom.') officier de la chancellerie
romqine pour les matières bénéficiales ou
matrimoniales. .Il y a dans la chancellerie de la cotfr
de Rome phffieurs officiers appelles revifeurs. Ils mettent
au bas des fuppliques expediantur litterà , lorf-
qn’ilfaut prendre des b allé s ; & un grand C , quand la
matière éft liijette à comportende. Après àvoir revu
& corrigé la (Applique,ils y mettfent la première lettre
de leur nom, tout au bas de la marge du côté gauche.
Entre ces revifeurs, l’un eft appelle revifeur per
obitum , il dépend du dataire ; il a la charge de toutes
les vacances per obitum in patriâ obediemia ; il eft
aufli chargé du foin des fuppliques par démiffion,
par privation , 8c autres -, en pays d’obédience , &
des penfions impofées fur les bénéfices vacans en faveur
des miniftres 6c autres prélats courtifans du
palais apoftolique. L’autre s’appelle revifeur des matrimoniales
; il dépend aufli de la daterie, 8c ne fe
mêle que desmatierèsmatrimoniales. ' ( D . J .)
REVISION, ( Jurifprud. ) eft un nouvel examen
que l’on fait de quelque affaire pour connoître s’il
n’y a point eu erreur , 8c pour la réformer.
Rèvifion d'un compte, eft une nouvelle vérification
que l’on en fait ; la rèvifion finale eft lorfqu’après des
débats fournis lors du premier examen que l’on a fait
du compte, on en reforme les articles fuivant les
jugemens qui font intervenus fur les débats pour procéder
enfuite à un calcul jufte, & à la clôture du
compte. (A )
Révision , en matière civile, eft une voie de droit
ufitée en certain pays , au lieu de la requête civile;
les rtvïfions ont été en ufage au parlement de Befan-
çon , jufqu’ à l ’édit du mois d’Août 1692 , qui les a
abolies. Elles font encore en ufage en Hollande &
autres pays qui eft fous la domination des ducs de
Bourgogne. { A )
Révision en matière criminelle, eft un nouvel examen
d’un procès qui avoit été jugé en dernier ref-
fort; c’eft à peu près la même chofe que la requête
civile , ou plutôt que la voie de caflation en matière
civile ; il y a néanmoins cette différence entre la re-
vifion 6c la requête civile, que dans celle-ci les mges
ne peuvent d’abord juger que le réfeindant, c’eft-
à-dire la forme 8c non le refeifoire qui eft le fond,
8c par la voie de caflation les arrêts ne font point
retraûés, à moins qu’il n’y ait des moy ens de forme, Gs