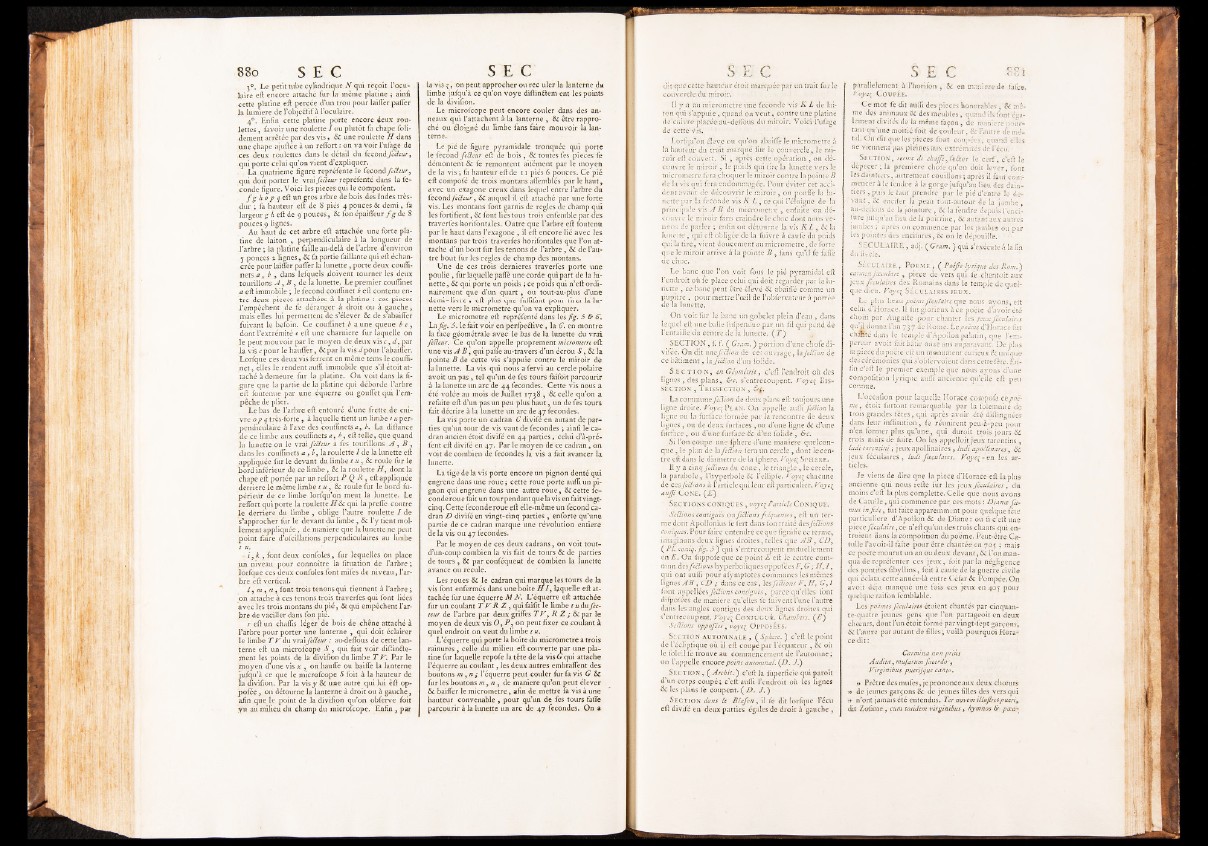
3°. Le petit tube cylindrique A’'qui reçoit l’oculaire
eft encore attaché fur- la même platine ; ainfi
cette platine eft percée d’un, trou pour laifTer paffer
la lumière de l’objeftif à l’oculaire.
4°. Enfin cette platine porte encore deux roulettes
, favoir une roulette I ou plutôt fa chape foli-
dement arrêtée par des v is , & une roulette H dans
une chape ajuftée à un reffort : on va Voir l’ufage de
.ces deux roulettes dans le détail du fécond fecleur,
qui porte celui qu’on vient d’expliquer.
La quatrième figure repréfente le fécond fecleur,
qui doit porter le vrai fetteur repréfenté dans la fécondé
figure. Voici les pièces qui le compofent.
f ë A o p q eft un gros arbre de bois des Indes très-
dur ; fa hauteur eft de 8 pies 4 pouces & demi, fa
largeur g À eft de 9 pouces, & fon épaiffeur f g de 8
pouces ,9 lignes.
Au haut de cet arbre eft attachée une forte platine
de laiton , perpendiculaire à la longueur de
l’arbre ; la platine faille au-delà de l’arbre d’environ
5 pouces z lignes, & fa partie faillante qui eft échan-
. crée pour laiffer paffer la lunette, porte deux couffi-
nets a , b , dans lefquels doivent tourner les deux
tourillons A , B , de la lunette. Le premier couflinet
a eft immobile ; le fécond couflinet b eft contenu entre
deux pièces attachées à la platine : ces pièces
l’empêchent de fe déranger à droit ou à gauche,
mais elles lui permettent de s’élever & de s’abaiffer
fuivant le befoin. Ce .couflinet b a une queue b e ,
dont l’extrémité e eft une charnière fur laquelle on
le peut mouvoir par le moyen de deux vis c , d , par
la vis c pour le hauffer, & par la vis d pour l’abaiffer.
Lorfque ces deux vis ferrent en même tems le couflinet,
elles le rendent aufli immobile que s’il étoit attaché
à demeure fur la platine. On voit dans la figure
que la partie de la platine qui déborde l’arbre
eft foutenue par une équerre ou gouffet qui l’empêche
de plier. .
Le bas de l’arbre eft entouré d’une frette. de cuivre
o p q très-forte , à laquelle tient un limbe t u perpendiculaire
à l’axe des couflinets/z, b. La diftance
de.ce limbe aux couflinets a, b , eft telle, que quand
la lunette ou le vrai fecleur a fes tourillons A , B ,
dans les couflinets a , b, la roulette I de la lunette eft
appliquée fur le devant du limbe t u roule fur le
bord inférieur de ce limbe, & la roulette H , dont la
chape eft portée par un reflort P Q R , eft appliquée
derrière le même limbe / u , & roule fur le bord fu-
périeür de ce limbe lorfqu’on meut la lunette. Le
reflort qui porte la roulette H&c qui la preffe contre
le derrière du limbe , oblige l’autre roulette I de
s’approcher fur le devant du limbe, & l’y tient mollement
appliquée, de maniéré que la lunette ne peut
point faire d’olcillations perpendiculaires au limbe
t u.
i 9k , font deux confoles, fur lequelles on.place
un niveau pour connoître la fituation de l’arbre ;
lorfque ces deux confoles font mifes de niveau, l’arbre
eft vertical.
1 9 m 9n 9 font trois tenons qui tiennent à l’arbre ;
on attache à ces tenons trois traverfes qui font liées
avec les trois montans du p ié, & qui empêchent l’arbre
de vaciller dans fon pié.
r eft un chafîis léger de bois de chêne attaché à
l’arbre pour porter une lanterne , qui doit éclairer
le limbe T V du vrai fecleur : au-deffous de cette lanterne
eft un microfcope S , qui fait voir diftinéte-
ment les points de la divifion du limbe T V. Par le
moyen d’une vis x , on haufle ou baiffe la lanterne
jufqu’à ce que le microfcope S foit à la hauteur de
la divifion. Par la vis^ & une autre qui lui èft op-
p o fée, on détourne la lanterne à droit ou à gauche,
afin que le point de la divifion qu’on obferve foit
yu au milieu du champ du microfcope. Enfin, par
la vis on peut approcher ou rec uler la lanterne du
limbe jufqu’à ce qu’on voye diftinftem ent les points
de la divifion.
Le microfcope peut encore couler dans des anneaux
qui l’attachent à la lanterne , & être rapproché
ou éloigné du limbe fans faire mouvoir la lanterne.
Le pié de figure pyramidale tronquée qui porte
le fécond fecleur eft de bois, & toutes fes pièces fe
démontent & fe remontent aifément par le moyen
de la vis ; fa hauteur eft de 11 piés 6 pouces. Ce pié
eft compofé de trois montans affemblés par le haut,
avec un exagone creux dans lequel entre l’arbre du
fécond fecleur, & auquel il eft attaché par une forte
vis. Les montans font garnis de réglés de champ qui
les fortifient, & font liés tous trois enfemble par des
traverfes horifontales. Outre que l’arbre eft foutena
par le haut dans l’exagone , il eft encore lié avec les
montans par trois traverfes horifontales que l’on attache
d’un bout fur les tenons de l’arbre , & de l’autre
bout fur les réglés de champ des montans.
Une de ces trois dernieres traverfes porte une
poulie , fur laquelle paffe une corde qui part de la lunette
, & qui porte un poids ; ce poids qui n’eft ordinairement
que d’un quart , ou tout-au-plus d’une
demi-livre , eft plus que liiffifant pour tirer la lunette
vers le micromètre qu’on va expliquer.
Le micromètre eft repréfenté dans les fig. 5 & G.
La fig. i . le fait voir en perfpeélive, la G. en montre
la face géométrale avec le bas de la lunette du vrai
fecleur. Ce qu’on appelle proprement micromètre eft
une vis A B , qui paffe au-travers d’un écrou S , & la
pointe B de cette vis s’appuie contre le miroir dé
la lunette. La vis qui nous a fervi au cercle polaire
avoit un pas , tel qu’un de fes tours faifoit parcourir
à la lunette un arc de 44 fécondés. Cette vis nous a
été volée au mois de Juillet 1738 , & celle qu’on a
refaite eft d’un pas un peu plus haut, un de fes tours
fait décrire à la lunette un arc de 47 fécondés.
La vis porte un cadran C divifé en autant de parties
qu’un tour de vis vaut de fécondés ; ainfi le cadran
ancien étoit divifé en 44 parties , celui d’à-pré-
fent eft divifé en 47. Par le moyen de ce cadran, on
•voit de combien de fécondés la vis a fait avancer la
lunette.
La tige de la vis porte encore un pignon denté qui
engrene dans une roue ; cette roue porte aufli un pignon
qui engrene dans une autre roue, & cette .fécondé
roue fait un tour pendant que la vis en fait vingt-
cinq. Cette fécondé roue eft êlle-même un fécond cadran
D divifé en vingt-cinq parties , enforte qu’une
partie de ce cadran marque une révolution entière
de la vis ou 47 fécondés.
Par le moyen de ces deux cadrans, on voit tout-
d’un-coup combien la vis fait de tours & de parties
de tours , & par conféquent de combien la lunette
avance ou recule.
Les roues & le cadran qui marque les tours de la
vis font enfermés dans une Boîte H / , laquelle eft attachée
fur une équerre M N. L’équerre eft attachée
dur un coulant T V R Z , qui faifit le limbe t u du fec-
teur de l’arbre par deux griffes T V , R Z ; &c par le
moyen de deux vis 0 9 P , on peut fixer ce coulant à
quel endroit on veut du limbe t u.
L’équerre qui porte la boîte du micromètre a trois
rainures, celle du milieu eft couverte par une platine
fur laquelle repofe la tête de la vis G qui attache
l’équerre au coulant, les deux autres embraffent des
boutons m 9n ; l’équerre peut couler fur fa vis G &
fur les boutons m, n , de maniéré qu’on peut élever
& baiffer le micromètre, afin de mettre fa vis à une
hauteur convenable , pour qu’un de fes tours faffe
parcourir à la lunette un arc de 47 fécondés. On a
dit que cette hauteur étoit marquée par un trait furie
couvercle du miroir.
11 y a au micromètre une fecofide vis K L de laiton
qui s’appuie, quand cjn veut, contre une platine
de cuivre placée au-deffous du miroir. Voici l’ufage
de cëttèiriS.' J1
Loffqu-’on élev.e ou qu’on abaiffe le micromètre à
la hauteur du trait marqué fur le couvercle , le miroir
eft couvert. Si , après cette opération , on découvre
le miroir , le poids qui tire la lunette vers le
micromètre fera choquer le miroir contre la pointe B
de la vis qui fera endommagée. Pouf éviter cét àcci-
dènt avant de découvrir le miroir, on pouffe la lunette
par.la fécondé vis i f L , ce qui l’éloigne de la
principale vis A B du micromètre , enfuite on découvre
le miroir fans craindre le choc dontnôlts v enons
de parler ; enfin on détourne la vis K L , & la
lunette , qui eft obligée de la fuivre à caufe du poids
qui la tire, vient doucement au micromètre, de forte
que le miroir arrive à la pointe B , fans qu’il fe faflé
de choc. •
Le banc que l’on voit fous le pié pyramidal eft
l’endroit où fe place .celui qui d.oit. regarder par la lunette
, ce banc peut être élevé &c abaifle comme un
pupitre , pour mettre l’oeil de l’obfervateur à portée
de la lunette.
On voit fur le banc un gobelet plein d’eau , dans
lequel eft une balle fufpendue par. un fil qui pend de
l ’entaille du centre de la lunette. ( Z )
SECTION, fs f. ( Gram. ) portion d’une chofe di-
vifée. On dit unefeclion de cet ouvrage, laJeclion de
ce bâtiment, la feclion d’un foiide.
S E C t I o N , en Géométrie, c ’e ft l’e n d ro it o ù des
l ig n e s , d e s p la n s , 6'c . s ’e n t re co u p e n t . Voye[ B i s -
s e c t i o n , T r i s s e c t i o n , &ff.
L a c om m u n e feClion d e d e u x plans e ft to u jo u r s u n e
lig n e d r o ite . Voye{ P l a n . O n a p p e lle au fli Jeclion la
lig n e o u la fu r fa c e fo rm é e p a r la r en c o n t r e de d e u x
lig n e s , o u de d e u x fu r fa c e s ,o u d ’une lig n e & d ’une
fu r fa c e , ©u d ’une fu r fa c e & d ’un fo i id e , &c.
S i l ’o n c o u p e u n e fp h e r e d’une m a n ié r é q u e lc o n q
u e , le plan d e lafeclion fe ra u n c e r c l e , d o n t le c e n t
re e u dans le d iam è tr e d e la fp h e r e . Voyéç S pHERE.
11 y a cinq ferions du cône, le triangle , le cercle,
la parabole, l’hyperbole & l’ellipfe. VWM chacune
de ces feclions à l’article qui leur eft particulier. Voye£
<wjj; CoK £ . (£ )
S e c t i o n s c o n i q u e s , voyc^ Panich-Co n i q u e .
Sections contiguës Ou feclions fréquentes, eft un terme
dont Apollonius fe fert dans fon traité des feclions
coniques. Pour faire entendre ceque lignifie ce terme,
imaginons deux lignes droites, telles que A B , CD9
(X/. coniq.fig. S') qui s’entrecoupent mutuellement
en jE. On fuppolè que ce point E eft le centre commun
des feclions hyperboliques oppofées X, G ; H, / ,
qui ont aufli pour afymptotes communes les mêmes
lignes A B , CD ; dans ce cas, l e s feclions X, G, /
font appellées feclions contiguës, parce qu’elles font
difpolées de maniéré qu’elles fe fuivent l’une l’autre
dans les angles contigus des deux lignes droites qui
s’entrecoupent. Voyc{ C o n j u g u é . Chambers. (X )
Sections oppofées ,voye{ OPPOSÉES.
S e c t i o n a u t o m n a l e , ( Sphère. ) c’eft le point
de l’écliptique oii il eft coupé par l’équateur , & où
le foleil fe trouve au commencement de l’automne;
on l’appelle encore point automnal. (D. /.)
S e c t i o n , ( À relût. ) c’eft la fuperficie qui paroît
d’un corps coupé ; c’eft aufli l’endroit où les lignes
& les plans fe coupent. ( D. J. )
S e c t i o n dans le Blafon, il fe d it lo r fq u e l ’é cu
e ft d iv i fé en d e u x p a r tie s é g a le s de d r o it à g a u ch e ,
parallèlement à l’horifôn 9. & en maniéré de fafee,
Voye[. C oupée.
C e mot fe dit aufli des pièces honorables, & même
des animaux & des meubles, quand ils font également
divilés de la même façon, de maniéré oour-
tant-qu’une moitié foit de couleur, & l’autre de métal.
Giï dit que lès pièces font coupées, quand elles
ne viennent pas pleines aux extrémités de l’écu'.
Sec tio n, terme de chàffe, feéfer le cerf, c’eft le
dépecer ; la première chofe qu’on doit lever , font
les daintiers, autrement couillons ; après il faut commencer
à le fendre à la gorge jufqu’au lieu des dain-
^ers » puis le faut prendre par le pié d’entre le devant,
& encifer la peau tout-autour de la jambe ,
au-deflbus de la jointure, & la fendre depuis l’enci-
lure jufqu’au lieu de la poitrine, & autant aux autres
jambes; après on commence par les jambes ou par
les pointes des encifures, & on le dépouille.
SaCUL AIRE, adj. ( Gram. ) qui s’exécute à la fin
du ficelé.
Séculaire , Poeme , ( Poéfu lyrïqiie des R.om.')
carmen Jizculare , pièce de vers qui fe ichantpit aux'
jeuxfeculaires des Romains dans le temple de quel-
/-r,.a SSSK SKque die'u. Vo»y e{ SaÉ. .i:—ul a T-R--E--S-- -J-E--U--X- . r ^
L e plus beau poèméfiéculaire que nous ay ons, eft
celu i d’Horace. 11 fut glo.ri eux à ce poète d’ayoir été
choifi par .Augufte poui: chanter les jeux ƒ eculaires
qu’il.donna l’an 737 de Rorne. Le poème d’Horace fu,t
eha$fté dans; le tènxjîle d’Apoilon palatin, qute l’empereùr
avo:it fait bât ir onize ans auparavant..Deplqs
la piece du jjoère eft un mionument curieux & unique
desc:érémpilies qui'l’oblïM'voient dans cette fère. Enfin
c’eft le premier exemple que nous ayons d’une
compofition lyrique aufli ancienne qu’elle eft peu
connue.
L’oçcafion pour laquelle Horace compofa ce poème
, étoit furtout remarquable par la folemnité de
trois grandes fêtes, qui après avoir été diftinguées
dans leur iiiftitution, fe réunirent peu-à-peu pour
n’en former plus qu’une, qui duroit trois jours &
trois nuits de fuite. On les appelloit jeux tarentins ,
ludi tarentini ; jeuxapollinaires , ludi apollinares Sc
jeux féculaires , ludi fceculares. Voye^-en les articles.
Je viens de dire que la piece d’Horace eft la plus
ancienne qui nous refte fur les jeux féculaires, du
moins c’eft la plus complette. Celle que nous avons
de Catulle, qui commence par ces mots : Dianoe fu -
mus in fide, fut faite apparemment pour quelque fête
particuliere d’Apollon & de Diane : ou fi c’eft une
piece fèculaire9ce n’eft qu’un des trois chants qui entroient
dans la compofition du poème. Peut-être Catulle
l’avoit-il faite pour être chantée en 705 ; mais
ce poète mourut un an ou deux devant, & l’on manqua
de repréfenter ces jeux, foit par la négligence
des pontifes fibyllins, foit à caufe de la guerre civile
qui éclata cette année-là entre CéfarÔc Pompée. On
avoit déjà manqué une fois ces jeux en 405 pour
quelque raifon femblable.
Les poèmes féculaires étoiênt chantés par cinquante
quatre jeunes gens que l’on partageoit en deux
choeurs, dont l’un ctoit formé par vingt-fept garçons,
& l’autre par autant de filles ; voilà pourquoi Hora-1
ce dit:
Carmina non priàs
Audita, tnujarum facerdo'j
Virginibus puerijque canto.
» Prêtre des mufes, je prononceaux deux choeurs
» de jeunes garçons & de jeunes filles des vers qui
» n’ont jamais été entendus. Ter novem illufirespueri9
dit Zofime , cum totidem virginibus , hymnos & pce a-*