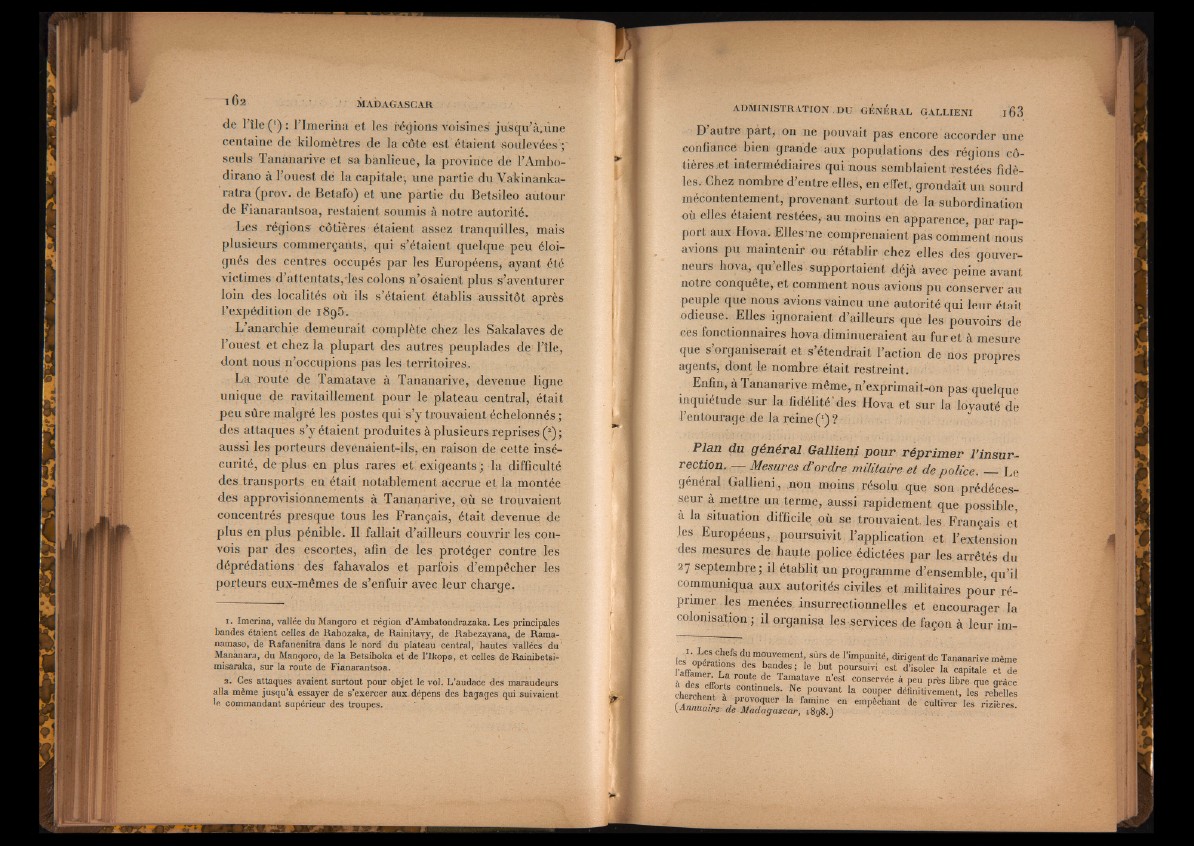
de l’île (*): l’Imerina et les régions Voisines jusqu’ à,line
centaine de kilomètres de la côte est étaient soulevées
seuls Tananarive et sa banlieue, la province de l’Ambo-
dirano à Fouest dé la capitale, une partie du Yakinanka-
ratra (prov. de Betafo) et une partie du Betsileo autour
de Fianarantsoa, restaient soumis à notre autorité.
Les régions côtières étaient assez tranquilles, mais
plusieurs commerçants, qui s’étaient quelque peu éloignés
des centres occupés par les Européens, ayant été
victimes d’attentats,des colons n’osaient plus s’aventurer
loin des localités où ils s’étaient établis aussitôt après
l’expédition de 1895.
L’anarchie demeurait complète chez les Sakalaves de
l’ouest et chez la plupart des autres peuplades de l’île,
dont nous n’occupions pas les territoires.
La route de Tamatave à Tananarive, devenue ligne
unique de ravitaillement pour le plateau central, était
peu sûre malgré les postes qui s’y trouvaient échelonnés ;
des attaques s’y étaient produites à plusieurs reprises (2);
aussi les porteurs devénâient-ils, en raison de cette insécurité,
dé plus en plus rares et exigeants ; la difficulté
des transports en était notablement accrue et la montée
dés approvisionnements à Tananarive, où se trouvaient
concentrés presque tous les Français, était devenue de
plus en plus pénible. Il fallait d’ailleurs couvrir les convois
par des escortes, afin dé les protéger contre les
déprédations des fahavalos et parfois d’empêcher les
porteurs eux-mêmes de s’enfuir avec leur charge.
1. Imerina, vallée du Mangoro et région d’Ambatondrazaka. Les principales
bandes étaient celles de Rabozaka, de Rainitayy, de Rabezavana, de Ramanamaso,
de Rafanenitra dans le nord du plateau central, hautes vallées du
Manànara, du Mangoro, de la Betsiboka et de l’ikopa, et celles deRainibetsi-
misaraka, sur la route de Fianarantsoa.
a. Ces attaques avaient surtout pour objet le vol. L’audace des maraudeurs
alla même jusqu’à essayer de s’exercer aux. dépens des bagages qui suivaient
le commandant supérieur des troupes.
D autre part, on ne pouvait pas encore accorder une
confiance bien grande aux populations des régions côtières
.et intermédiaires qui nous semblaient restées fidèles,
Chez nombre d’entre elles, en effet, grondait un sourd
mécontentement, provenant surtout de la subordination
ou elles étaient restées,-au moins en apparence, par rapport
aux Ho va. Elles ne comprenaient pas comment nous
avions pu maintenir ou rétablir chez elles des gouverneurs
hova, qu’elles supportaient déjà avec peine avant
notre conquête, et comment nous avions pu conserver au
peuple que nous avions vaincu une autorité qui leur était
odieuse. Elles ignoraient d’ailleurs que les pouvoirs de
ces fonctionnaires hova diminueraient au furet à mesure
que s’organiserait et s’étendrait l’action de nos propres
agents, dont le nombre était restreint.
Enfin, à Tananarive même, n’exprimait-on pas quelque
inquiétude sur la fidélité’ des Hova et sur la loyauté de
l’entourage de la reine(')?
Plan du général Gallieni pour réprimer l ’insur-
reçtion. — Mesures d’ordre militaire et de police. — Le
général Gallieni, non moins résolu que son prédécesseur
à mettre un terme, aussi rapidement que possible,
à la situation difficile où se trouvaient, les Français et
les Européens, poursuivit l’application et l’extension
des mesures de haute police édictées par les arrêtés du
27 septembre; il établit un programme d’ensemble, qu’il
communiqua aux autorités civiles et militaires pour réprimer
les menées, insurrectionnelles et encourager la
colonisation ; il organisa les ^services de façon à leur imles
onératinn^ t f “ ’, de 1 mPunlté> * * * * de Tananarive même
l’cdTamer La rn t h t “ 5 . hut, p0UrSUÎV1 est d'isoler ]a capitale et de
k d ^ iv , - Tamatave n est conservée à peu près libre que qràce
chethem0? C°ntmU ,Ner P°UVant * C0Uper définitivement, les rebdles
cnerchent à provoquer la famine en empêchant de cultiver les rizières
{Annuaire de Madagascar, 1898.) . - rizières.