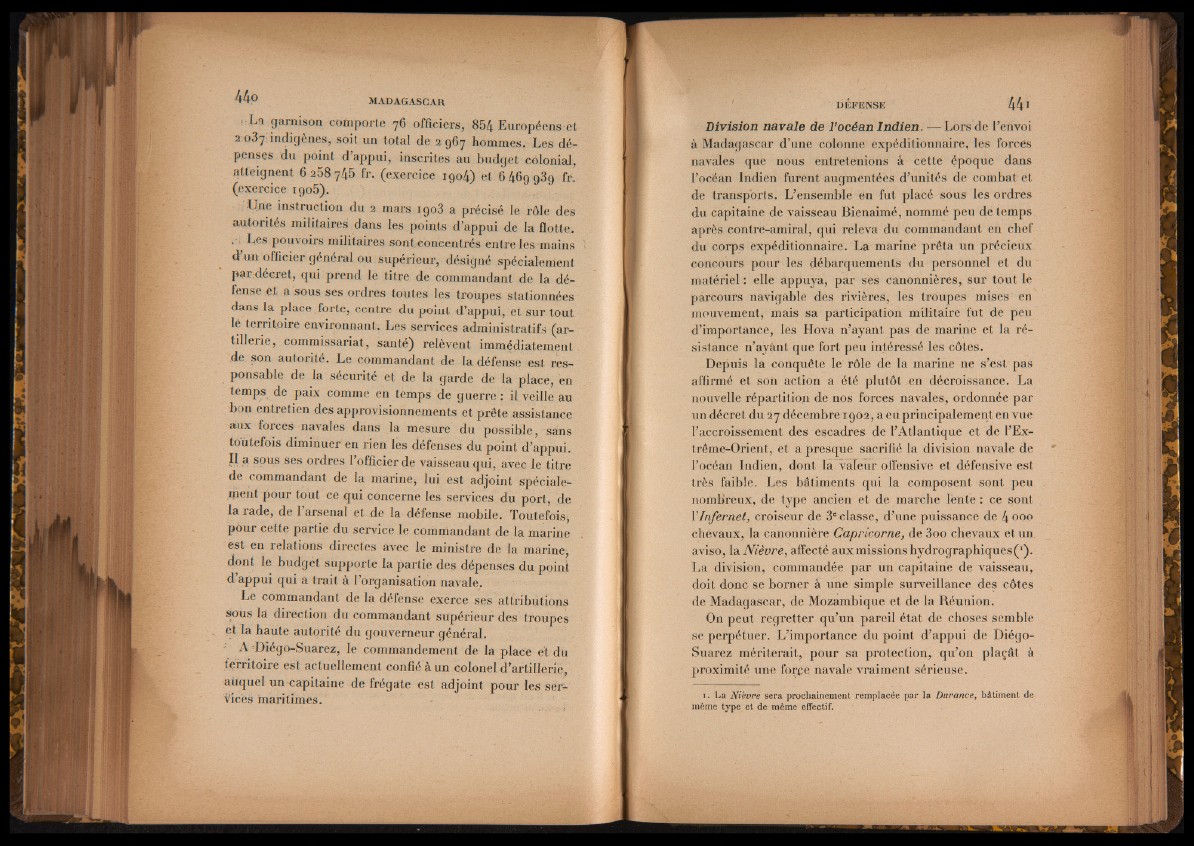
■ La garnison comporte 76 officiers, 854 Européens et
2 o37. indigènes, soit un total de 2 967 hommes. Les dépenses
du point d’appui, inscrites au budget colonial,
atteignent 6 258745 fr. (exercice 1904) et 6469939 fr.
(exercice igo5).
Une instruction du 2 mars 1903 a précisé le rôle des
autorités militaires dans les points d’appui de la flotte,
•:i Ees pouvoirs militaires sont concentrés entre les mains
d un officier général ou supérieur, désigné spécialement
pardécret, qui prend le titre de commandant de la défense
et a sous ses ordres toutes les troupes stationnées
dans la place forte, centre du point d’appui, et sur tout
lé territoire environnant. Les services administratifs (artillerie,
commissariat, santé) relèvent immédiatement
de son autorité. Le commandant de la défense est res-
ponsable de la sécurité et de la garde de la place, en
temps de paix comme en temps de guerre : il veille au
bon entretien des approvisionnements et prête assistance
aux forces navales dans la mesure du possible, sans
toutefois diminuer en rien les défenses du point d’appui.
Il a sous ses ordres l’officier de vaisseau qui, avec le titre
de commandant de la marine, lui est adjoint spécialement
pour tout ce qui concerne les services du port, de
la rade, de l’arsenal et de la défense mobile. Toutefois;
pour cette partie du service le commandant de la marine
est en relations directes avec le ministre de la marine,
dont Îe budget supporte la partie des dépenses du point
d’appui qui a trait à l’organisation navale.
Le commandant de la défense exerce ses attributions
sous la direction du commandant supérieur des troupes
et la haute autorité du gouverneur général.
; A Diégo-Suarez, le commandement de la place eï du
territoire est actuellement confié à un colonel d’artillerie,
auquel un capitaine de frégate est adjoint pour les services
maritimes.
Division navale de l ’océan Indien. — Lors de l’envoi
à Madagascar d’une colonne expéditionnaire, les forces
navales que nous entretenions â cette époque dans
l’océan Indien furent augmentées d’unités de combat et
de transports. L’ensemble en fut placé sous les ordres
du capitaine de vaisseau Bienaimé, nommé peu de temps
après contre-amiral, qui releva du commandant en chef
du corps expéditionnaire. La marine prêta un précieux
concours pour les débarquements du personnel et du
matériel : elle appuya, par ses canonnières, sur tout le
parcours navigable des rivières, les troupes mises en
mouvement, mais sa participation militaire fut de peu
d’importance, les Hova n’ayant pas de marine et la résistance
n’ayant que fort peu intéressé les côtes.
Depuis la conquête le rôle de la marine ne s’est pas
affirmé et soii action a été plutôt en décroissance. La
nouvelle répartition de nos forces navales, ordonnée par
un décret du 27 décembre 1902, a eu principalement en vue
l’accroissement des escadres de l’Atl antique et de l’Extrême
Orient, et a presque sacrifié la division navale de
l’océan Indien, dont la valeur offensive et défensive est
très faible. Les bâtiments qui la composent sont peu
nombreux, de type ancien et de marche lente: ce sont XInfernet, croiseur de 3e classe, d’une puissance de 4 000
chevaux, la canonnière Capricorne, de 3oo chevaux et un
aviso, la Nièvre, affecté aux missions hydrographiques (').
La division, commandée par un capitaine de vaissèau,
doit donc se borner à une simple surveillance des côtes
de Madagascar, de Mozambique et de la Réunion.
On peut regretter qu’un pareil état de choses semble
se perpétuer. L’importance du point d’appui de Diégo-
Suarez mériterait, pour sa protection, qu’on plaçât à
proximité une forçe navale vraiment sérieuse.
1. La Nièvre sera prochainement remplacée par la Durance, bâtiment de
même type et de même effectif.