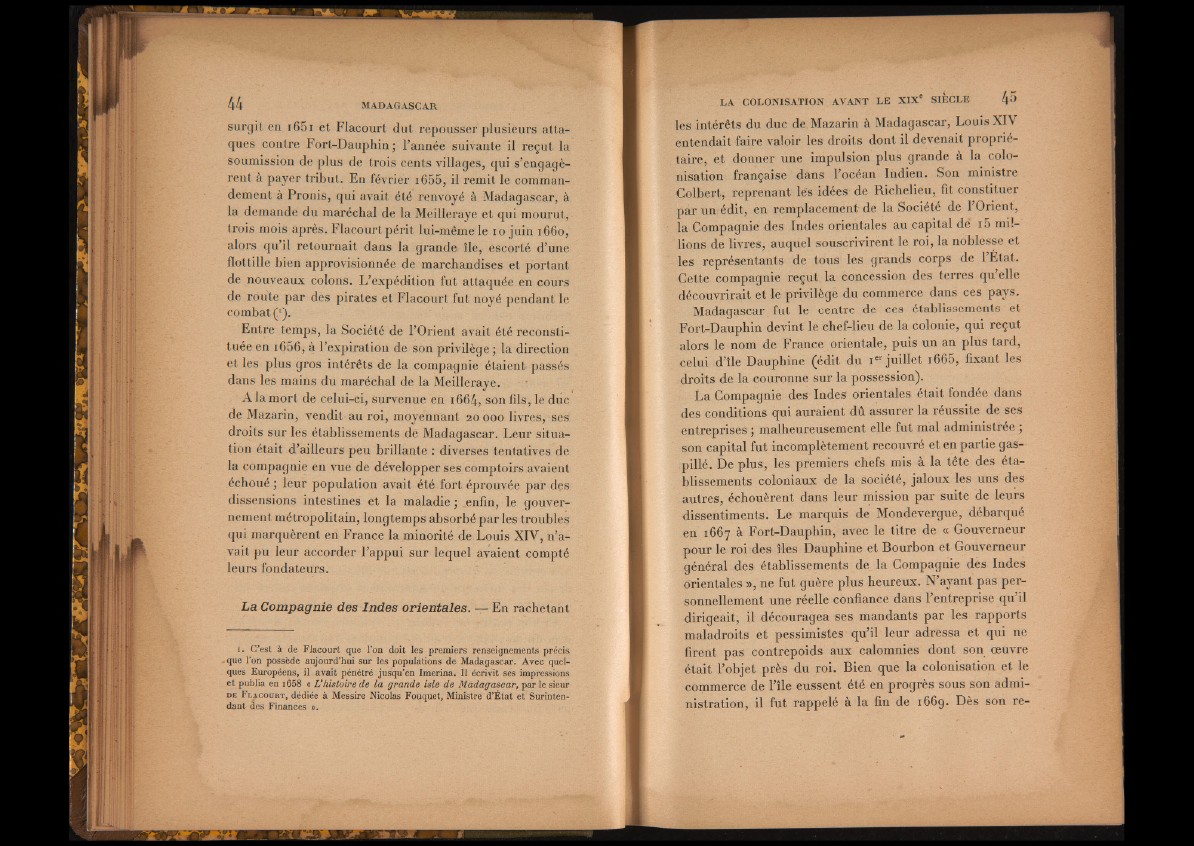
surgit en 1651 et Flacourt dut repousser plusieurs attaques
contre Fort-Dauphin; l’année suivante il reçut la
soumission de plus de trois cents villages, qui s’engagèrent
à payer tribut. En février i 655, il remit le commandement
à Pronis, qui avait été renvoyé à Madagascar, à
la demande du maréchal de la Meilleraye et qui mourut,
trois mois après. Flacourt périt lui-même le 10 juin 1660,
alors qu’il retournait dans la grande île, escorté d’une
flottille bien approvisionnée de marchandises et portant
de nouveaux colons. L’expédition fut attaquée en cours
de route par des pirates et Flacourt fut noyé pendant le
combat (').
Entre temps, la Société de l’Orient avait été reconstituée
en i 656, à l’expiration de son privilège ; la direction
et les plus gros intérêts de la compagnie étaient passés
dans les mains du maréchal de la Meilleraye.
A la mort de celui-ci, survenue en i 664, son fils, le duc
de Mazarin, vendit au roi, moyennant 20000 livres, ses
droits sur les établissements de Madagascar. Leur situation
était d’ailleurs peu brillante : diverses tentatives de
la compagnie en vue de développer ses comptoirs avaient
échoué ; leur population avait été fort éprouvée par des
dissensions intestines et la maladie ; .enfin, le gouvernement
métropolitain, longtemps absorbé parles troubles
qui marquèrent en France la minorité de Louis XIV, n’avait
pu leur accorder l’appui sur lequel avaient compté
leurs fondateurs.
La Compagnie des Indes orientales. — En rachetant
i . C’est à de Flacourt que l’on doit les premiers renseignements précis
.que l’on possède aujourd’hui sur les populations de Madagascar. Avec quelques
Européens, il avait pénétré jusqu’en Imerina. Il écrivit ses impressions
et publia en i 658 « L ’histoire de la grande isle de Madagascar, par le sieur
d e F l a c o u r t , dédiée à Messire Nicolas Fouquet, Ministre d’État et Surintendant
des Finances ».
les intérêts du duc de Mazarin à Madagascar, Louis XIV
entendait faire valoir les droits dont il devenait propriétaire,
et donner une impulsion plus grande à la colonisation
française dans l’océan Indien. Son ministre
Colbert, reprenant lés idées de Richelieu, fit constituer
par un édit, en remplacement de la Société de l’Orient,
la Compagnie des Indes orientales au capital de i 5 millions
de livres, auquel souscrivirent le roi, la noblesse et
les représentants de tous les grands corps de l’État.
Cette compagnie reçut la concession des terres qu’elle
découvrirait et le privilège du commerce dans ces pays.
Madagascar fut le centre de ces établissements et
Fort-Dauphin devint le chef-lieu de la colonie, qui reçut
alors le nom de France orientale, puis un an plus tard,
celui d’île Dauphine (édit du Ier juillet i 665, fixant les
droits de la couronne sur la possession).
La Compagnie des Indes orientales était fondée dans
des conditions qui auraient dû assurer la réussite de ses
entreprises ; malheureusement elle fut mal administrée ;
son capital fut incomplètement recouvré et en partie gaspillé.
De plus, les premiers chefs mis à la tête des établissements
coloniaux de la société, jaloux les uns des
autres, échouèrent dans leur mission par suite de leurs
dissentiments. Le marquis de Mondevergue, débarqué
en 1667 à Fort-Dauphin, avec le titre de « Gouverneur
pour le roi des îles Dauphine et Bourbon et Gouverneur
général des établissements de la Compagnie des Indes
orientales », ne fut guère plus heureux. N’ayant pas personnellement
une réelle confiance dans l’entreprise qu’il
dirigeait, il découragea ses mandants par les rapports
maladroits et pessimistes qu’il leur adressa et qui ne
firent pas contrepoids aux calomnies dont son oeuvre
était l’objet près du roi. Bien que la colonisation et le
commerce de l’île eussent été en progrès sous son administration,
il fut rappelé à la fin de 1669. Dès son re