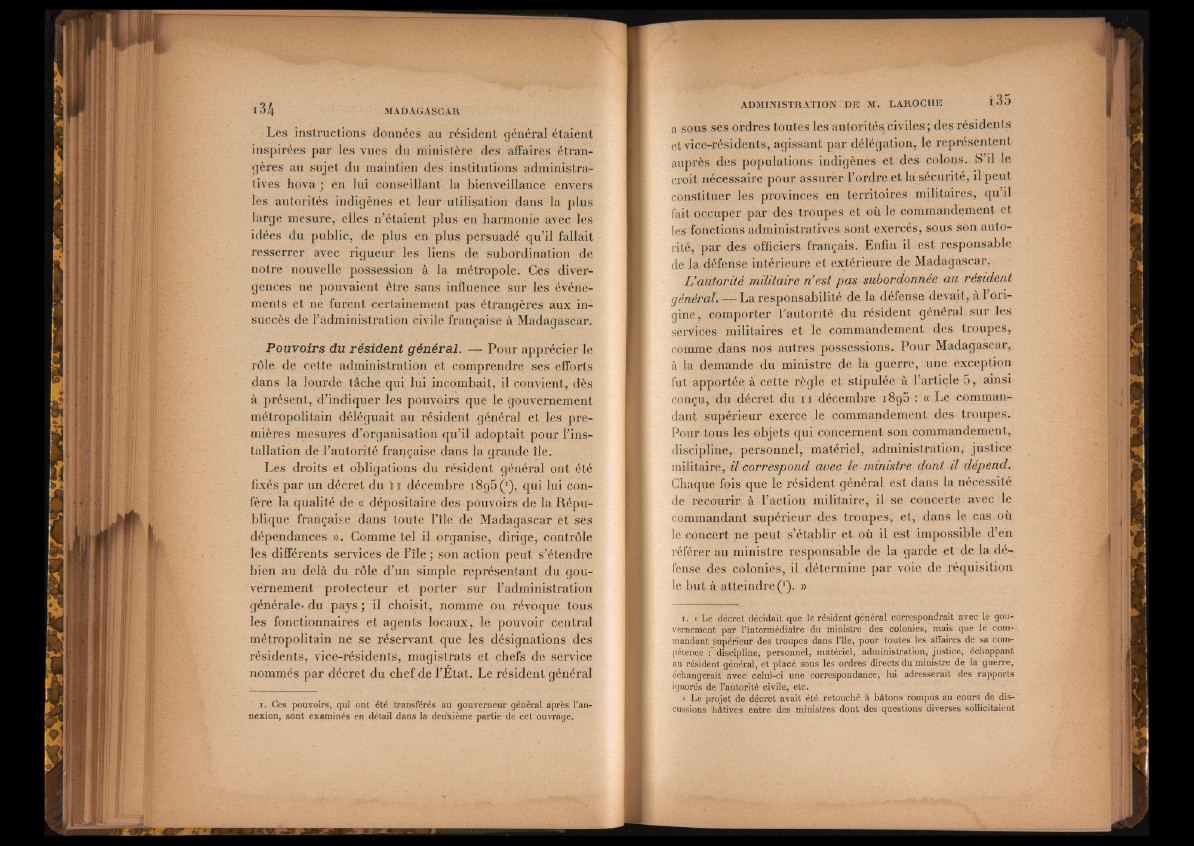
Les instructions données au résident général étaient
inspirées par les vues du ministère des affaires étrangères
au sujet du maintien des institutions administratives
hova ; en lui conseillant la bienveillance envers
les autorités indigènes et leur utilisation dans la plus
large mesure, elles n’étaient plus en harmonie avec les
idées du public, de plus en plus persuadé qu’il fallait
resserrer avec rigueur les liens de subordination de
notre nouvelle possession à la métropole. Ces divergences
ne pouvaient être sans influence sur les événements
et ne furent certainement pas étrangères aux insuccès
de l’administration civile française à Madagascar.
Pouvoirs du résident général. — Pour apprécier le
rôle de cette administration et comprendre ses efforts
dans la lourde tâche qui lui incombait, il convient, dès
à présent, d’indiquer les pouvoirs que le gouvernement
métropolitain déléguait au résident général et les premières
mesures d’organisation qu’il adoptait pour l’installation
de l’autorité française dans la grande île.
Les droits et obligations du résident général ont été
fixés par un décret du ï i décembre i 8g5 (I), qui lui confère
la qualité de « dépositaire des pouvoirs de la République
française dans toute l’île de Madagascar et ses
dépendances ». Comme tel il organise, dirige, contrôle
les différents services de l’île ; son action peut s’étendre
bien au delà du rôle d’un simple représentant du gouvernement
protecteur et porter sur l’administration
générale- du pays ; il choisit, nommé ou révoque tous
les fonctionnaires et agents locaux, le pouvoir central
métropolitain ne se réservant que les désignations des
résidents, vice-résidents, magistrats et chefs de service
nommés par décret du chef de l’Etat. Le résident général
i. Ces pouvoirs, qui ont été transférés au gouverneur général après l’annexion,
sont examinés en détail dans la deuxième partie-de cet ouvrage.
a sous ses ordres toutes les autorités civiles ; des résidents
et vice-résidents, agissant par délégation, le représentent
auprès des populations indigènes et des colons. S’il le
croit nécessaire pour assurer l’ordre et la sécurité, il peut
constituer les provinces en territoires militaires, qu’il
fait occuper par des troupes et où le commandement et
les fonctions administratives sont exercés, sous son autorité,
par des officiers français. Enfin il est responsable
de la défense intérieure et extérieure de Madagascar,
L’autorité militaire n’ est pas subordonnée au résident
général. — La responsabilité de. la défense devait, à l’origine,
comporter l’autorité du résident général sur les
services militaires et le commandement des troupes,
comme dans nos autres possessions. Pour Madagascar,
à la demande du ministre de là guerre, une exception
fut apportée à cette règle et stipulée à l’article 5 , ainsi
conçu, du décret du n décembre i 8g5 : « Le commandant
supérieur exerce le commandement des troupes-
Pour tous les objets qui concernent son commandement,
discipline,, personnel, matériel, administration, justice
militaire, il correspond avec le ministre dont il dépend.
Chaque fois que le résident général est dans la nécessité
de recourir à l’action militaire, il se concerte avec le
commandant supérieur des troupes, et, dans le cas où
le concert ne peut s’établir et. où il est impossible d’en
référer au ministre responsable de la garde et de la défense
des colonies, il détermine par voie de réquisition
le but à atteindre ('). »
i. « Le décret décidait que le résident général correspondrait avec le gouvernement
par l’intermédiaire du ministre des colonies; mais que le commandant
supérieur des troupes dans l’île, pour toutes les affaires de sa compétence
¡ discipline, personnel, matériel, administration, justice, échappant
au résident général, et placé sous les ordres directs du ministre de la guerre,
échangerait avec celui-ci une correspondance, lui adresserait des rapports
ignorés de l’autorité civile, etc.
« Le projet de décret avait été- retouché à bâtons rompus au cours de discussions
hâtives entre des ministres dont des questions diverses sollicitaient