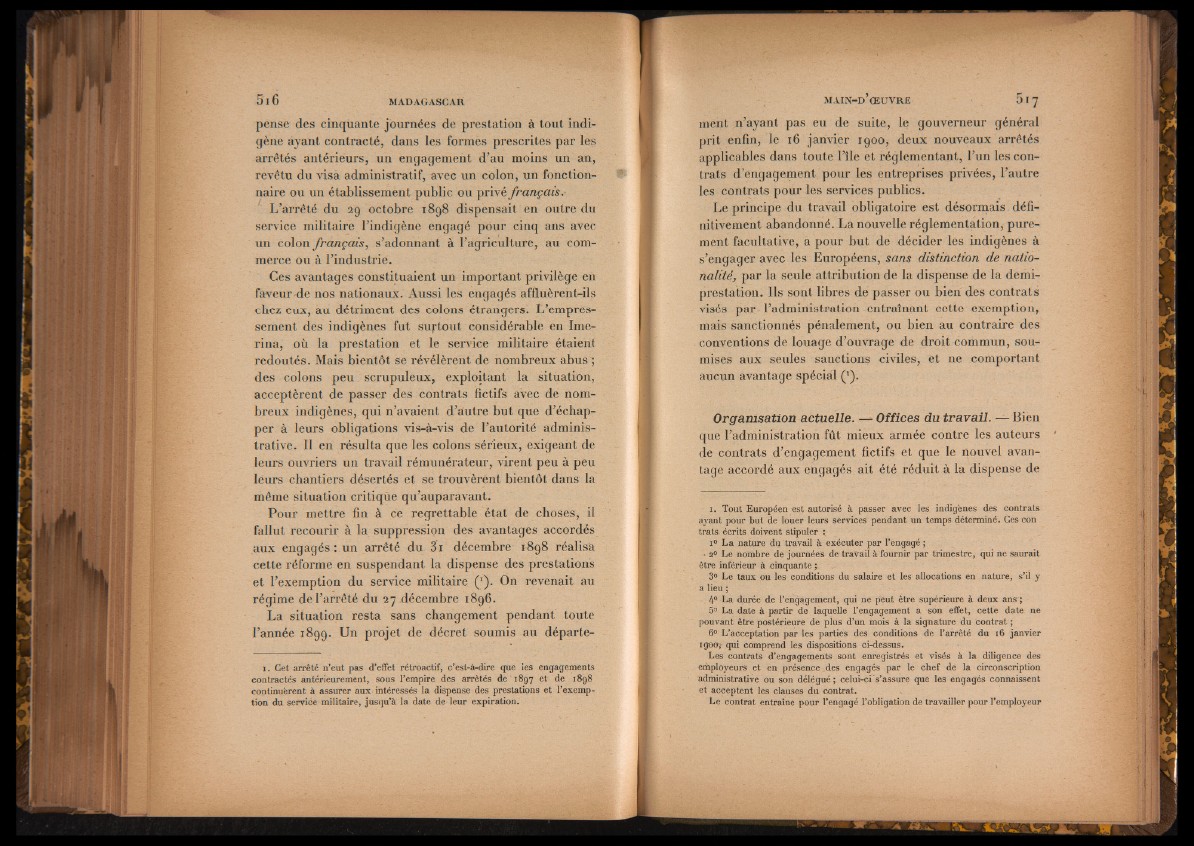
pense des cinquante journées de prestation à tout indigène
ayant contracté, dans les formes prescrites par les
arrêtés antérieurs, un engagement d’au moins un an,
revêtu du visa administratif, avec un colon, un fonctionnaire
ou un établissement public ou privé français.-
L ’arrêté du 29 octobre 1898 dispensait en outre du
service militaire l’indigène engagé pour cinq ans avec
un colon français, s’adonnant à l’agriculture, au commerce
ou à l’industrie.
Ces avantages constituaient un important privilège en
faveur de nos nationaux. Aussi les engagés affluèrent-ils
chez eux, au détriment des colons étrangers. L’empressement
des indigènes fut surtout considérable en Ime-
rina, où la prestation et le service militaire étaient
redoutés. Mais bientôt se révélèrent de nombreux abus",
des colons peu scrupuleux, exploitant la situation,
acceptèrent de passer des contrats fictifs avec de nombreux
indigènes, qui n’avaient d’âutre but que d’échapper
à leurs obligations vis-à-vis de l’autorité administrative.
Il en résulta que les colons sérieux, exigeant de
leurs ouvriers un travail rémunérateur, virent peu à peu
leurs chantiers désertés et se trouvèrent bientôt dans la
même situation critiqüe qu’auparavant.
Pour mettre fin à ce regrettable état de choses, il
fallut recourir à la suppression des avantages accordés
aux engagés : un arrêté du 3i décembre 1898 réalisa
cette réforme en suspendant la dispense des prestations
et l’exemption du service militaire (I). On revenait au
régime de l’arrêté du 27 décembre 1896.
La situation resta sans changement pendant toute
l’année 1899. Un projet de décret soumis au départe1.
Cet arrêté n’eut pas d’effet rétroactif, c’est-à-dire que les engagements
contractés antérieurement, sons l’empire des arrêtés de 1897 et de 1898
continuèrent à assurer aux intéressés la dispense des prestations et l’exemption
du service militaire, jusqu’à la date de leur expiration.
ment n’ayant pas eu de suite, le gouverneur général
prit enfin, le 16 janvier 1900, deux nouveaux arrêtés
applicables dans toute l’île et réglementant, l’un les contrats
d’engagement pour les entreprises privées, l’autre
les contrats pour les services publics.
Le principe du travail obligatoire est désormais définitivement
abandonné. La nouvelle réglementation, purement
facultative, a pour but de décider les indigènes à
s’engager avec les Européens, sans distinction de nationalité,
par la seule attribution de la dispense de la demi-
prestation. Ils sont libres de passer ou bien des contrats
visés par l’administration entraînant cette exemption,
mais sanctionnés pénalement, ou bien au contraire des
conventions de louage d’ouvrage de droit commun, soumises
aux seules sanctions civiles, et ne comportant
aucun avantage spécial (').
Organisation actuelle. — Offices du travail. — Bien
que l’administration fût mieux armée contre les auteurs
de contrats d’engagement fictifs et que le nouvel avantage
accordé aux engagés ait été réduit à la dispense de
1. Tout Européen est autorisé à passer avec les indigènes des contrats
ayant pour but de louer leurs services pendant un temps déterminé. Ces con
trats écrits doivent stipuler
i° La nature du travail à exécuter par l’engagé ;
• 20 Le nombre de journées de travail à fournir par trimestre, qui ne saurait
être inférieur à cinquante ;
3° Le taux ou les conditions du salaire et les allocations en nature, s’il y
a lieu ;
4° La durée de l’engagement, qui ne peut être supérieure à deux ans ;
5° La date à partir de laquelle l’engagement a son effet, cette date ne
pouvant être postérieure de plus d’un mois à la signature du contrat ;
6° L’acceptation par les parties des conditions de l’arrêté du 16 janvier
19007 qui comprend les dispositions ci-dessus.
Les contrats d’engagements sont enregistrés et visés à la diligence des
employeurs et en présence des engagés par le chef de la circonscription
administrative ou son délégué; celui-ci s’assure que les engagés connaissent
et acceptent les clauses du contrat.
Le contrat entraîne pour l’engagé l’obligation de travailler pour l’employeur