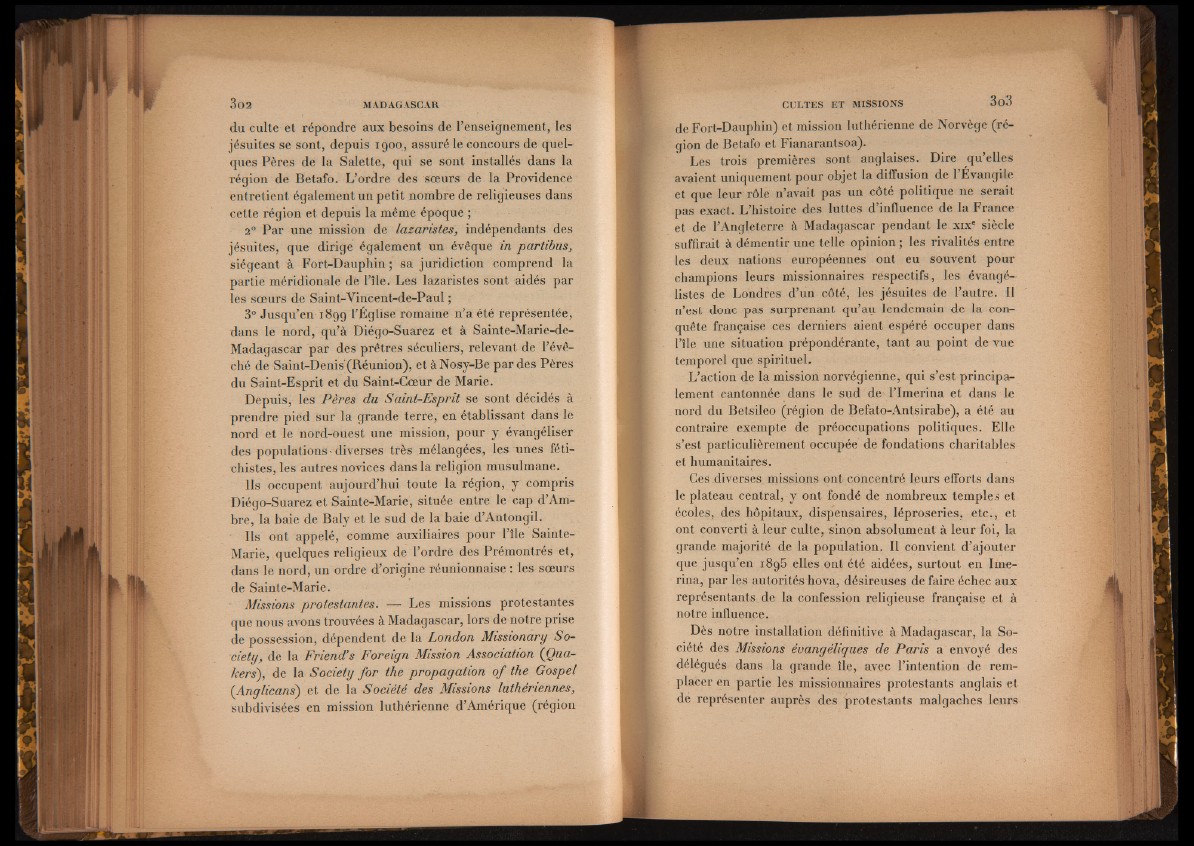
du culte et répondre aux besoins de l’enseignement, les
jésuites se sont, depuis 1900, assuré le concours de quelques
Pères de la Salette, qui se sont installés dans la
Tégion de Betafo. L’ordre des soeurs de la Providence
entretient également un petit nombre de religieuses dans
cette région et depuis la même époque ;
2° Par une mission de lazaristes, indépendants des
jésuites, que dirige également un évêque in partibus,
siégeant à Fort-Dauphin ; sa juridiction comprend la
partie méridionale de l’île. Les lazaristes sont aidés par
les soeurs de Saint-Vincent-de-Paul ;
3° Jusqu’en 1899 l’Église romaine n’a été représentée,
dans le nord, qu’à Diégo-Suarez et à Sainte-Marie-de-
Madagascar par des prêtres séculiers, relevant de l’évê-
ché de Saint-Dénis (Réunion), et à Nosy-Be par des Pères
du Saint-Esprit et du Saint-Coeur de Marie.
Depuis, les Pères du Saint-Esprit se sont décidés à
prendre pied sur la grande terre, en établissant dans le
nord et le nord-ouest une mission, pour y évangéliser
des populations - diverses très mélangées, les unes fétichistes,
les autres novices dans la religion musulmane.
Ils occupent aujourd’hui toute la région, y compris
Diégo-Suarez et Sainte-Marie, située entre le cap d’Ambre,
la baie de Baly et le sud de la baie d’Antongil,
Ils ont appelé, comme auxiliaires pour l’île Sainte-
Marié, quelques religieux de l’ordre des Prémontrés et,
dans le nord, un ordre d’origine réunionnaise : les soeurs
de Sainte-Marie.
Missions protestantes. — Les missions protestantes
que nous avons trouvées à Madagascar, lors de notre prise
de possession, dépendent de la London Missionary Society,
de la Friend’s Foreign Mission Association {Quakers),
de la Society fo r the propagation o f the Gospel
(Anglicans) et de la Société des Missions luthériennes,
subdivisées en mission luthérienne d’Amérique (région
de Fort-Dauphin) et mission luthérienne de Norvège (région
de Betafo et Fianarantsoa).
Les trois premières sont anglaises. Dire qu’elles
avaient uniquement pour objet la diffusion de l’Évangile
et que leur rôle n’avait pas un côté politique ne serait
pas exact. L’histoire des luttes d’influence de la France
et de l’Angleterre à Madagascar pendant le xixe siècle
suffirait à démentir une telle opinion ; les rivalités entre
les deux nations européennes ont eu souvent pour
champions leurs missionnaires respectifs, les évangélistes
de Londres d’un côté, les jésuites de l’autre. Il
n’est donc pas surprenant qu’au lendemain de la conquête
française ces derniers aient espéré occuper dans
l’île une situation prépondérante, tant au point de vue
temporel que spirituel.
L’action de la mission norvégienne, qui s’est principalement
cantonnée dans le sud de l’Imerina et dans le
nord du Betsileo (région de Befato-Antsirabe), a été au
contraire exempte de préoccupations politiques. Elle
s’est particulièrement occupée de fondations charitables
et humanitaires.
Ces diverses missions ont concentré leurs efforts dans
le plateau central, y ont fondé de nombreux temples et
écoles, des hôpitaux, dispensaires, léproseries, etc., et
ont converti à leur culte, sinon absolument à leur foi, la
grande majorité de la population. Il convient d’ajouter
que jusqu’en 1895 elles ont été aidées, surtout en Ime-
rina, par lès autorités hova, désireuses de faire échec aux
représentants de la confession religieuse française et à
notre influence.
Dès notre installation définitive à Madagascar, la Société
des Missions évangéliques de Paris a envoyé des
délégués dans la grande île, avec l’intention de remplacer
en partie les missionnaires protestants anglais et
de représenter auprès des protestants malgaches leurs