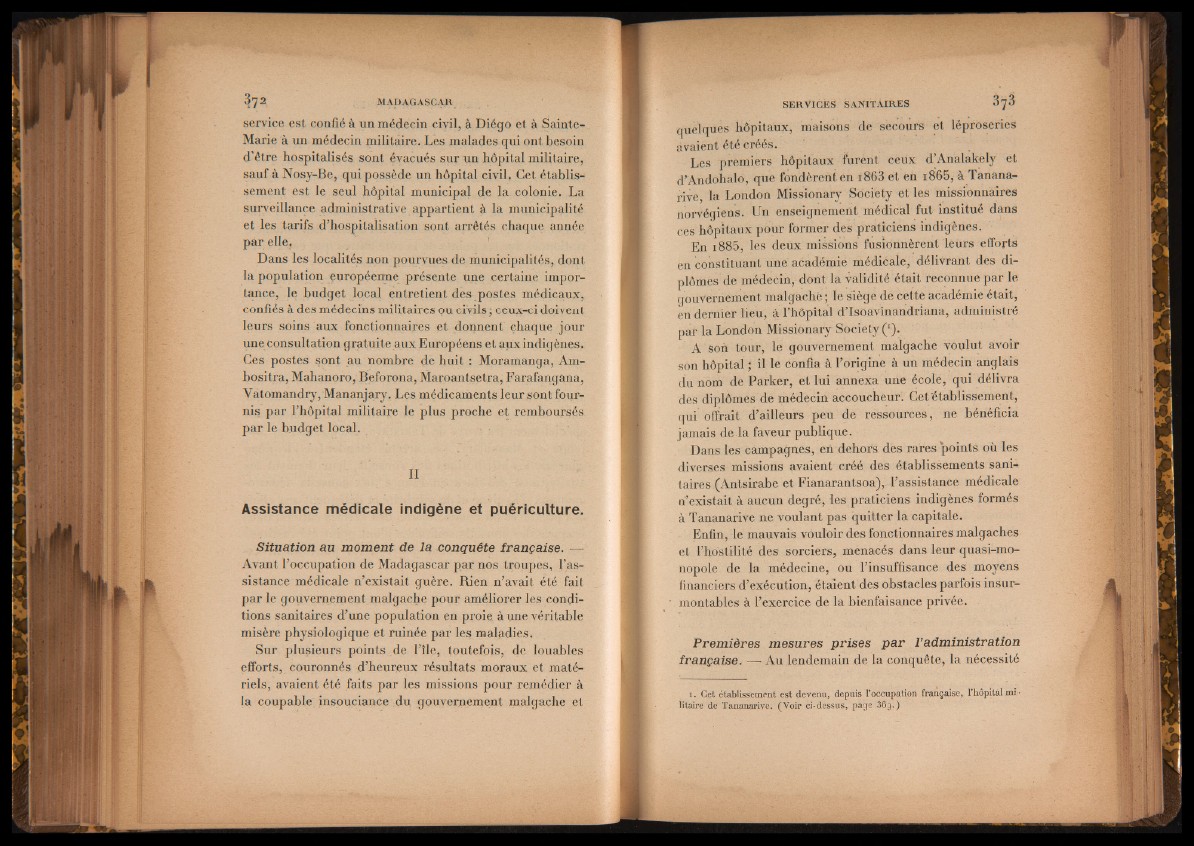
service est confié à un médecin civil, à Diégo et à Sainte-
Marie à un médecin militaire. Les malades qui ont besoin
d’être hospitalisés sont évacués sur un hôpital militaire,
sauf à Nosy-Be, qui possède un hôpital civil. Cet établissement
est le seul hôpital municipal de la colonie. La
surveillance administrative appartient à la municipalité
et les tarifs d’hospitalisation sont arrêtés chaque année
par elle,
Dans les localités non pourvues de municipalités, dont
la population européenne présente une certaine importance,
le budget local entretient des postes médicaux,
confiés à des médecins militaires ou civils ; ceux-ci doivent
leurs soins aux fonctionnaires et donnent chaque jour
une consultation gratuite aux Européens et aux indigènes.
Ces postes sont au nombre de huit : Moramanga, Am-
bositra, Mahanoro, Beforona, Maroantsetra, Farafangâna,
Yatomandry, Mananjary. Les médicaments leur sont fournis
par l’hôpital militaire le plus proche et remboursés
par le budget local.
II
Assistance médicale indigène et puériculture.
Situation au moment de la conquête française. —
Avant l’occupation de Madagascar par nos troupes, l’assistance
médicale n’existait guère. Rien n’avait été fait
par le gouvernement malgache pour améliorer les conditions
sanitaires d’une population en proie à une véritable
misère physiologique et ruinée par les maladies.
Sur plusieurs points de l’île, toutefois, de louables
efforts, couronnés d’heureux résultats moraux et matériels,
avaient été faits par les missions pour remédier à
la coupable insouciance du gouvernement malgache et
quelques hôpitaux, maisons de secours et léproseries
avaient été créés.
Les premiers hôpitaux furent ceux d’Analakely et
d’Andohalo, que fondèrent en i 863 et en i 865, à Tanana-
rive, la London Missionary Society et les missionnaires
norvégiens. Un enseignement médical fut institué dans
ces hôpitaux pour former des praticiens indigènes.
En 1885, les deux missions fusionnèrent leurs efforts
en constituant une académie médicale, délivrant des diplômes
de médecin, dont la validité était reconnue par le
gouvernement malgache ; le siège de cette académie était,
en dernier lieu, à l’hôpital d’Isoavinandriana, administré
par la London Missionary Society (').
A son tour, le gouvernement malgache voulut avoir
son hôpital ; il le confia à l’origine à un médecin anglais
du nom de Parker, et lui annexa une école, qui délivra
des diplômes de médecin accoucheur. Cet 'établissement,
qui offrait d’ailleurs peu de ressources, ne bénéficia
jamais de la faveur publique.
Dans les campagnes, en dehors des rares ‘points où les
diverses missions avaient créé des établissements sanitaires
(Antsirabe et Fianarantsoa), l’assistance médicale
n’existait à aucun degré, les praticiens indigènes formés
à Tananarive ne voulant pas quitter la capitale.
Enfin, le mauvais vouloir des fonctionnaires malgaches
et l’hostilité des sorciers, menacés dans leur quasi-monopole
de la médecine, ou l’insuffisance des moyens
financiers d’exécution, étaient des obstacles parfois insurmontables
à l’exercice de la bienfaisance privée.
P rem iè re s mesures p r ise s p a r l'administration
française. — Au lendemain de la conquête, la nécessité
i. Get établissement est devenu, depuis l’occupation française, l’hôpital mi
Htaire de Tananarive. (Voir ci-dessus, page 36g.)