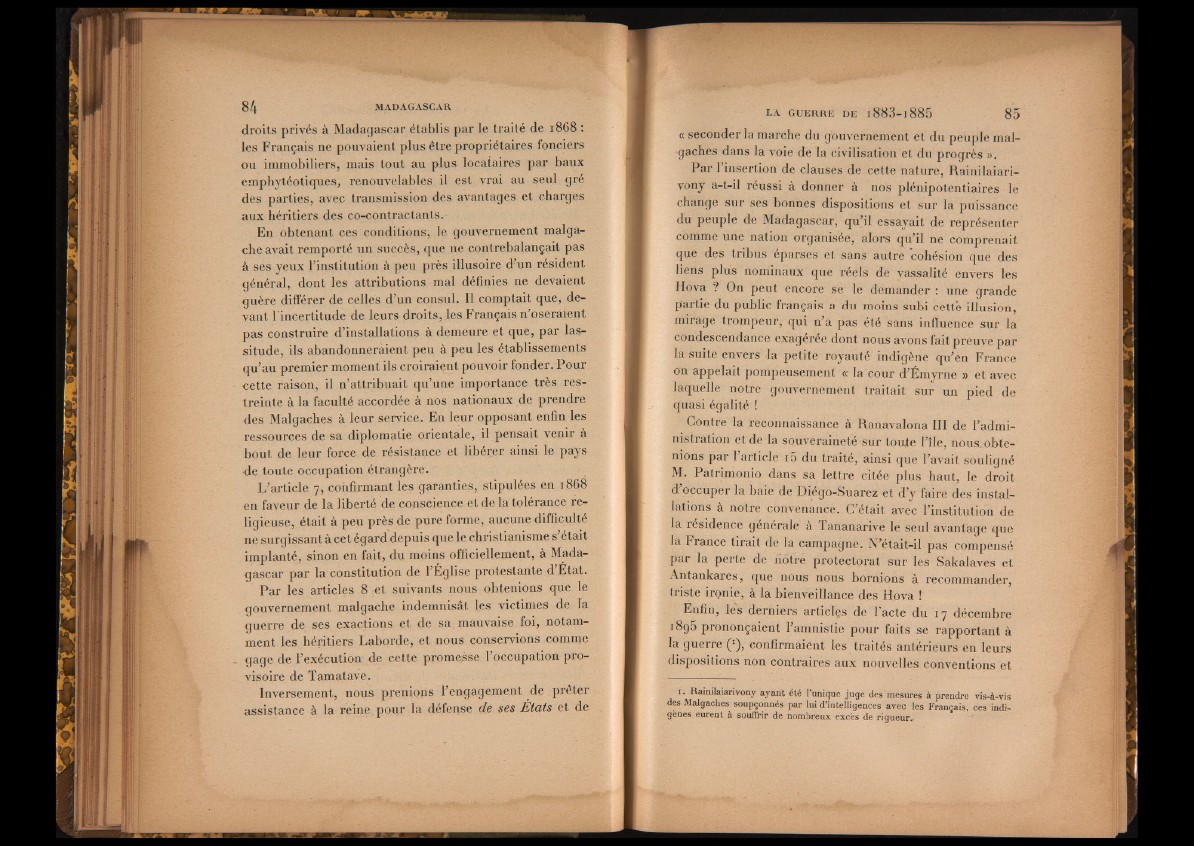
droits privés à Madagascar établis par le traité de 1868 :
les Français ne pouvaient plus être propriétaires fonciers
ou immobiliers, mais tout au plus locataires par baux
emphytéotiques, renouvelables il est vrai au seul gré
des parties, avec transmission des avantages et charges
aux héritiers des co-contractants.
En obtenant ces conditions, le gouvernement malgache
avait remporté un succès, que ne contrebalançait pas
à ses yeux l’institution à peu près illusoire d'un résident
général, dont les attributions mal définies ne devaient
guère différer de celles d’un consul. Il comptait que, devant
l'incertitude de leurs droits, les Français n’oseraient
pas construire d’installations à demeure et que, par lassitude,
ils abandonneraient peu à peu les établissements
qu’au premier moment ils croiraient pouvoir fonder. Pour
cette raison, il n’attribuait qu’une importance très restreinte
à la faculté accordée à nos nationaux de prendre
des Malgaches à leur service. En leur opposant enfin les
ressources de sa diplomatie orientale, il pensait venir a
bout de leur force de résistance et libérer ainsi le pays
de toute occupation étrangère.
L’article 7, confirmant les garanties, stipulées en 1868
en faveur de la liberté de conscience et de la tolérance religieuse,
était à peu près de pure forme, aucune difficulté
ne surgissant à cet égard depuis que le christianisme s était
implanté, sinon en fait, du moins officiellement, à Madagascar
par la constitution de l’Église protestante d’Etat.
Par les articles 8 et suivants nous obtenions que le
gouvernement malgache indemnisât les victimes de la
guerre de ses exactions et de sa; mauvaise foi, notamment
les héritiers Laborde, et nous conservions comme
gage de l’exécution de cette promesse l’occupation provisoire
de Tamatave.
Inversement, nous prenions l’engagement de prêter
assistance à la reine pour la défense de ses États et de
« seconder la marche du gouvernement et du peuple malgaches
dans la voie de la civilisation et du progrès ».
Par l’insertion de clauses de cette nature, Rainilaiari-
vony a-t-il réussi à donner à nos plénipotentiaires le
change sur ses bonnes dispositions et sur la puissance
du peuple de Madagascar, qu’il essayait de représenter
comme une nation organisée, alors qu’il ne comprenait
que des tribus éparses et sans autre cohésion que des
liens plus nominaux que réels de vassalité envers les
Hova ? On peut encore se le demander : une grande
partie du public français a du moins subi cette illusion,
mirage trompeur, qui n’a pas été sans influence sur la
condescendance exagérée dont nous avons fait preuve par
la suite envers la petite royauté indigène qu’en France
on appelait pompeusement « la cour d’Émyrne » et avec
laquelle notre gouvernement traitait sur un pied de
quasi égalité !
Contre la reconnaissance à Ranavalona III de l’administration
et de la souveraineté sur touXe l’île, nous,obtenions
par l’article i 5 du traité, ainsi que l’avait souligné
M. Patrimonio dans sa lettre citée plus haut, le droit
d’occuper la baie de Diégo-Suarez et d’y faire des installations
à notre convenance. C’était avec l’institution de
la résidence générale à Tananarive le seul avantage que
la France tirait de la campagne. N’était-il pas compensé
par la perte de notre protectorat sur les Sakalaves et
Antankares, que nous nous bornions à recommander,
triste irçnie, à la bienveillance des Hova !
Enfin, les derniers articlçs de l acté du 17 décembre
1895 prononçaient l’amnistie pour faits se rapportant à
la guerre Q , confirmaient les traités antérieurs en leurs
dispositions non contraires aux nouvelles conventions et
1. Raimlaiarivony ayant été l’unique juge des mesurés à prendre vis-à-vis
des Malgaches soupçonnés par lui d'intelligences avec les Français, ces indi-
genes eurent a souffrir de nombreux excès de rigueur.-