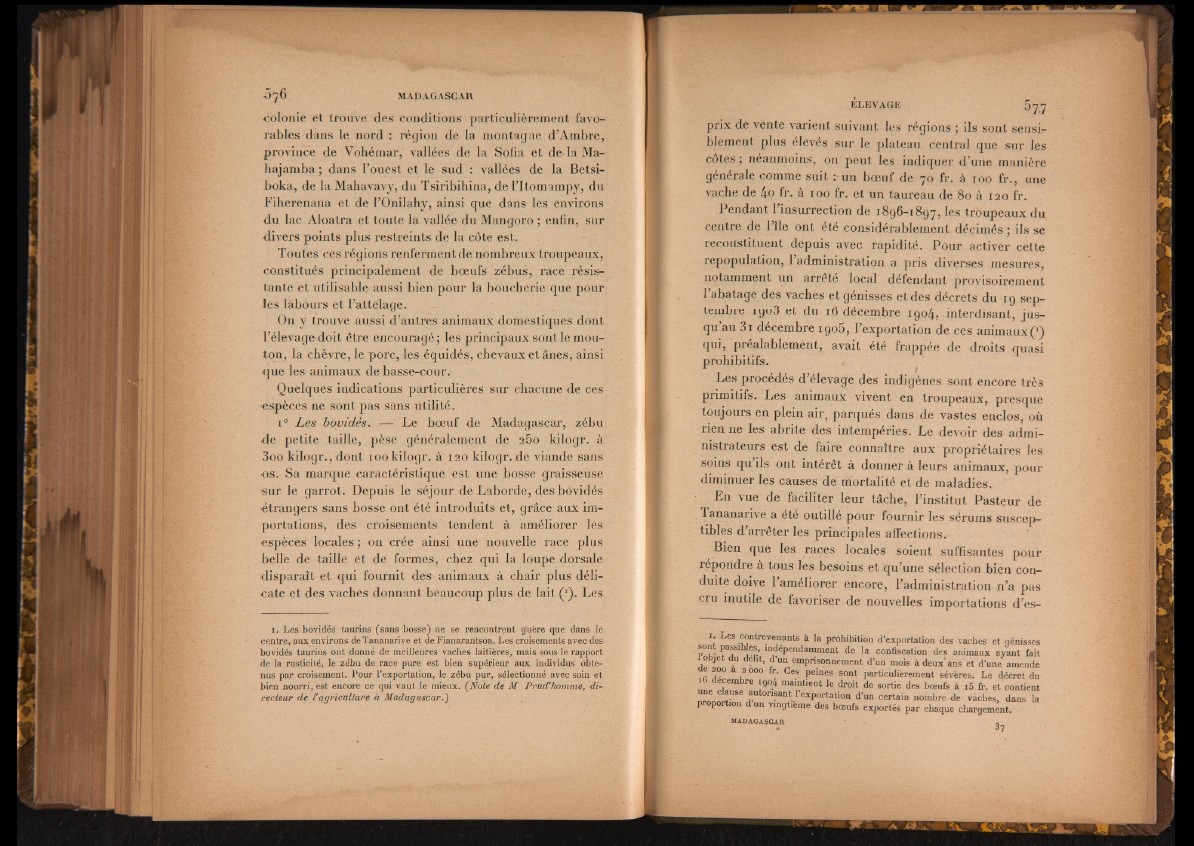
colonie et trouve des conditions particulièrement favorables
dans le nord : région de la montagne d’Ambre,
province de Vohémar, vallées de la Sofia et de la Ma-
hajamba ; dans l’ouest et le sud : vallées de la Betsi-
boka, de la Mahavavy, du Tsiribihina, de l’Itomampy, du
Fiherenana et de l’Onilahy, ainsi que dans les environs
du lac Aloatra et toute la vallée du Mangoro ; enfin, sur
■divers points plus restreints de la côte est.
Toutes ces régions renferment de nombreux troupeaux,
constitués principalement de boeufs zébus, racé résistante
et utilisable aussi bien pour la boucherie que pour
les labours et l’attelage.
On y trouve aussi d’autres animaux domestiques dont
l’élevage doit être encouragé ; les principaux sont le mouton,
la chèvre, le porc, les équidés, chevaux et ânes, ainsi
■que les animaux de basse-cour.
Quelques indications particulières sur chacune de ces
■espèces ne sont pas sans utilité.
i° Les bovidés. — Le boeuf de Madagascar, zébu
de petite taille, pèse généralement de 25o kilogr. à
3oo kilogr., dont i o o kilogr. à 1 2 0 kilogr. de viande sans
os. Sa marque caractéristique est une bosse graisseuse
sur le garrot. Depuis le séjour, de Laborde, des bovidés
•étrangers sans bosse ont été introduits et, grâce aux importations,
des croisements tendent à améliorer les
•espèces locales ; on crée ainsi une nouvelle race plus
belle de taille et de formes, chez qui la loupe dorsale
disparaît et qui fournit des animaux à chair plus délicate
et des vaches donnant beaucoup plus de lait (’). Les
1. Les. bovidés taurins (sans bosse) ne se rencontrent guère que dans le
centre, aux environs deTananarive et de Fianarantsoa. Les croisements avec des
Lovidés taurins ont donné de meilleures vaches laitières, mais sous le rapport
de la rusticité, le zébu de race pure est bien supérieur aux individus obtenus
par croisement. Pour l’exportation, le zébu pur, sélectionné avec soin et
bien nourri, est encore ce qui vaut le mieux. {Note de M Prud'homme, directeur
de 1*agriculture a Madagascar.')
prix de vente varient suivant les régions ; ils sont sensiblement
plus élevés sur le plateau central que sur les
côtes ; néanmoins, on peut les indiquer d’une manière
générale comme suit : un boeuf de 70 fr. à 100 fr., une
vache de 4o fr. à 100 fr. et un taureau de 80 à 120 fr.
Pendant l’insurrection de 1896-1897, les troupeaux du
centre de l’île ont été considérablement décimés ; ils se
reconstituent depuis avec rapidité. Pour activer cette
repopulation, l’administration a pris diverses mesures,
notamment un arrêté local défendant provisoirement
l’abatage des vaches et génisses et des décrets du 19 septembre
1903 et du 16 décembre 1904, interdisant, jusqu’au
3i décembre 1905, l’exportation de ces animaux(')
qui, préalablement, avait été frappée de droits quasi
prohibitifs.
Les procédés d’élevage des indigènes sont encore très
primitifs. Les animaux vivent en troupeaux, presque
toujours en plein air, parqués dans de vastes enclos, où
rien ne les abrite des intempéries. Le devoir des administrateurs
est de faire connaître- aux propriétaires les
soins qu ils ont intérêt à donner à leurs animaux, pour
diminuer les causes de mortalité et de maladies.
En vue de faciliter leur tâche, l’institut Pasteur de
Tananarive a été outillé pour fournir les sérums susceptibles
d’arrêter les principales affections.
Bien que les races locales soient suffisantes pour
répondre à tous les besoins et qu’une sélection bien conduite
doive l’améliorer encore, l’administration n’a pas
cru inutile de favoriser de nouvelles importations d’es1.
Les contrevenants à la prohibition d’exportation des vaches et qénisses
sont Passibles, indépendamment de la confiscation des animaux ayant fait
loojet au délit, dun emprisonnement d’un mois à deux’ ans et d’une amende
a a ° ° a u ° ° ° Ces peines SOnt particulièrement sévères. Le décret du
i !9°4 ma,,ntlent le droit de sortie des boeufs à i5 fr. et contient
une clause autorisant 1 exportation d’un certain nombre de vaches, dans la
proportion dun vingtième des boeufs exportés par chaque chargement.