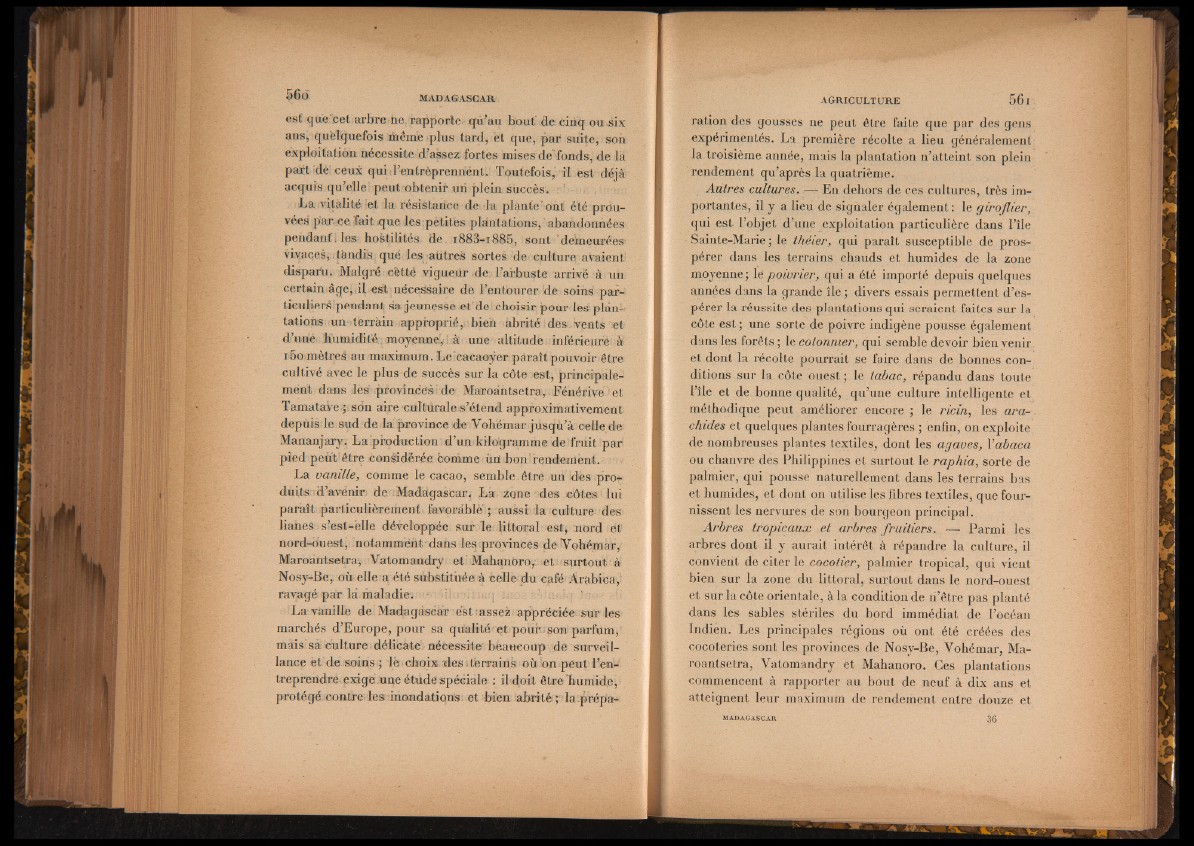
est que‘cet arbre ne. rapporte; qu’au bout de eiiiq ou six
ans, quelquefois même plus tard, et que, par suite, son
exploitation nécessite d’assez fortes mises de"1 fonds, de la
part dé ceux quiJ’enirèprennënt. Toutefois, i l est déjà
acquis qu’elle peutobtenii' un plein succès1, r
La vitalité et la résistance de la plante ont été prouvées
par ce fait que les .pétâtes plantations, abandonnées
pendant ; les hostilités de i 883-1885, sont demeurées
vivaces, d&ndis que les autres sortes de culture avaient
disparu; Malgré cette vigueur de l’arbuste arrivé à un
certain âge, il est nécessaire de l’entourer de soins particuliers
•pendant sa jeunesse et de choisir pour les plantations
un terrain approprié, bien abrité des,vents et
d’une humidité moyenne, à une altitude inférieure à
15o mètreâ au maximum. Le cacaoyer paraît pouvoir être
cultivé avec le plus de succès sur la côte est, principalement
dans les provinces? de Maroantsetra, Fénérive et
TamataVe ip son aire cultürale s’étend approximativemen t
depuis le sud de la province de Vohémar jusqu’à celle de
Mananjary. La production d ’un kilogramme de fruit par
pied peut être considérée homme uni bon rendement.
La vanille, comme le cacao, semble être un des produits
d’avenir de Madagascar. L a zone des côtes lui
paraît particulièrement favorables; aussi la culture des
lianes s’est-elle développée sur le littoral est, nord et
nord-ouest, notamment- dans les provinces de Vohémar,
Maroantsetra, Vatomandry et Mahanoro, et surtout à
Nosy-Be, où elle a été substituée à celle du café Arabica,?
ravagé par là maladie.
La vanille de.'Madagascar est;assez appréciée sur les
marchés d’Europe, pour sa qualité et pour son parfum,1
mais sa culture délicate nécessite beaucoup de surveillance
e t dé soins ; lè . choix des ; terrains où ôn peut Ten-
treprendre exige une étude spéciale : il doit être'humide,
protégé.contrer les inondations; et bien abrité ; la préparation
des gousses ne peut être faite que par des gens
expérimentés. La première récolte a lieu généralement
la troisième année, mais la plantation n’atteint son plein
rendement qu’après la quatrième.
Autres cultures. — En dehors de ces cultures, très importantes,
il y a lieu de signaler également : le giroflier,
qui est l ’objet d’une exploitation particulière dans l’île
Sainte-Marie ; le théier, qui paraît susceptible de prospérer
dans les terrains chauds et humides de la zone
moyenne ; lé poivrier, qui a été importé depuis quelques
années dans la grande île ; divers essais permettent d’espérer
la réussite des plantations qui seraient faites sur la
côte est ; une sorte de poivre indigène pousse également
dans les forêts ; le cotonnier, qui semble devoir bien venir
et dont la récolte pourrait se faire dans de bonnes conditions
sur la côte ouest ; le tabac, répandu dans toute
l’île et de bonne qualité, qu’une culture intelligente et
méthodique peut améliorer encore ; le ricin, les arachides
et quelques plantes fourragères ; enfin, on exploite
de nombreuses plantes textiles, dont les agaves, Vabaca
ou chanvre des Philippines et surtout le raphia, sorte de
palmier, qui pousse naturellement dans les te r r a in s bas
et humides, et dont on utilise les fibres textiles, que fournissent
les nervures de son bourgeon principal.
Arbres tropicaux et arbres fruitiers. — Parmi les
arbres dont il y aurait intérêt à répandre la culture, il
convient de citer le cocotier, palmier tropical, qui vient
bien sur la zone du littoral, surtout dans le nord-ouest
et sur la côte orientale, à la condition de n’être pas planté
dans les sables stériles du bord immédiat de l’océan
Indien. Les principales régions où ont été créées des
cocoteries sont les provinces de Nosy-Be, Vohémar, Maroantsetra,
Yatomandry et Mahanoro. Ces plantations
commencent à rapporter au bout de neuf à dix ans et
atteignent leur maximum de rendement entre douze et