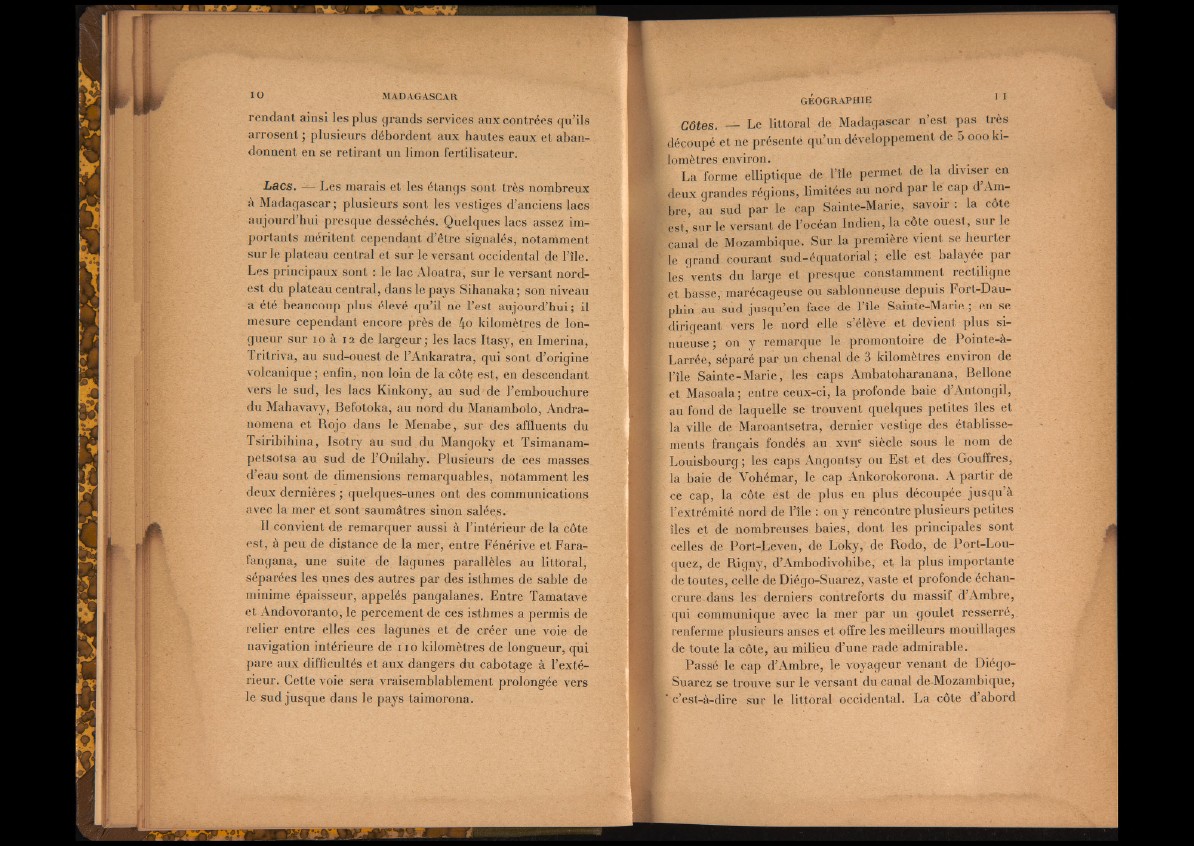
rendant ainsi les plus grands services aux contrées gu’ils
arrosent ; plusieurs débordent aux hautes eaux et abandonnent
en se retirant un limon fertilisateur.
Lacs. Les murais et les étangs sont très nombreux
à Madagascar ; plusieurs sont les vestiges d’anciens lacs
aujourd’hui presque desséchés. Quelques lacs assez importants
méritent cependant d’être signalés, notamment
sur le plateau central et sur le versant occidental de l’île.
Les principaux sont : le lac Aloatra, sur le versant nord-
est du plateau central, dans le pays Sihanaka; son niveau
a été beaucoup plus élevé qu’il ne l’est aujourd’hui; il
mesure cependant encore près de /j.o kilomètres de longueur
sur 10 à 12 de largeur; les lacs Itasy, en Imerina,
Tritriva, au sud-ouest de l’Arikaratra, qui sont d’origine
volcanique ; enfin, non loin de la côtç est, en descendant
vers le sud, les lacs Kinkony, au sud de l’embouchure
du Mahavavy, Befotoka, au nord du Manambolo, Andra-
nomena et Rojo dans le Menabe, sur des affluents du
Tsiribihina, Isotry au sud du Mangoky et Tsimanam-
petsotsa au sud de l’Onilahy. Plusieurs de ces masses
d’eau sont de dimensions remarquables, notamment les
deux dernières ; quelques-unes ont des communications
avec la mer et sont saumâtres sinon salées.
Il convient de remarquer aussi à l’intérieur de la côte
est, à peu de distance de la mer, entré Fénérive et Fara-
fangana, une suite de lagunes parallèles au littoral,
séparées les unes des autres par des isthmes de sable de
minime épaisseur, appelés pangalanes. Entre Tamatave
et Andovoranto, le percement de ces isthmes a permis de
relier entre elles ces lagunes et de créer une voie de
navigation intérieure de H o kilomètres de longueur, qui
pare aux difficultés et aux dangers du cabotage à l’extérieur.
Cette voie sera vraisemblablement prolongée vers
le sud jusque dans le pays taimorona.
Côtes. — Le littoral de Madagascar n’est pas très
découpé et ne présenté qu’un développement de 5 ooo kilomètres
environ.
La forme elliptique de l’île permet de la diviser en
deux grandes régions, limitées au nord par le cap d Ambre,
au sud par le cap Sainte-Marie, savoir : la côte
est, sur le versant de l’océan Indien, la côte ouest, sur le
canal de Mozambique. Sur la première vient se heurter
le grand courant sud-équatorial ; elle est balayée par
les vents du large et presque constamment rectiligne
et basse, marécageuse ou sablonneuse depuis Fort-Dauphin
au sud jusqu’en face de l’île Sainte-Marie ; en se
dirigeant vers le nord elle s’élève et devient plus sinueuse;
on y remarque le promontoire de Pointe-à-
Larrée, séparé par un chenal de 3 kilomètres environ de
l’île Sainte-Marie, les caps Ambatoharanana, Bellone
et Masoala; entre ceux-ci, la profonde baie d’Antongil,
au fond de laquelle se trouvent quelques petites îles et
la ville de Maroantsetra, dernier vestige des établissements
français fondés au xvne siècle sous le nom de
Louisbourg ; les caps Angontsy ou Est et des Gouffres,
la baie de Yohémar, le cap Ankorokorona. A partir de
ce cap, la côte èst de plus en plus découpée jusqu’à
l’extrémité nord de l’île : on y rencontre plusieurs petites
îles et de nombreuses baies, dont les principales sont
celles de Port-Leven, de Loky, de Rodo, de Port-Lou-
quez, de Rigny, d’Ambodivohibe, et la plus importante
de toutes, celle de Diégo-Suarez, vaste et profonde échancrure
dans les derniers contreforts du massif d’Ambre,
qui communique avec la mer par un goulet resserré,
renferme plusieurs anses et offre les meilleurs mouillages
de toute la côte, au milieu d’une rade admirable.
Passé le cap d’Ambre, le voyageur venant de Diégo-
Suarez se trouve sur le versant du canal de-Mozambique,
:* c’est-à-dire sur le littoral occidental. La côte d’abord