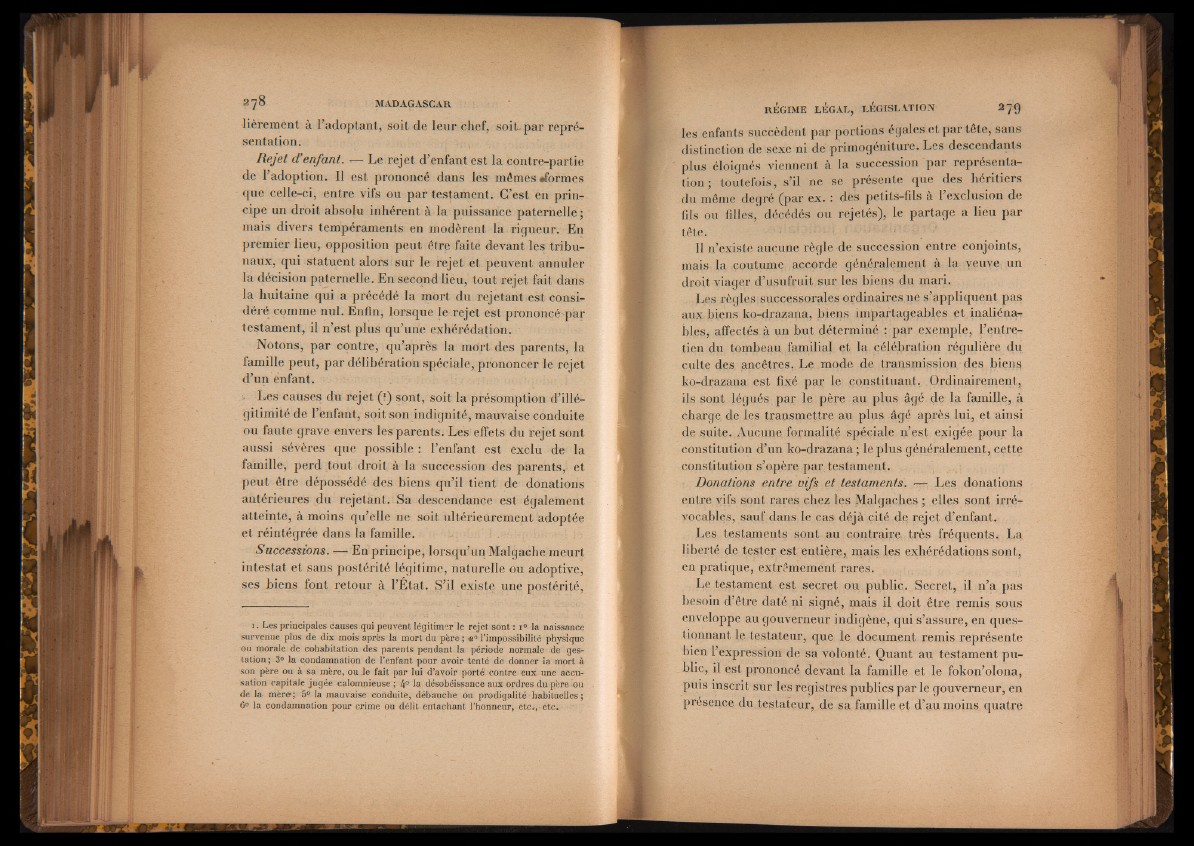
lièrement à l’adoptant, soit de leur chef, soit-par représentation.
Rejet d’ enfant. -— Le rejet d’enfant est la contre-partie
de l’adoption. Il est prononcé dans les mêmes «formes
que celle-ci, entre vifs ou par testament. C’est en principe
un droit absolu inhérent à la puissance paternelle ;
mais divers tempéraments en modèrent la rigueur. En
premier lieu, opposition peut être faite devant les tribunaux,
qui statuent alors sur le rejet et peuvent annuler
la décision paternelle. En second lieu, tout rejet fait dans
la huitaine qui a précédé la mort du rejetant est considéré
comme nul. Enfin, lorsque le rejet est prononcépar
testament, il n’est plus qu’une exhérédation.
Notons, par contre, qu’après la mort des parents, la
famille peut, par délibération spéciale, prononcer le rejet
d’un enfant.
Les causes du rejet (?) sont, soit la présomption d’illégitimité
de l’enfant, soit son indignité, mauvaise conduite
ou faute grave envers les parents. Les effets du rejet sont
aussi sévères que possible : l’enfant est exclu de la
famille, perd tout droit à la succession des parents, et
peut être dépossédé des biens qu’il tient de donations
antérieures du rejetant. Sa descendance est également
atteinte, à moins qu’elle ne soit ultérieurement adoptée
et réintégrée dans la famille.
Successions. — En principe, lorsqu’un Malgache meurt
intestat et sans postérité légitime, naturelle ou adoptive,
ses biens font retour à l’État. S’il existe une postérité,
1. Les principales causes qui peuvent légitimer le rejet sont : i° la naissance
survenue plus de dix mois après la mort du père ; «° l’impossibilité physique
ou morale de cohabitation des parents pendant la période normale de gestation;
3° la condamnation de l ’enfant pour avoir tenté de donner la mort à
son père ou à sa mère, ou le fait par lui d’avoir porté contre eux une accusation
capitale jugée calomnieuse ; 4° la désobéissance aux ordres du père au
de la mère; 5° la mauvaise conduite, débauche ou prodigalité habituelles;
6° la condamnation pour crime ou délit entachant l’honneur, etc., etc.
les enfants succèdent par portions égales et par tête, sans
distinction de sexe ni de primogéniture. Les descendants
plus éloignés viennent à la succession par représentation;
toutefois, s’il ne se présente que des héritiers
du même degré (par ex. : des petits-fils à 1 exclusion de
fils ou filles, décédés ou rejetés), le partage a lieu par
tête.
Il n’existe aucune règle de succession entre conjoints,
mais la coutume accorde généralement à la yeuve un
droit viager d’usufruit sur les biens du mari.
Les règles successorales ordinaires 11e s’appliquent pas
aux biens ko-drazana, biens impartageables et inaliéna-:
blés, affectés à un but déterminé ; par exemple, l’entretien
du tombeau familial et la célébration régulière du
culte des ancêtres. Le mode de transmission des biens
ko-drazana est fixé par le constituant. Ordinairement,
ils sont légués par le père au plus âgé de la famille, à
charge de les transmettre au plus âgé après lui, et ainsi
de suite. Aucune formalité spéciale n’est exigée pour la
constitution d’un ko-drazana; le plus généralement, cette
constitution s’opère par. testament.
Donations entre vifs et testaments. — Les donations
entre vifs sont rares chez les Malgaches ; elles sont irrévocables,
sauf dans le cas déjà cité de rejet d’enfant.
Les testaments sont au contraire très fréquents. La
liberté de tester est entière, mais les exhérédations sont,
en pratique, extrêmement rares.
Le testament est secret ou public. Secret, il n’a pas
besoin d’être daté ni signé, mais il doit être remis sous
enveloppe au gouverneur indigène, qui s’assure, en questionnant
le testateur, que le document remis représente
bien l’expression de sa volonté. Quant au testament public,
il est prononcé devant la famille et le fokon’olona,
puis inscrit sur les registres publics par le gouverneur, en
présence du testateur, de sa famille et d’au moins quatre