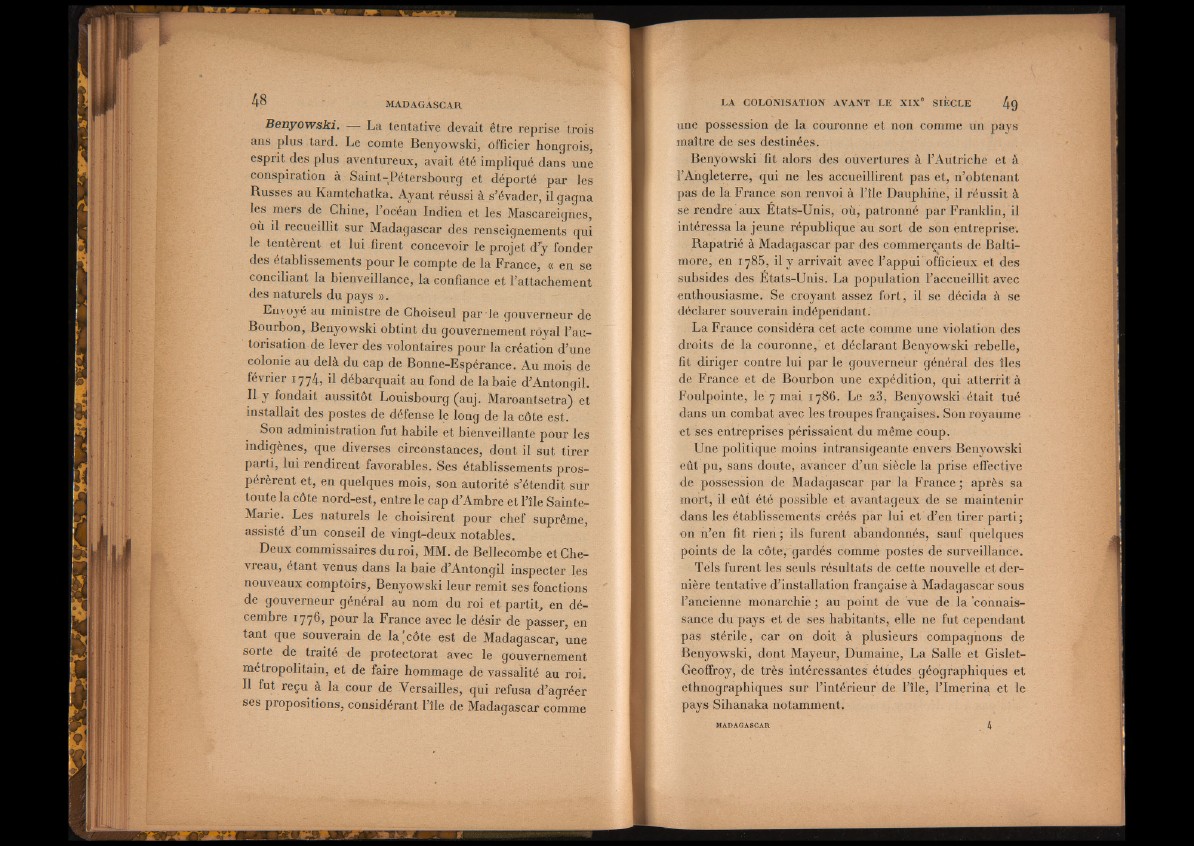
Benyowski. — La tentative devait être reprise trois
ans plus tard. Le comte Benyowski, officier hongrois,
esprit des plus aventureux, avait été impliqué dans une
conspiration à Saint-Pétersbourg et déporté par les
Russes au Kamtchatka. Ayant réussi à s’évader, il gagna
les mers de Chine, 1 océan Indien et les Mascareignes,
où il recueillit sur Madagascar des renseignements qui
le tentèrent et lui firent concevoir le projet d’y fonder
des établissements pour le compte de la France, « en se
conciliant la bienveillance, la confiance et l’attachemént
des naturels du pays ».
Envoyé au ministre de Ghoiseul par de gouverneur de
Bourbon, Benyowski obtint du gouvernement royal l’autorisation
de lever des volontaires pour la création d’une
colonie au delà du cap de Bonne-Espérance. Au mois de
février 1774, il débarquait au fond de la baie d’Antongil.
Il y fondait aussitôt Louisbourg (auj. Maroantsetra) et
installait des postes de défense le long de la côte est.
Son administration fut habile et bienveillante pour les
indigènes, que diverses circonstances, dont il sut tirer
parti, lui rendirent favorables. Ses établissements prospérèrent
et, en quelques mois, son autorité s’étendit sur
toute la côte nord-est, entre le cap d’Ambre et l’île Sainte-
Marie. Les naturels le choisirent pour chef suprême,
assisté d un conseil de vingt-deux notables.
Deux commissaires du roi, MM. de Bellecombe et Chevreau,
étant venus dans la baie d’Antongil inspecter les
nouveaux comptoirs, Benyowski leur remit ses fonctions
de gouverneur général au nom du roi et partit, en décembre
1776, pour la France avec le désir de passer, en
tant que souverain de la ; côte est de Madagascar, une
sorte de traité de protectorat avec le gouvernement
métropolitain, et de faire hommage de vassalité au roi.
Il fut reçu à la cour de Versailles, qui refusa d’agréer
ses propositions, considérant l’île de Madagascar comme
une possession de la couronne et non comme un pays
maître de ses destinées.
Benyowski fit alors des ouvertures à l’Autriche et à
l’Angleterre, qui ne les accueillirent pas et, n’obtenant
pas de la France son renvoi à l’île Dauphine, il réussit à
sè rendre aux États-Unis, où, patronné par Franklin, il
intéressa la jeune république au sort de son entreprise'.
Rapatrié à Madagascar par des commerçants de Baltimore,
en 1 7 8 5 , il y arrivait avec l’appui officieux et des
subsides des États-Unis. La population l’accueillit avec
enthousiasme. Se croyant assez fort, il se décida à se
déclarer souverain indépendant.
La France considéra cet acte comme une violation des
droits de la couronne, et déclarant Benyowski rebelle,
fit diriger contre lui par le gouverneur général des îles
de France et de Bourbon une expédition, qui atterrit à
Foulpointe, le 7 mai 1786. Le 28, Benyowski était tué
dans un combat avec les troupes françaises. Son royaume
et ses entreprises périssaient du même coup.
Une politique moins intransigeante envers Benyowski
eût pu, sans doute, avancer d’un siècle la prise effective
de possession de Madagascar par la France ; après sa
mort, il eût été possible et avantageux de se maintenir
dans les établissements créés par lui et d’en tirer parti;
on n’en fit rien ; ils furent abandonnés, sauf quelques
points de la côte, gardés comme postes de surveillance.
Tels furent les seuls résultats de cette nouvelle et dernière
tentative d’installation française à Madagascar sous
l’ancienne monarchie ; au point de vue de la connaissance
du pays et de ses habitants, elle ne fut cependant
pas stérile, car on doit à plusieurs compagnons de
Benyowski, dont Mayeur, Dumaine, La Salle et Gislet-
Geoffroy, de très intéressantes études géographiques et
ethnographiques sur l’intérieur de l’île, l’ Imerina et le
pays Sihanaka notamment.