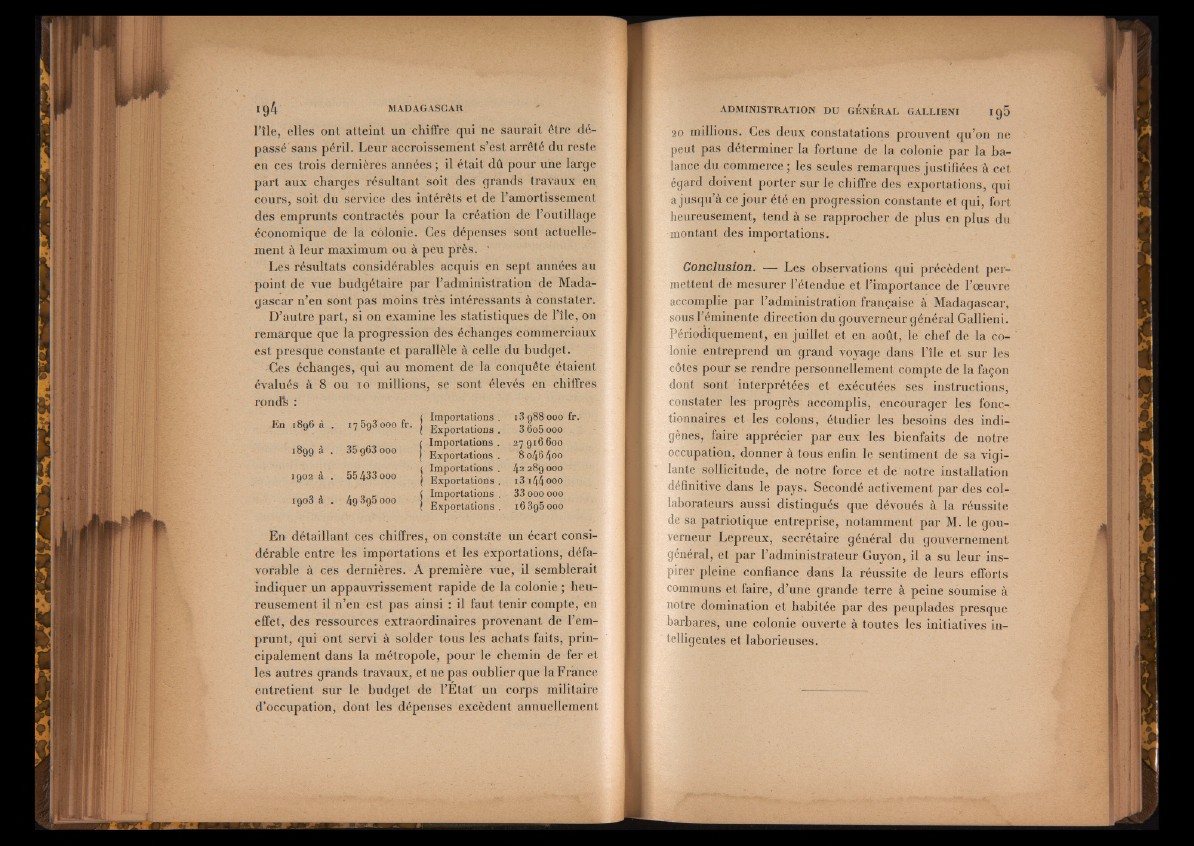
l’île, elles ont atteint un chiffre qui ne saurait être dépassé
sans péril. Leur accroissement s’est arrêté du reste
en ces trois dernières années ; il était dû pour une large
part aux charges résultant soit des grands travaux en,
cours, soit du service des intérêts et de l’amortissement
des emprunts contractés pour la création de l’outillage
économique de la colonie. Ces dépenses sont actuellement
à leur maximum ou à peu près. v
Les résultats considérables acquis en sept années au
point de vue budgétaire par l’administration de Madagascar
n’en sont pas moins très intéressants à constater.
D’autre part, si on examine les statistiques de l’île, on
remarque que la progression des échanges commerciaux
est presque constante et parallèle à celle du budget.
Ces échanges, qui au moment de la conquête étaient
évalués à 8 ou 10 millions, se sont élevés en chiffres
rond*s :
En 1896 à
1899 à
1902 à
igo3 à
17 5g3 000 fr.
35 g63 000
55 433 000
49 3g5 000
Importations .
Exportations .
Importations .
Exportations .
Importations .
Exportations .
( Importations .
( Exportations .
i 3 988 000 fr.
3 6o5 000
27 916 600
8 046 4oo
42 289 000
i3 i44ooo
33 000 000
16395 000
En détaillant ces chiffres, on constate un écart considérable
entre les importations et les exportations, défavorable
à ces dernières. A première vue, il semblerait
indiquer un appauvrissement rapide de la colonie ; heureusement
il n’en est pas ainsi : il faut tenir compte, en
effet, des ressources extraordinaires provenant de l’emprunt,
qui ont servi à solder tous les achats faits, principalement
dans la métropole, pour le chemin de fer et
les autres grands travaux, et ne pas oublier que la France
entretient sur le budget de l’État un corps militaire
d’occupation, dont les dépenses excèdent annuellement
20 millions. Ces deux constatations prouvent qu’on ne
peut pas déterminer la fortune de la colonie par la balance
du commerce ; les seules remarques justifiées à cet
égard doivent porter sur le chiffre des exportations, qui
a jusqu’à ce jour été en progression constante et qui, fort
heureusement, tend à se rapprocher de plus en plus du
montant des importations.
Conclusion. — Les observations qui précèdent permettent
de mesurer l’étendue et l’importance de l’oeuvre
accomplie par l’administration française à Madagascar,
sous l’éminente direction du gouverneur général Gallieni.
Périodiquement, en juillet et en août, le chef de la colonie
entreprend ün grand voyage dans l’île et sur les
côtes pour se rendre personnellement compte de la façon
dont sont interprétées et exécutées ses instructions,
constater les progrès accomplis, encourager les fonctionnaires
et les colons, étudier les besoins des indigènes,
faire apprécier par eux les bienfaits de notre
occupation, donner à tous enfin le sentiment de sa vigilante
sollicitude, de notre force et de notre installation
définitive dans le pays. Secondé activement par des collaborateurs
aussi distingués que dévoués à la réussite
de sa patriotique entreprise, notamment par M. le gouverneur
Lépreux, secrétaire général du gouvernement
général, et par l’administrateur Guyon, il a su leur inspirer
pleine confiance dans la réussite de leurs efforts
communs et faire, d’une grande terre à peine soumise à
notre domination et habitée par des peuplades presque
barbares, une colonie ouverte à toutes les initiatives intelligentes
et laborieuses.