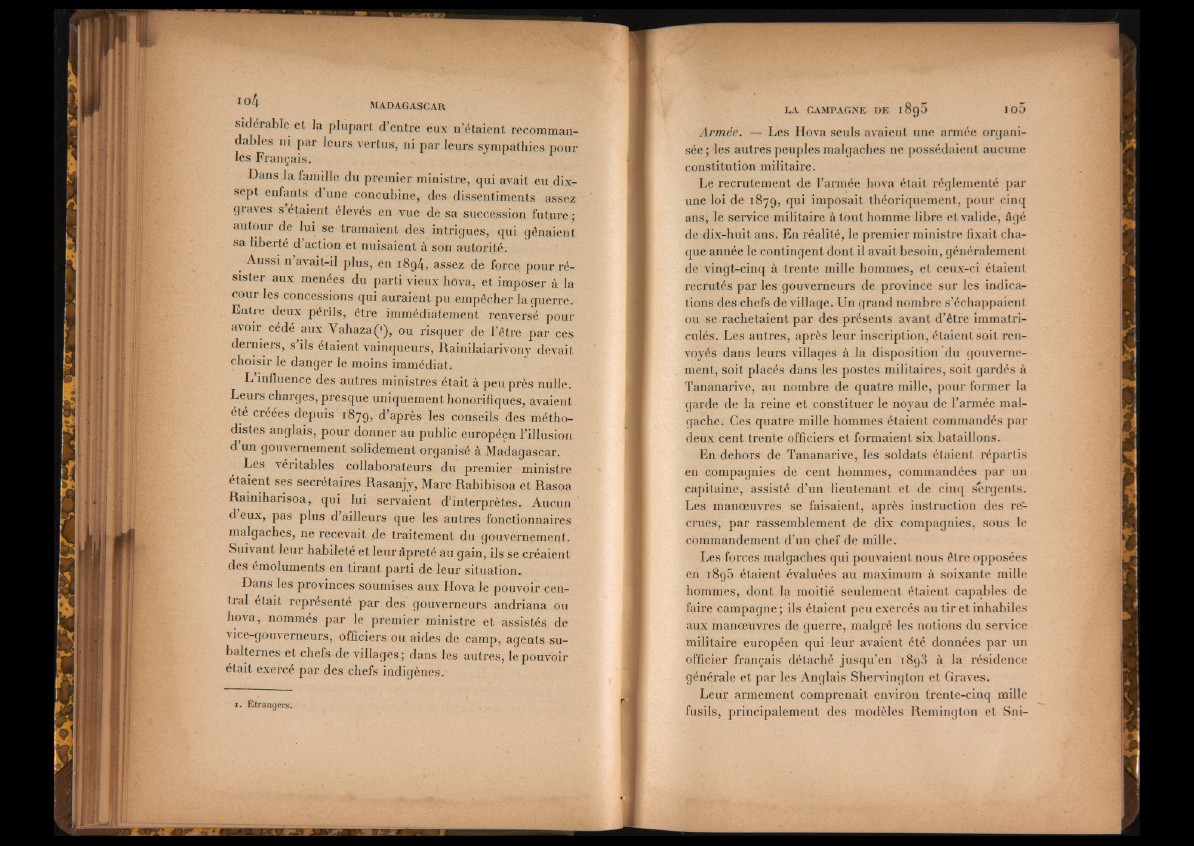
sidérable et la plupart d’entre eux n’étaient recomman-
dables ni par leurs vertus, ni par leurs sympathies pour
les Français.
Dans la famille du premier ministre, qui avait eu dix-
sept enfants d’une concubine, des dissentiments assez
qraves s étaient élevés en vue de sa succession future ;
autour de lui se tramaient des intrigues, qui gênaient
sa liberté d’action et nuisaient à son autorité.
Aussi n avait-il plus, en 1894, assez de force pour résister
aux menées du parti vieux hôva, et imposer à la
cour les concessions qui auraient pu empêcher la guerre.
Entre deux périls, être immédiatement renversé pour
avoir cédé aux Yahaza('), ou risquer de l’être par ces
derniers, s’ils étaient vainqueurs, Rainilaiarivony devait
choisir le danger le moins immédiat.
L influence des autres ministres était à peu près nulle.
Leurs charges, presque uniquement honorifiques, avaient
été créées depuis 1879, d’après les conseils des méthodistes
anglais, pour donner au public européen l’illusion
d un gouvernement solidement organisé à Madagascar.
Les véritables collaborateurs du premier ministre
étaient ses secrétaires Rasanjy, Marc Rabibisoa et Rasoa
Rainiharisoa, qui lui servaient d’interprètes. Aucun
deux, pas plus d’ailleurs que les autres fonctionnaires
malgaches, ne recevait de traitement du gouvernement.
Suivant leur habileté et leur âpreté au gain, ils se créaient
des émoluments en tirant parti de leur situation.
Dans les provinces soumises aux Hova le pouvoir central
était representé par des gouverneurs andriana ou
hova, nommés par le premier ministre et assistés de
vice-gouverneurs, officiers ou aides de camp, agents subalternes
et chefs de villages; dans les autres, le pouvoir
était exercé par des chefs indigènes.
x. Étrangers.
Armée. — Les Hova seuls avaient une armée organisée
; les autres peuples malgaches ne possédaient aucune
constitution militaire.
Le recrutement de l’armée hova était réglementé par
une loi de 1879, qui imposait théoriquement, pour cinq
anSj le service militaire à tout homme libre et valide, âgé
de dix-huit ans. En réalité, le premier ministre fixait chaque
année le contingent dont il avait besoin, généralement
de vingt-cinq à trente mille hommes, et ceux-ci étaient
recrutés par les gouverneurs de province sur les indications
des chefs de village. Un grand nombre s’échappaient
ou se rachetaient par des présents avant d’être immatriculés.
Les autres, après leur inscription, étaient soit renvoyés
dans leurs villages à,la disposition du gouvernement,
soit placés dans les postes militaires, soit gardés à
Tananarive, au nombre de quatrè mille, pour former la
garde de la reine et constituer le noyau de l’armée malgache.
Ces quatre mille hommes étaient commandés par
deux cent trente officiers et formaient six bataillons.
En dehors de Tananarive, les soldats étaient répartis
en compagnies de cent hommes, commandées par un
capitaine, assisté d’un lieutenant et de cinq sergents.
Les manoeuvres se faisaient, après instruction des recrues,
par rassemblement de dix compagnies, sous le
commandement d’un chef de mille.
Les forces malgaches qui pouvaient nous être opposées
en 1895 étaient évaluées au maximum à soixante mille
hommes, dont la moitié seulement étaient capables de
faire campagne; ils étaient peu exercés au tir et inhabiles
aux manoeuvres de guerre, malgré les notions du service
militaire européen qui leur avaient été données par un
officier français détaché jusqu’en i 8g3 à la résidence
générale et par les Anglais Shervington et Graves.
Leur armement comprenait environ trente-cinq mille
fusils, principalement des modèles Remington et Sni