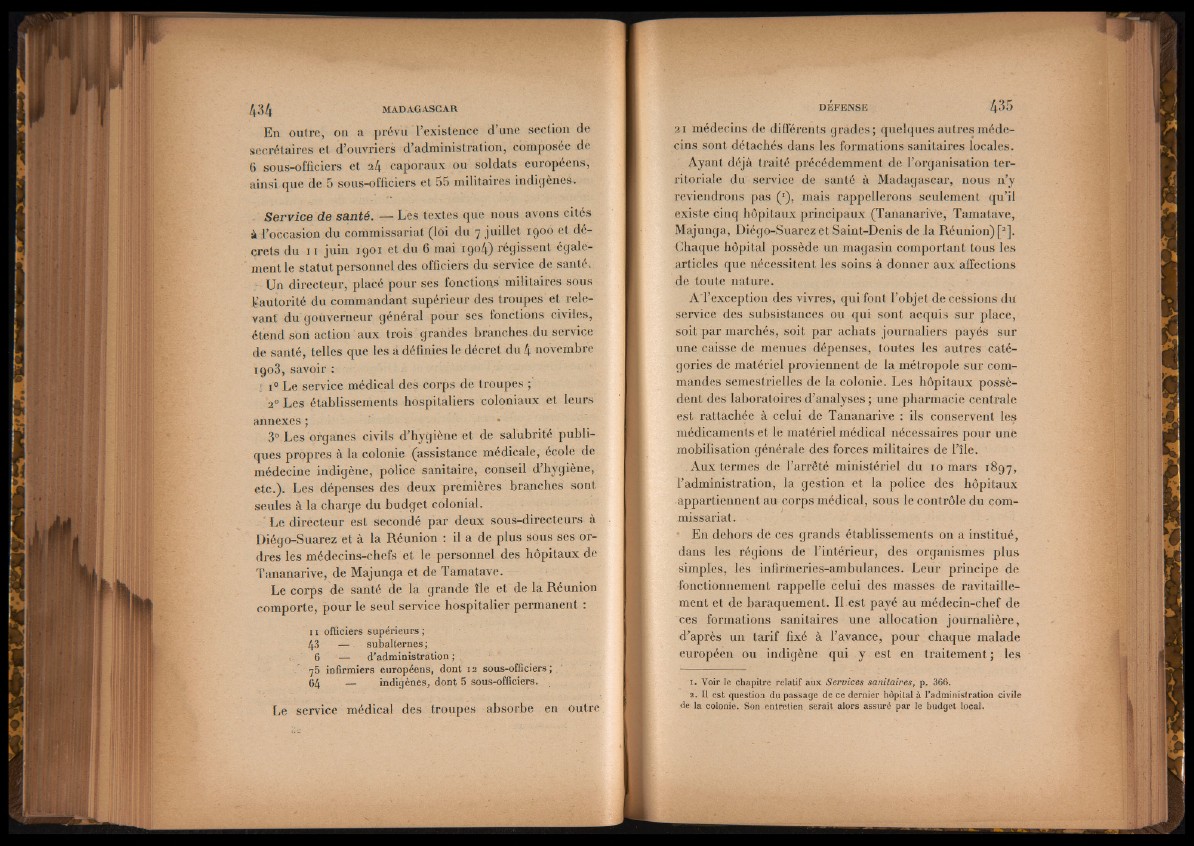
En outre, on a prévu l’existence d’une section de
secrétaires et d’ouvriers d’administration, composée de
6 sous-officiers et 24 caporaux ou soldats européens,
ainsi que de 5 sous-officiers et 55 militaires indigènes.
S e rv ice de senté. — Les textes que nous avons cités
à l’occasion du commissariat (loi du 7 juillet 1900 et décrets
du 11 juin 1901 et du 6 mai 1904) régissent également
le statut personnel des officiers du service de santé ,
r- Un directeur, placé pour ses fonctions militaires sous
^’autorité du commandant supérieur des troupes et relevant
du gouverneur général pour ses fonctions civiles,
étend son action aux trois grandes branches du service
de santé, telles que les a définies le décret du 4 novembre
1903, savoir :
; i° Le service médical des corps de troupes ;
20 Les établissements hospitaliers coloniaux et leurs
annexes ; ' •
3° Les organes civils d’hygiène et de salubrité publiques
propres à la colonie (assistance médicale, école de
médecine indigène, police sanitaire, conseil d’hygiène,
etc.). Les dépenses des deux premières branches sont
seules à la charge du budget colonial.
' Le directeur est secondé par deux sous-directeurs à
Diégo-Suarez et à la Réunion : il a de plus sous ses ordres
les médecins-chefs et le personnel des hôpitaux de
Tananarive, de Majunga et de Tamatave.
Le corps de santé de la grande île et de la Réunion
comporte, pour le seul service hospitalier permanent :
11 officiers supérieurs ;
43 — subalternes ;
6 — d’administration ; .
j 5 infirmiers européens, dont 12 sous-officiers ; /
¿4 — indigènes, dont 5 sous-officiers.
Le service médical des troupes absorbe en outre
21 médecins de différents grades; quelques autres médecins
sont détachés dans les formations sanitaires locales.
Ayant déjà traité précédemment de l’organisation territoriale
du service de santé à Madagascar, nous n’y
reviendrons pas (‘), mais rappellerons seulement qu’il
existe cinq hôpitaux principaux (Tananarive, Tamatave,
Majunga, Diégo-Suarez et Saint-Denis de la Réunion) [21.
Chaque hôpital possède un magasin comportant tous les
articles que nécessitent les soins à donner aux affections
de toute nature.
A l’exception des vivres, qui font l’objet de cessions dit
service des subsistances ou qui sont acquis sur place,
soit par marchés, soit par achats journaliers payés sur
une caisse de menues dépenses, toutes les autres catégories
de matériel proviennent de la métropole sur commandes
semestrielles de la colonie. Les hôpitaux possèdent
des laboratoires d’analyses ; une pharmacie centrale
est rattachée à celui de Tananarive : ils conservent les
médicaments et le matériel médical nécessaires pour une
mobilisation générale des forces militaires de l’île.
Aux termes de l’arrêté ministériel du 10 mars 1897,
l’administration, la gestion et la police des hôpitaux
appartiennent au corps médical, sous le contrôle du commissariat.
En dehors dé ces grands établissements on a institué,
dans les régions de l’intérieur, des organismes plus
simples, lès infirmeries-ambulances. Leur principe de
fonctionnement rappelle celui des masses de ravitaillement
et de baraquement. Il est payé au médecin-chef de
ces formations sanitaires une allocation journalière,
d’après un tarif fixé à l’avance, pour chaque malade
européen ou indigène qui y est en traitement ; les
1. Voir le chapitre relatif aux Services sanitaires, p. 366.
2. Il est question du passage de ce dernier hôpital à l’administration civile
de la colonie. Son entretien serait alors assuré par le budget local.