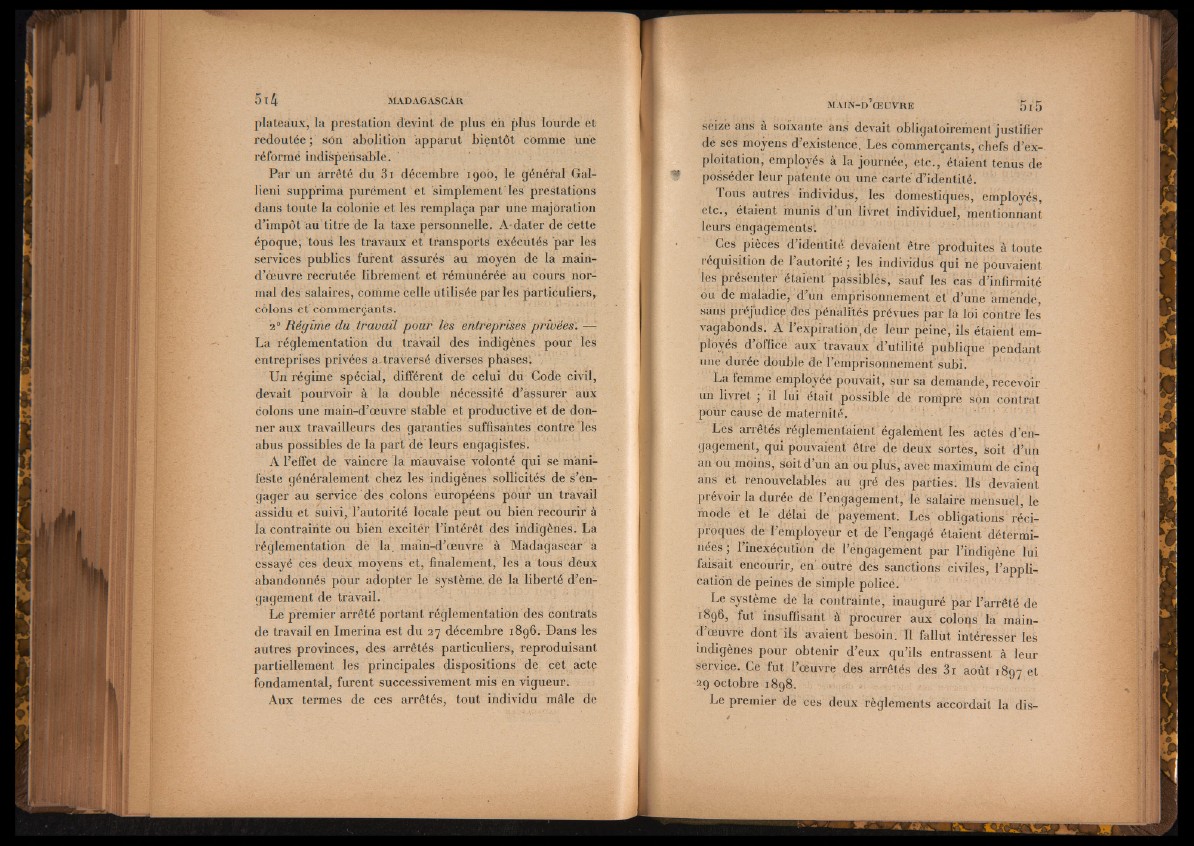
plateaux, la prestation devint de plus éh pins lourde et
redoutée; son abolition apparut bientôt comme une
réformé indispensable.
Par un arrêté du 3i décembre 1900, le général Gal-
lieni supprima purement et simplement les prestations
dans toute la colonie et les remplaça par une majoration
d’impôt au titre de la taxe personnelle. A-dater dé cette
époque, tous les travaux et transports exécutés par les
services publics furent assurés au ffioyén de la mairi-
d’ceuvre recrutée librement et rémùnérée au cours normal
des salaires, comme celle utilisée par les particuliers,
côlons et commerçants.
20 Régime du travail pour lès entreprises privées'. —
La réglementation du travail des indigènes pour les
entreprises privées a.traversé diverses phases:
Un régime spécial, différent de celui du Gode civil,
devait pourvoir à la double nécëssif é d’assurer aux
colons une main-d’oeuvre stable et productive et de donner
aux travailleurs des garanties suffisantes contré lès
abus possibles de la part dé leurs engagistes.
A l’elfet de vaincre la mauvaise volonté qui se manifeste
généralement chez les indigènes sollicités de s’engager
au service des colons européens pour un travail
assidu et suivi, l’autorité locale peut ou bién recourir à
la contrainte où bien excitér l’intérêt des indigènes. La
réglementation dè la. main-d’oeuvre à Madagascar a
essayé ces deux moyens et, finalement, les a tous deux
abandonnés pour adopter le système, de la liberté d’engagement
de travail.
Le premier arrêté portant réglementation des contrats
de travail en Imerina est du 27 décembre 1896. Dans les
autres provinces, des arrêtés particuliers* reproduisant
partiellement lès principales dispositions de cet acte
fondamental, furent successivement mis en vigueur.
Aux termes de ces arrêtés, tout individu mâle de
seize ans à soixante ans devait obligatoirement justifier
de ses moyens d’existence. Les commerçants, chefs d’exploitation,
employés à la journée, etc., étaient tenus de
posséder leur patente ou une carte d’identité.
Toüs autres individus, les domestiques, employés,
etc., étaient munis d un livret individuel, mentionnant
leurs èngagèmehts:
Ces pièces d’identité devaient être produites à toute
réquisition de l’autorité ; les individus qui né pouvaient
les présenter étaient passiblés, sauf les cas d’infirmité
ou de maladie, d’un emprisonnement et d’une amende,
sans préjudice des pénalités prévues par là loi contre les
vagabonds. A l’expiration,de leur peiné, ils étaient employés
d office aux travaux d’utilité publique pendant
une durée double de l’emprisonnement subi.
La femme employée pouvait, sur sa demande, recevoir
un livret ; il lui était possible de rompre son contrat
pour cause de maternité.
Les arrêtés réglementaient également les actes d’engagement,
qui pouvaient être de deux sortes, soit d’un
an ou moins, soit d’un an où plus, avec maximum de cinq
ans et renouvelablés au gré des parties. Ils devaient
prévoir la durée de l’engagement, le salaire mensuel, le
mode et le délai de payement. Les obligations réciproques
de l’employeur et de l’engagé étaient déterminées
; l’inexécution dè l’engagement par l’indigène lui
faisait encourir, en outre des sanctions civiles, l’application
de peines de simple policé.
Le système de la contrainte, inauguré par l’arrêté de
1896, fut insuffisant à procurer aux colons la mâin-
d OEuvré dont ils avaient besoin. Il fallut intéresser les
indigènes pour obtenir d’eux qu’ils entrassent à leur
service. Ce fut l’oeuvre des arrêtés des 3 r août 1897 et
29 octobre 1898.
Le premier de ces deux règlements accordait la dis