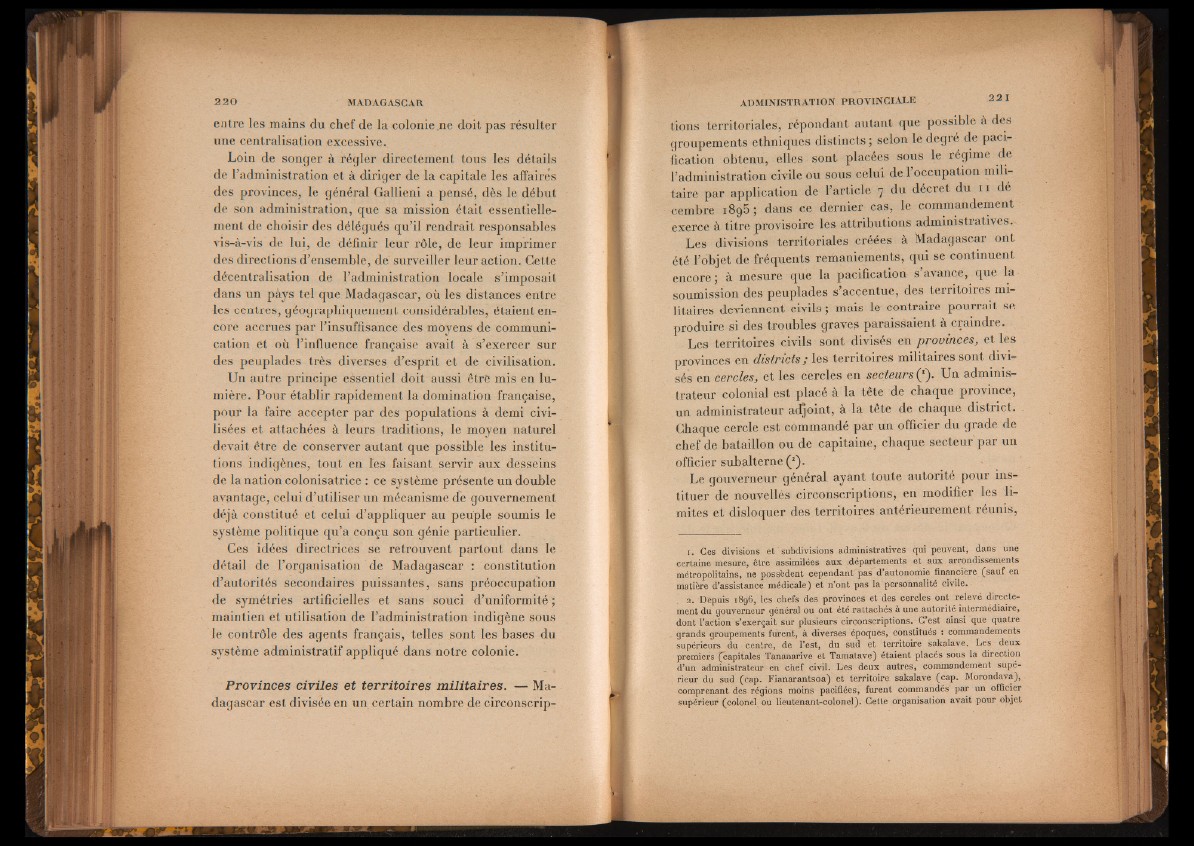
entre les mains du chef de la colonie .ne doit pas résulter
une centralisation excessive.
Loin de songer à régler directement tous les détails
de l’administration et à diriger de la capitale les affaires
des provinces, le général Gallieni a pensé, dès le début
de son administration, que sa mission était essentiellement
de choisir des délégués qu’il rendrait responsables
vis-à-vis de lui, de définir leur rôle, de leur imprimer
des directions d’ensemble, de surveiller leur action. Cette
décentralisation de l’administration locale s’imposait
dans un pays tel que Madagascar, où les distances entre
les centres, géographiquement considérables, étaient encore
accrues par l’insuffisance des moyens de communication
et où l’influence française avait à s’exercer sur
des peuplades très diverses d’esprit et de civilisation.
Un autre principe essentiel doit aussi être mis en lumière.
Pour établir rapidement la domination française,
pour la faire accepter par des populations à demi civilisées
et attachées à leurs traditions, le moyen naturel
devait être de conserver autant que possible les institutions
indigènes, tout en les faisant servir aux desseins
de la nation colonisatrice : ce système présente un double
avantage, celui d’utiliser un mécanisme de gouvernement
déjà constitué et celui d’appliquer au peuple soumis le
système politique qu’a conçu son génie particulier.
Ces idées directrices se retrouvent partout dans le
détail de l’organisation de Madagascar : constitution
d’autorités secondaires puissantes, sans préoccupation
de symétries artificielles et sans souci d’uniformité ;
maintien et utilisation de l’administration indigène sous
le contrôle des agents français, telles sont les bases du
système administratif appliqué dans notre colonie.
Provinces civiles et territoires militaires. — Madagascar
est divisée en un certain nombre de circonscriptions
territoriales, répondant autant que possible à des
groupements ethniques distincts ; selon le degré de pacification
obtenu, elles sont placées sous le régime de
l’administration civile ou sous celui de 1 occupation militaire
par application de l’article 7 du décret du 11 dé
cembre i 8 9 5 ; dans ce dernier cas, le commandement
exerce à titre provisoire les attributions administratives.
Les divisions territoriales créées à Madagascar ont
été l’objet de fréquents remaniements, qui se continuent
encore ; à mesure que la pacification s’avance, que la
soumission des peuplades s’accentue, des territoires militaires
deviennent civils ; mais le contraire pourrait se
produire si des troubles graves paraissaient à craindre.
Les territoires civils sont divisés en provinces, et les
provinces en districts ; les territoires militaires sont divisés
en cercles, et les cercles en secteurs (*). Un administrateur
colonial est placé à la tête de chaque province,
un administrateur adjoint, à la tête de chaque district.
Chaque cercle est commandé par un officier du grade de
chef de bataillon ou de capitaine, chaque secteur par un
officier subalterne (2).
Le gouverneur général ayant toute autorité pour instituer
de nouvellés circonscriptions, en modifier les limites
et disloquer des territoires antérieurement réunis,
1. Ces divisions et subdivisions administratives qui peuvent, dans une
certaine mesure, être assimilées aux .départements et aux arrondissements
métropolitains, ne possèdent cependant pas d’autonomie financière (sauf en
matière d’assistance médicale) et n’ont pas la personnalité civile.
2. Depuis 1896, les chefs des provinces et des cercles ont relevé directement
du gouverneur général ou ont été rattachés à une autorité intermédiaire,
dont l’action s’exerçait sur plusieurs circonscriptions. C’est ainsi que quatre
grands groupements furent, à diverses époques, constitués : commandements
supérieurs du centre, de l’est, du sud et territoire sakalave. Les deux
premiers (capitales Tanànarive et Tamatave) étaient placés sous la direction
d’un administrateur en chef civil. Les deux autres, commandement supérieur
du sud (cap. Fianarantsoa) et territoire sakalave (cap. Morondava),
comprenant des régions moins pacifiées, furent commandés par un officier
supérieur (colonel ou lieutenant-colonel). Cette organisation avait pour objet