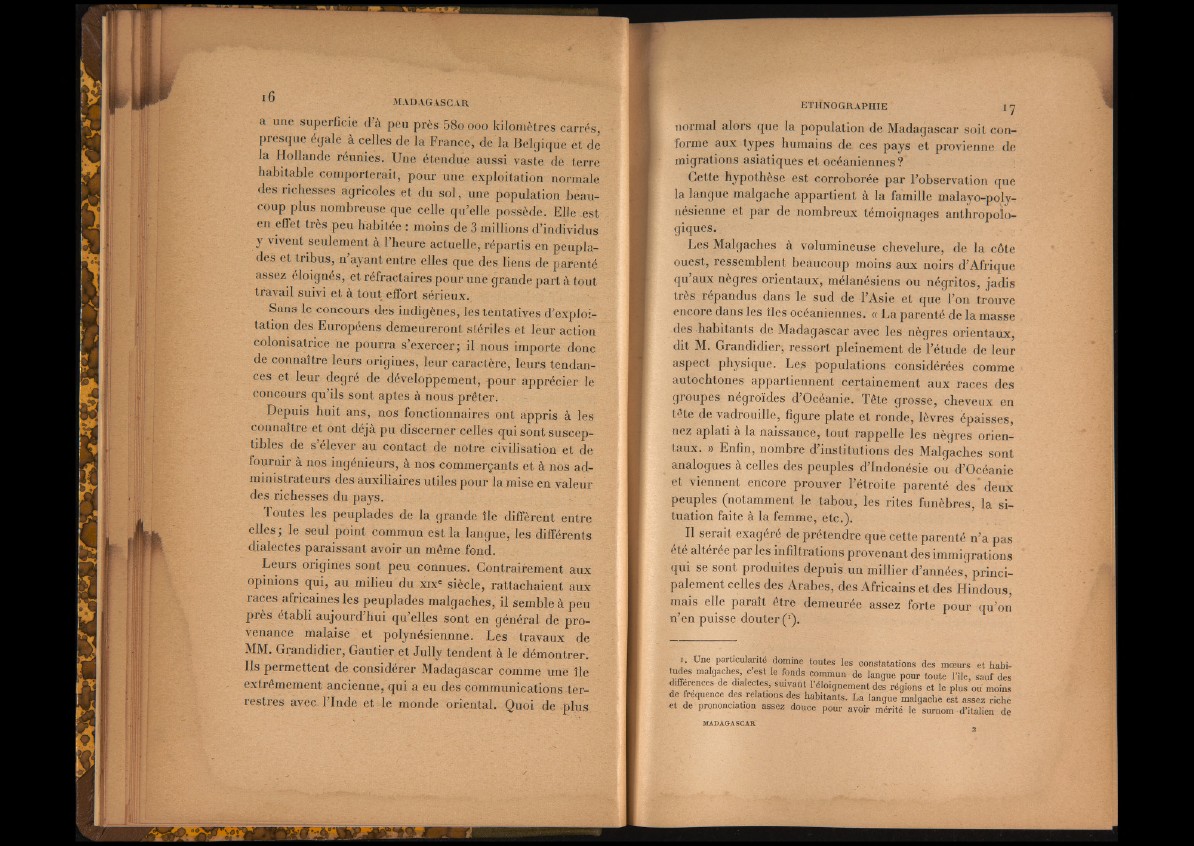
a une superficie d’à peu près 58o ooo kilomètres carrés,
presque égale à celles de la France, de la Belgique et de
la Hollande réunies. Une étendue aussi vaste de terre
habitable comporterait, pour une exploitation normale
des richesses agricoles et du sol, une population beaucoup
plus nombreuse que celle qu’elle possède. Elle est
en effet très peu habitée : moins de 3 millions d’individus
y vivent seulement à l’heure actuelle, répartis en peuplades
et tribus, n’ayant entre elles que des liens de parenté
assez éloignés, et réfractaires pour une grande part à tout
travail suivi et à tout effort sérieux.
Sans le concours des indigènes, les tentatives d’exploitation
des Européens demeureront stériles et leur action
colonisatrice ne pourra s’exercer; il nous importe donc
de connaître leurs origines, leur caractère, leurs tendances
et leur degré de développement, pour apprécier le
concours qu’ils sont aptes à nous prêter.
Depuis huit ans, nos fonctionnaires ont appris à les
connaître et ont déjà pu discerner celles qui sont susceptibles
de s’élever au contact de notre civilisation et de
fournir à nos ingénieurs, à nos commerçants et à nos administrateurs
des auxiliaires utiles pour la mise en valeur
des richesses du pays.
Toutes les peuplades de la grande île diffèrent entre
elles; le seul point commun est la langue, les différents
dialectes paraissant avoir un même fond.
Leurs origines sont peu connues. Contrairement aux
opinions qui, au milieu du xixe siècle, rattachaient aux
races africaines les peuplades malgaches, il semble à peu
près établi aujourd’hui qu’elles sont en général de provenance
malaise et polynésiennne. Les travaux de
MM. Grandidier, Gautier et Jully tendent à le démontrer.
Ils permettent de considérer Madagascar comme une île
extrêmement ancienne, qui a eu des communications terrestres
avec l’Inde et le monde oriental. Quoi de plus
normal alors que la population de Madagascar soit conforme
aux types humains de ces pays et provienne de
migrations asiatiques et océaniennes ?
Cette hypothèse est corroborée par l’observation que
la langue malgache appartient à la famille malayo-poly-
nésienne et par de nombreux témoignages anthropologiques.
Les Malgaches à volumineuse chevelure, de la côte
ouest, ressemblent beaucoup moins aux noirs d’Afrique
qu aux nègres orientaux, mélanésiens ou négritos, jadis
très répandus dans le sud de l’Asie et que l’on trouve
encore dans les îles océaniennes. « La parenté de la masse
des habitants de Madagascar avec les nègres orientaux,
dit M. Grandidier, ressort pleinement dé l’étude de leur
aspect physique. Les populations considérées comme
autochtones appartiennent certainement aux races des
groupes négroïdes d’Océanie. Tête grosse, cheveux en
tête de vadrouille, figure plate et ronde, lèvres épaisses,
nez aplati à la naissance, tout rappelle les nègres orientaux.
» Enfin, nombre d’institutions des Malgaches sont
analogues à celles des peuples d’Indonésie ou d’Océanie
et viennent encore prouver l’étroite parenté des deux
peuples (notamment le tabou, les rites funèbres, la situation
faite à la femme, etc.).
Il serait exagéré de prétendre que cette parenté n’a pas
été altérée par les infiltrations provenant des immigrations
qui se sont produites depuis un millier d’années, principalement
celles des Arabes, des Africains et des Hindous,
mais elle paraît être demeurée assez forte pour qu’on
n’en puisse douter (").
i. Une particularité domine toutes les constatations des moeurs et habitudes
malgaches, c est le fonds commun de langue pour toute l ’île, sauf des
différences de dialectes, suivant l’éloignement des régions et le plus ou moins
de fréquence des relations des habitants. La langue malgache est assez riche
et de prononciation assez douce pour avoir mérité le surnom d’italien de