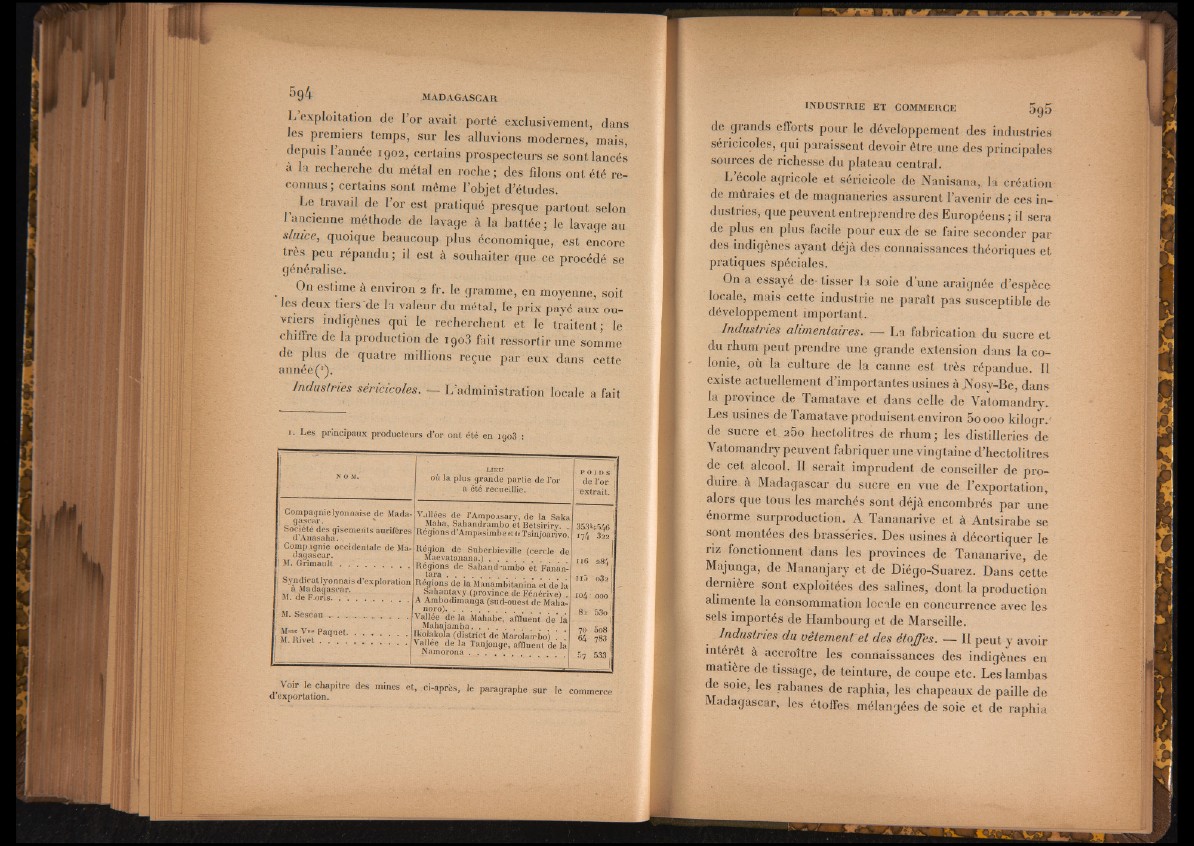
L exploitation de l’or avait porté exclusivement, dans
les premiers temps, sur les alluvîons modernes, mais,
depuis l’année 1902, certains prospecteurs se sont lancés
à la recherche du métal en roche ; des filons ont été reconnus;
certains sont même l’objet d’études.
Le travail de l’or est pratiqué presque partout selon
l ’ancienne méthode de lavage à la battée; le lavage au
sluice, quoique beaucoup plus économique, est encore
très peu répandu ; il est à souhaiter que ce procédé se
généralise.
On estime à environ 2 fr. le gramme, en moyenne, soit
les deux tiers de la valeur du métal, le prix payé aux ouvriers
indigènes qui le recherchent et le traitent; le
chiffre de la production de igo3 fait ressortir une somme
de plus de quatre millions reçue par eux dans cette
année (*).
Industries séricicoles. — L’administration locale a fait
i. Les principaux producteurs d’or ont été en igo3 :
N 0 M .
L IE U
où la plus grande partie de l’or
a été recueillie.
P O I D S
de l’or j
extrait. \
j Compagnie lyonnaise de Mada-
j gascar. %
! Société des gisements aurifères
j d’Anasaha.
| Compagnie occidentale de Madagascar.
1 M. Grimanlt..............................
I Syndicat lyonnais d’exploration
à Madagascar.
M . de F.oris. . ...............
Vallées de l’Ampoasary, de la Saka
Maha, Sahandrambo et Betsiriry.
Régions d’Ampasimbe et de Tsinjoarivo.
Région de Suberbieville (cercle de
Maevatanana.) . . ...................
Régions de Sahand'-ambo et Fanant
a r a ................................................
Régions de la Manambitanina et de la
Sahantavy (province de Fénérive) .
A Ambodimanga (sud-ouest de Maha-
noro). . . . . . . . . .
Vallée de la Mahabe,* affluent de* la
Mabajamba. . . . . .
fkolakola (district de Marolarrbo) .
Vallée de la Tanjonge, affluent de là
Namorona . . . . .
353ks546
174 322
116 284
i i 5 032
104 000
M. Sescau . . . . . . . . 81 53o1
' M'«« V>e Paquet. . . . . . 70 5o8
M. R iv e t ............... ..................... 64 783
! H
Voir le chapitre des mines et
, ci-après, le paragraphe sur le commerce
d’exportation.
de grands efforts pour le développement des industries
séricicoles, qui paraissent devoir être une des principales
sources de richesse du plateau central.
L école agricole et séricicole de Nanisana, la création
de mûraies et de magnaneries assurent l’avenir de ces industries,
que peuvent entreprendre des Européens ; il sera
de plus en plus facile pour eux de se faire seconder par
des indigènes ayant déjà des connaissances théoriques et
pratiques spéciales.
On a essayé de- tisser la soie d’une araignée d’espèce
locale, mais cette industrie ne paraît pas susceptible de
développement important.
Industries alimentaires. — La fabrication du sucre et
du rhum peut prendre une grande extension dans la colonie,
où la culture de la canne est très répandue. Il
existe actuellement d’importantes usines àj>iosy-Be, dans
la province de Tamatave et dans celle de Vatomandry.
Les usines de Tamatave produisent environ 5oooo kilogr.'
de sucre et 25o hectolitres de rhum; les distilleries de
Vatomandry peuvent fabriquer une vingtaine d’hectolitres
de cet alcool. Il serait imprudent de conseiller de produire
à Madagascar du sucre en vue de l’exportation,
alors que tous les marchés sont déjà encombrés par une
énorme surproduction. A Tananarive et à Antsirabe se
sont montées des brasseries. Des usines à décortiquer le
riz fonctionnent dans les provinces de Tananarive, de
Majunga, de Mananjary et de Diégo-Suarez. Dans cette
dernière sont exploitées des salines, dont la production
alimente la consommation locale en concurrence avec les
sels importés de Hambourg et de Marseille.
Industries du vêtement et des étoffes. — II peut y avoir
intérêt à accroître les connaissances des indigènes en
matière de tissage, de teinture, de coupe etc. Les lambas
de soie, les rabanes de raphia, les chapeaux de paille de
ladagascar, les étoffes mélangées de soie et de raphia